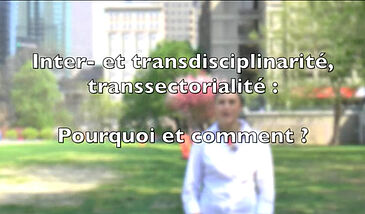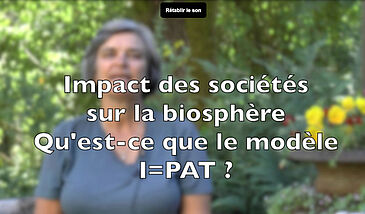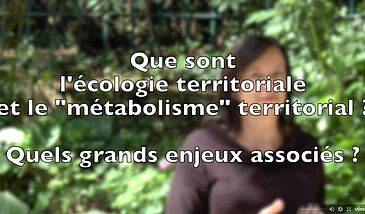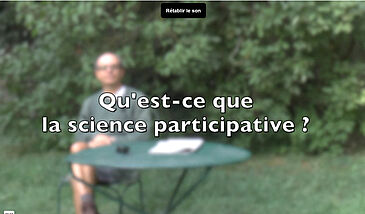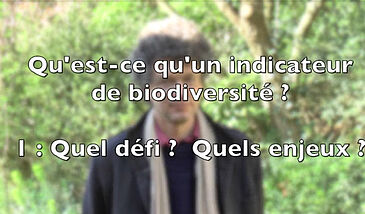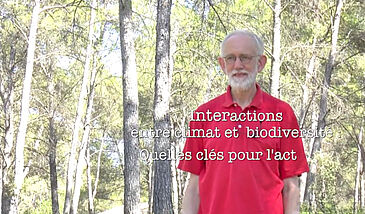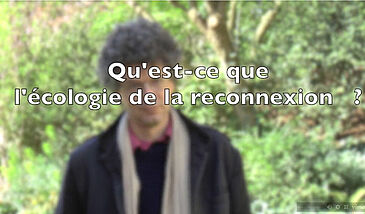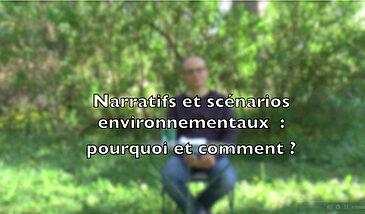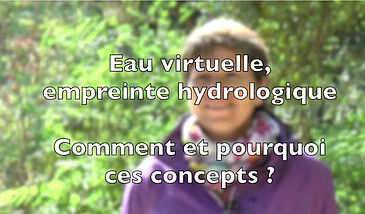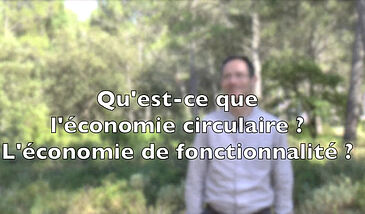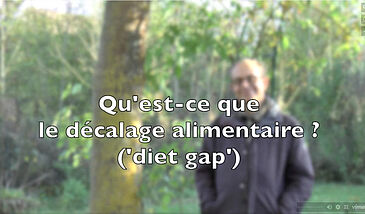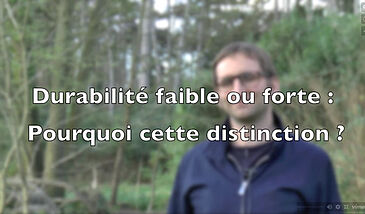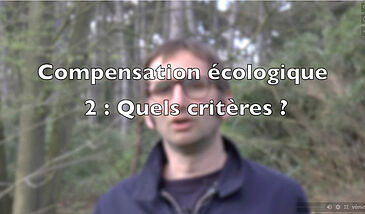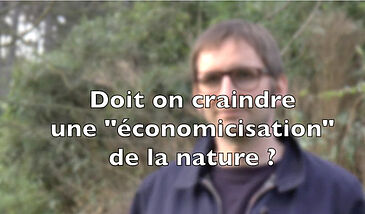En ligne depuis le 06/11/2018
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Harold Levrel, Professeur d'Economie à AgroParisTech pour la série vidéo "SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé"
(Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique?)
Conception et coordination du projet, réalisation de cette série vidéo : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Objectifs de Développement Durable
- 14. Vie aquatique
- 15. Vie terrestre
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Levrel Harold
professeur , AgroParisTech
Harold Levrel, Professeur à AgroParisTech, chercheur au CIRED
Question-clé transcrite et éditée par Anne Teyssèdre
Les services écosystémiques. Qu’apporte cette notion aux sciences de la conservation ?
La notion de service écosystème empreinte à la fois à l’écologie et à l’économie : la notion de « service » est plutôt un concept issu de l’économie, et « écosystémique » bien sûr vient de l’écologie.
On assimile souvent ce concept à un lexique économique qui traduirait une tendance à « l’économicisation » de la nature. Selon moi, c’est un peu plus complexe que ça dans le sens où cette notion forme avant tout un langage commun, entre scientifiques tout d’abord –entre économistes et écologues, mais aussi écologues et géographes et puis, de manière générale, entre tous les scientifiques qui s’intéressent à la conservation de la biodiversité. Ce concept offre en effet une unité de mesure et une unité de langage, totalement transdisciplinaire.
Mais au delà de ça, c’est aussi un langage commun pour échanger avec les politiques. Il est souvent plus aisé de parler de conservation de la nature en soulignant certains bénéfices pour les populations riveraines, que d’aller brutalement vers des objectifs de conservation de la biodiversité, quand un élu a pour projet de développer son territoire avec les outils qui sont à sa disposition, que ce soit des plans locaux d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme, PLU) ou les schémas de cohérence territoriale (Schémas de Cohérence Territoriale, SCT), il y a clairement un enjeu à sortir de l’opposition entre enjeux de développement et enjeux de conservation, ne serait-ce que pour des raisons stratégiques. Et il est clair que cette notion de service écosystémique aide à avoir des discussions plus constructives autour de l’aménagement du territoire, lorsqu’il s’agit de discuter d’enjeux de conservation et de développement pour l’avenir de ces territoires.
Pour autant, il ne s’agit pas d’évaluer ces services écosystémiques en unités monétaires reflétant la valeur économique des composantes de la biodiversité sous un angle strictement utilitariste. En effet, avoir ce type d’approche conduit à uniformiser les systèmes de valeurs autour d’une unité économique qui, une fois agrégée, permettrait d’optimiser des choix de décisions publiques.
En fait, il est beaucoup plus constructif d’avoir une approche multicritère, qui certes peut à certains égards mobiliser de l’évaluation monétaire quand elle a du sens – on peut penser par exemple au fait que la destruction d’un écosystème naturel va conduire à faire disparaître certains services écosystémiques comme la filtration de l’eau et que, du fait de la loi sur l’eau, la commune à proximité va devoir dépenser de l’argent, investir dans la mise aux normes d’une station d’épuration, dont on sait que cette mise au normes pour filtrer les nitrates, phosphates, est extrêmement coûteuse.
Il ne s’agit en aucun cas d’ailleurs de souligner que la valeur de la zone humide correspondrait au coût de la mise aux normes de cette station d’épuration pour compenser la perte de services écosystémiques, mais bien d’insister sur le fait que cela va être coûteux de laisser disparaître des écosystèmes, au delà du fait que ces écosystèmes aient une valeur pour eux-mêmes.
Il ne s’agit ici que de l’évaluation du coût de la destruction d’un service écosystémique qui était utile à la société et qui n’était pas perçu. Pour autant il faut ajouter à cet indicateur -qui peut être utile- beaucoup d’autres indicateurs pour comprendre les impacts de la destruction de cet espace naturel. Il y a en effet des indicateurs qui vont renvoyer à la disparition de la biodiversité qui était hébergée par cet écosystème ; il y a des indicateurs qui renvoient à la perte d’accès pour la population riveraine à ces espaces naturels ; des indicateurs qui renvoient aussi à la perte de services de pollinisation…
En fait, de nombreux indicateurs de services écosystémiques sont évalués à partir de mesures qui ne sont pas uniquement monétaires, mais biophysiques, des indicateurs d’accès, de production…, et c’est cette diversité d’indicateurs qui va être utile pour une diversité d’acteurs, qui ont une diversité de systèmes de valeurs autour de cette nature. Et l’un des enjeux pour l’avenir, c’est d’être en capacité de mettre autour de la table des acteurs qui vont penser l’aménagement de leur territoire en prenant en compte cette diversité de services écosystémiques et en mobilisant une diversité d’indicateurs qui leur sont propres.
Par ailleurs, mobiliser des indicateurs de services écosystémiques ne veut pas dire que ces indicateurs doivent se substituer aux indicateurs naturalistes classiques. On peut évidemment, dans le débat autour de l’aménagement du territoire, toujours mobiliser des indicateurs issus des inventaires floristiques et faunistiques. C’est même complémentaire. Donc le projet de travail autour des services écosystémiques n’est pas de réduire ces services écosystémiques à une unité monétaire qui permettrait d’optimiser des choix derrière, mais bien de considérer la diversité des bénéfices pour la société, qui vient s’ajouter à la palette d’indicateurs classiques de biodiversité.
A ce titre, il me semble que la notion de service écosystémique peut apporter des gains très nets en matière de débat autour des interactions Sociétés-Nature.