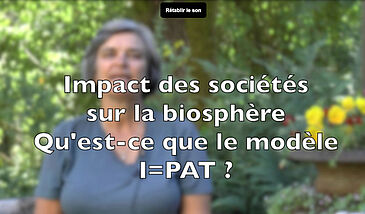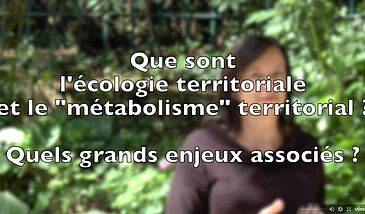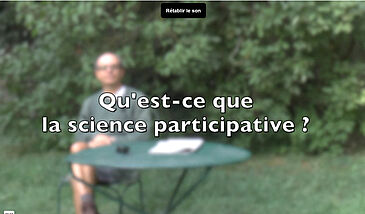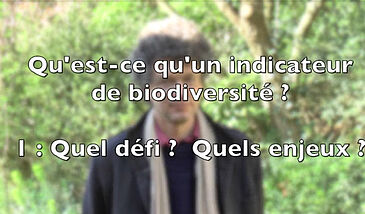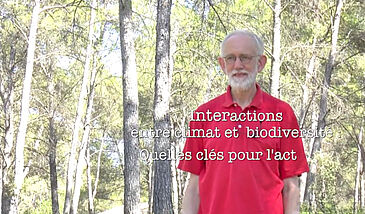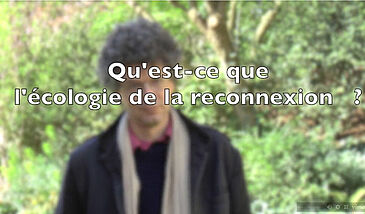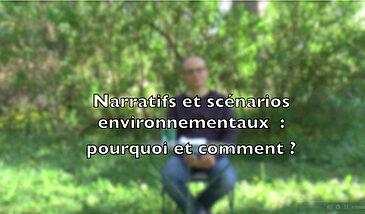En ligne depuis le 19/11/2017
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Anne-Hélène Prieur-Richard, Directrice du Hub de Montréal, Future Earth, pour la série vidéo "SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé"
(Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique?)
Conception et réalisation de cette série vidéo : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Objectifs de Développement Durable
- 13. Lutte contre le changement climatique
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Prieur-Richard Anne-Hélène
Directrice du Hub de Montréal, Future Earth
Anne-Hélène Prieur-Richard, Future Earth
Question-clé transcrite et éditée par Anne Teyssèdre
Inter- et transdisciplinarité, transsectorialité. Pourquoi et comment ?
Depuis quelques années, on a observé au sein de la recherche un mouvement qui partait du développement de connaissances, d’un point de vue disciplinaire, à ce qu’on appelle l’interdisciplinarité, puis maintenant ce qu’on appelle la transdisciplinarité. Ce mouvement s’est mis en place au fur et à mesure du temps, non pas en contradiction avec le fait qu’on a besoin de produire des connaissances disciplinaires. Mais pour un certain nombre d’objets, de questions qui sont complexes, on a besoin d’amener des champs de recherche différents pour pouvoir comprendre de façon plus globale les processus qui nous entourent. C’est notamment vrai pour tout ce qui est lié aux changements globaux ou à la durabilité, que l’on appelle également en anglais « sustainability ».
Cette idée de transdisciplinarité signifie non seulement d’amener des chercheurs de différentes disciplines, que ce soit des sciences physiques, naturelles, biologiques, sociales –
les humanités-, à travailler ensemble, mais implique aussi un élément supplémentaire, qui est que l’on veut aller vers des solutions et vers des transformations de la façon dont on gère les processus qui nous entourent.
Par exemple, si l’on prend les questions de changement climatique, pour comprendre cet objet qui est complexe, on va avoir besoin bien sûr de personnes qui travaillent sur le climat physique, sur les éléments chimiques du climat, également sur l’océanographie –puisque certaines choses se passent dans les océans, aussi bien que dans les milieux terrestres, mais également, on aura besoin de comprendre par exemple l’impact de changements de biodiversité sur le climat, et non pas seulement l’impact du climat sur la biodiversité, puis que celle-ci a un rôle essentiel également dans les processus climatiques.
Donc ces questions là ont amené ces différentes disciplines ensemble, mais une des raisons pour lesquelles la société a également besoin de connaissances, c’est que ces connaissances doivent répondre aux besoins de la société. Pour cela, on a besoin de former un dialogue non seulement entre chercheurs mais aussi avec les gens qui ont besoin de ces connaissances et de ce savoir. C’est donc là où on amène la question d’avoir différentes parties prenantes qui vont discuter, mettre en place des projets de recherche, des axes de recherche, en collaboration avec les chercheurs eux-mêmes dont c’est le corps de métier.
Dans ces parties prenantes, on va avoir bien entendu les décisionnaires, à différentes échelles, qu’ils soient locaux, régionaux ou internationaux ; mais également la société civile avec les associations, que ce soit des associations de conservation (de la biodiversité) ou des associations de consommateurs, mais également le secteur privé et l’industrie.
On a dit qu’il y avait besoin de disciplines différentes, de parties prenantes différentes, et je dirais qu’il y a un autre volet qui est un peu l’équivalent des disciplines différentes, c’est que dans les parties prenantes, dans ces secteurs de la société, là aussi on a besoin d’avoir beaucoup plus de relations entre les secteurs de l’agriculture, des transports, de l’énergie, de l’économie. Donc en fait, cet exercice qui a été fait pendant un certain nombre d’années au niveau de la recherche, le même type d’exercice doit aussi avoir lieu dans la prise de décision.
Dans ce champ sur la transdisciplinarité, il y a des mots que l’on va retrouver et qui n’ont pas toujours tout à fait le même sens, qui ne sont pas interprétés de la même façon par tout le monde - c’est la vision que l’on a nous de cette discipline là. Un autre mot qui apparaît de plus en plus, la ‘transsectorialité’, apparaît plus dans le domaine sociétal que dans le domaine de la recherche, où on parle plus d’interdisciplinarité. Mais l’idée de base est un peu la même : comme on a des départements par thématique et par discipline au sein d’une université, on a des secteurs économiques au sein de notre société –le transport, bien sûr l’économie générale, l’agriculture, les pêcheries, l’environnement, … Et l’idée c’est qu’il existe des conflits ou des compromis, ou ce qu’on appelle en anglais des trade-off, entre différents secteurs.
C’est-à-dire qu’une décision qui va être prise par exemple sur : ‘Est-ce qu’on augmente la part des transports en commun, ou pas ?’ ‘Est-ce qu’on augmente la part des énergies
renouvelables, ou pas ?’ va avoir un impact sur des questions agricoles, des questions environnementales, sur la gestion de nos écosystèmes, sur le développement de voies
ferroviaires ou fluviales. Pour tout cela, on sent bien qu’il y a des impacts dans les deux sens et qu’il y a besoin un moment de les mettre ensemble pour que les décisions prises dans un secteur puissent ne pas être négatives, mais positives, pour l’autre secteur.
Il y a eu des modèles qui ont été développés, on l’on montre que l’on peut en même temps réduire les effets du climat, en même temps réduire les effets sur les pertes de biodiversité et en même temps augmenter la capacité alimentaire au niveau mondial. Ces scénarios ont montré qu’effectivement, si l’on prend des mesures sur le changement climatique, on a peut-être un effet beaucoup plus important, mais par contre, avec un effet un peu moindre, on peut également avoir un effet positif sur les deux autres aspects. Et ça, c’est très important pour le long terme. Non pas à court terme, mais ici on pense au long terme, c’est-à-dire aux générations futures, et c’est pour cela que développer cette transsectorialité et l’habitude de travailler ensemble est extrêmement important.