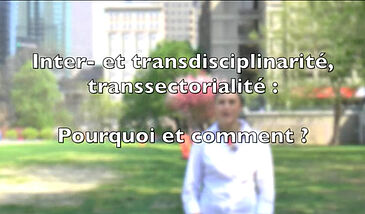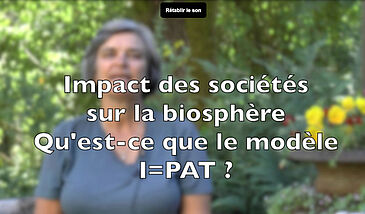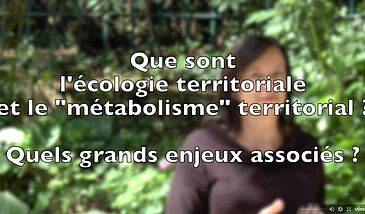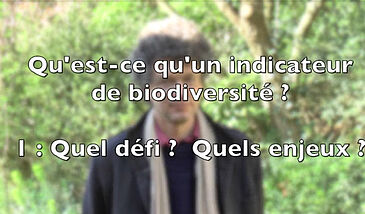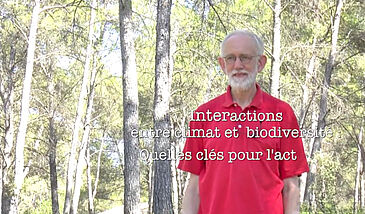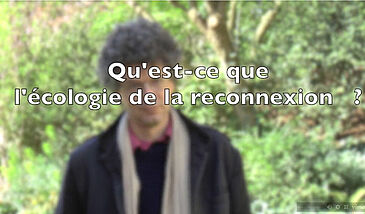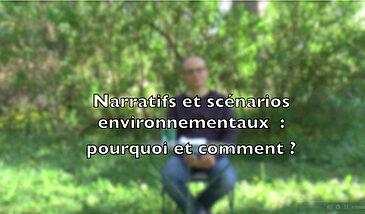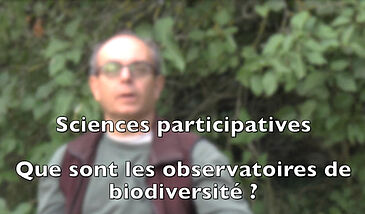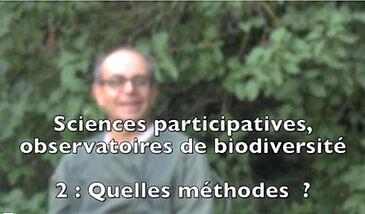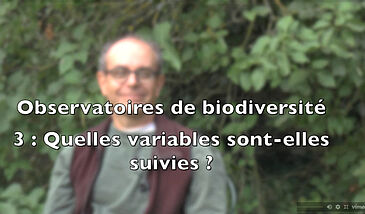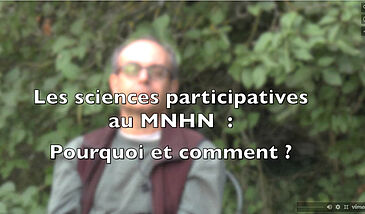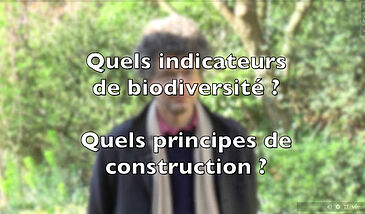En ligne depuis le 09/09/2019
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Denis Couvet, Professeur d'Ecologie au MNHN, et à Grégoire Loïs, Directeur de Vigie-Nature, pour le projet web Nexus Clés ("SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé"). Url : su-ite.eu/nexus-videos-cles/plan/
[Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique? ]
Conception et coordination de ce projet web, réalisation des vidéos : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Couvet Denis
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Loïs Grégoire
Directeur de Vigie-Nature , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Qu’est-ce que la science participative ?
Question-clé à Denis Couvet, Professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, et à Grégoire Loïs, Directeur adjoint de Vigie-Nature
Exposés transcrits et édités par Anne Teyssèdre, 2019
DC : La (ou les) science(s) participative(s) correspond(ent) à une tendance très large de la société qui est de combiner, au-delà des savoirs scientifiques, l’ensemble des savoirs vernaculaires. Dans ces sciences participatives, il y a des enjeux très divers. Il y a des enjeux d’innovation, et l’agroécologie en fait partie ; il y a l’ensemble des processus sociaux et politiques, où l’implication de l’ensemble des parties prenantes est devenue un enjeu de société extrêmement important ; et enfin il y a le domaine de la connaissance.
Dans ce domaine, dont je vais parler plus précisément, les sciences de l’environnement sont très demandeuses de processus liés aux sciences participatives. Pourquoi ? Parce qu’actuellement, les dispositifs en sciences de l’environnement sont souvent insuffisants, et puis- surtout- parce qu’un certain nombre de connaissance en sciences de l’environnement sont plus vernaculaires que scientifiques, qu’universitaires. C’est notamment dans le domaine de la biodiversité que les connaissances -dans le domaine des oiseaux, des plantes..- sont souvent beaucoup plus profondes dans le milieu naturaliste que dans le milieu universitaire.
GL : Alors les sciences participatives sont un principe déjà ancien. Il s’agit d’une collaboration entre professionnels et non professionnels de la science - c’est-à-dire non salariés de la science. Et en fait c’est un principe déjà ancien, qui a quelques siècles. Par exemple, les collections qui se sont accumulées dans tous les Muséums du monde, ce sont à 95% des objets qui ont été collectés, amassés, accumulés par des amateurs : des amateurs en déplacement, en voyage, qui étaient fascinés par l’objet scientifique. Parce que la science, ça ne concerne pas que les professionnels, c’est quelque chose qui peut concerner tout un chacun, il y a une forme de fascination à découvrir le vivant ou le non vivant, le patrimoine géologique par exemple, l’astronomie…
Par exemple, on a découvert par hasard sur Internet un ouvrage, dont c’était la cinquième édition en 1866, à destination des voyageurs – des voyageurs à destination des colonies, à l’époque – qui a été écrit et préfacé par des professeurs du Muséum National d’Histoire Naturelle, afin de collecter, de conserver et de ramener pour enrichir les collections scientifiques, du patrimoine naturel.
Du coup, cette fascination pour la science, pour les objets naturels, pour la science naturelle s’est orchestrée en sociétés d’histoire naturelle et en associations de protection de la nature, qui se sont un peu entremêlées depuis une quarantaine d’années. Et on a des structures comme ça, qui volontairement se décrètent prêtes à participer à un effort scientifique.
Cette implication citoyenne, des experts citoyens -parce qu’il y a des amateurs qui en savent beaucoup sur certains groupes taxonomiques ou sur certains phénomènes-, elle est particulièrement prégnante dans les pays anglo-saxons, et du coup dans les ex-colonies anglo-saxonnes. C’est vraiment manifeste par exemple en Angleterre : au Royaume-Uni, il y a un peu plus d’un million d’adhérents à l’association de protection et de connaissance des oiseaux, alors qu’en France la LPO compte à peu près 50.000 adhérents. Donc on a une espèce d’engagement citoyen qui est beaucoup plus large et beaucoup plus fort (en Angleterre qu’en France), et du coup cela a des retombées sur l’ensemble du vivant. C’est-à-dire qu’on trouve des spécialistes en Angleterre, tels que des spécialistes des diptères –les mouches- qui sont un groupe d’insectes assez compliqué, très diversifié ; on trouve des spécialistes des mousses, ou des lichens, en beaucoup plus grand nombre qu’en France.
DC : Aussi les sciences participatives ont fait appel à ces savoirs vernaculaires pour développer des observatoires de biodiversité, parce que finalement les naturalistes sont plus à même de suivre la biodiversité. Donc on a comme cela un ensemble d’observatoires qui se sont développées autour des oiseaux, des insectes, des plantes et de plus en plus d’autres groupes, la faune du sol en faisant maintenant partie.
GL : En fait cet effort, cette énergie collective a été en quelque sorte un peu canalisée dans le cadre de Vigie-Nature, des programmes de sciences participatives, qui visaient à l’origine à s’appuyer sur les savoirs d’experts naturalistes pour collecter des données, puis qui s’est étendu à tout un chacun, parce que pour observer la nature il n’y a pas besoin d’être expert naturaliste.