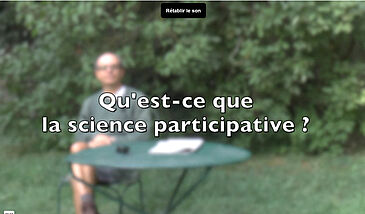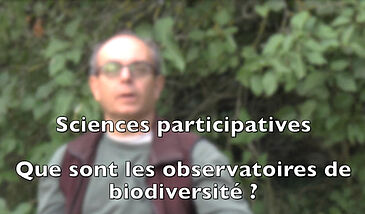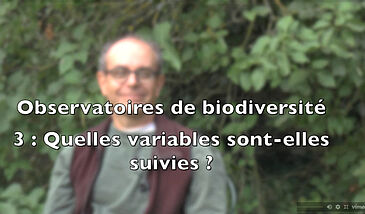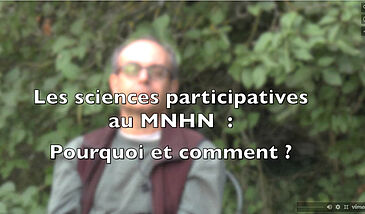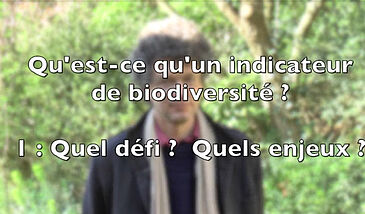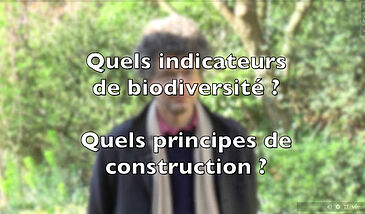En ligne depuis le 04/09/2019
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Denis Couvet, Professeur d'Ecologie au MNHN, et à Grégoire Loïs, Directeur de Vigie-Nature, pour le projet web Nexus Clés ("SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé"). Url : su-ite.eu/nexus-videos-cles/plan/
[Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique? ]
Conception et coordination de ce projet web, réalisation des vidéos : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Objectifs de Développement Durable
- 15. Vie terrestre
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
COUVET Denis
Loïs Grégoire
Directeur de Vigie-Nature , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Observatoires de biodiversité, 2 : Quels grands principes et méthodes ?
Question-clé à Denis Couvet, Professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, et à Grégoire Loïs, Directeur adjoint de Vigie-Nature
Exposés transcrits et édités par Anne Teyssèdre, 2019
DC : Comment les sciences participatives fonctionnement-elles, dans ce domaine de l’environnement ? Il y a plusieurs types de dispositifs, bien sûr, mais le type le plus fréquent, qui a donné le plus de résultats dans la littérature scientifique universitaire, ce sont des dispositifs à protocoles standardisés qui sont conçus par les laboratoires et qui s’adressent à un ensemble d’observateurs dont la disponibilité et les savoirs sont très divers - ce qui entraîne un certain nombre de difficultés, notamment dans le domaine statistique, parce que finalement on peut avoir un réseau d’observateurs très hétérogène.
Donc le principe, c’est de développer un dispositif ou protocole qui soit ajusté, qui soit suffisamment attractif aussi pour les observateurs - qui le plus souvent sont bénévoles. Et à partir de là, ces observateurs vont adhérer, participer à ces dispositifs.
GL : Une chose absolument capitale pour permettre l’analyse des données, pour permettre leur exploitation, pour pouvoir exploiter à plein l’information contenue dans les données, c’est le fait qu’elles soient collectées de manière similaire dans le temps et dans l’espace. Et pour cela, on conçoit des protocoles (de suivis de biodiversité), c’est-à-dire qu’on définit a priori les conditions dans lesquelles les données vont être récoltées. Alors c’est toujours contraignant, évidemment, puisque c’est un protocole, mais parfois la contrainte est très simple : par exemple, dans le cadre du spipoll (Suivi des insectes pollinisateurs, Vigie-Nature), on demande simplement aux gens de trouver une plante en fleurs (une station), et de photographier, pendant vingt minutes, toute activité d’invertébrés sur les fleurs.
Cela peut être aussi des stratégies d’échantillonnage qui découlent de l’exploitation statistique ; par exemple, pour avoir une bonne représentativité des données, faire un tirage aléatoire. C’est-à-dire que ce n’est pas le participant qui va choisir l’endroit où il va regarder la donnée, mais c’est un processus aléatoire qui indique au participant « vous irez compter les oiseaux sur ce carré de 2 km de côté, sur dix points représentatifs des habitats, chaque année, à deux dates définies (à plus ou moins trois jours), dans des conditions si possible favorables.
DC : Tout cela s’est développé bien évidemment avec Internet, qui a facilité à la fois la mise à disposition du protocole et la remontée des données, une tâche qui peut être très lourde. En effet, collecter les données de milliers d’observateurs être très lourd, sauf si la saisie des données est numérisée (i.e., se fait de manière informatique). À ce moment-là, la remontée des données se fait automatiquement et le laboratoire organisateur n’a plus qu’à gérer la base de données.