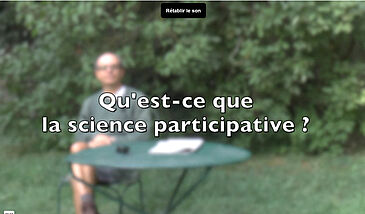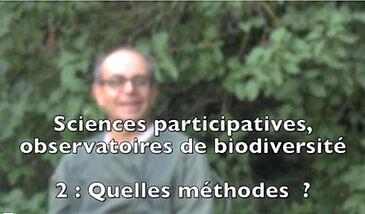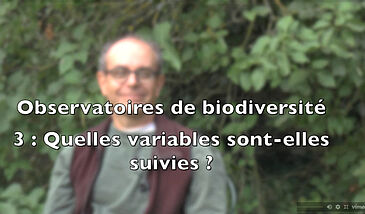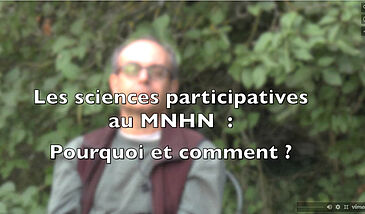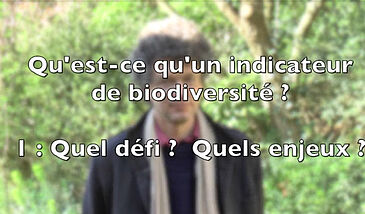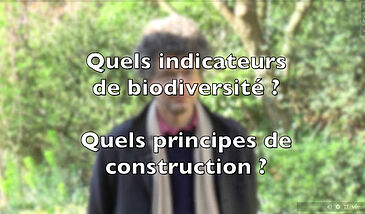En ligne depuis le 04/09/2019
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Denis Couvet, Professeur d'Ecologie au MNHN, et à Grégoire Loïs, Directeur de Vigie-Nature, pour le projet web Nexus Clés ("SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé"). Url : su-ite.eu/nexus-videos-cles/plan/
[Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique? ]
Conception et coordination de ce projet web, réalisation des vidéos : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Sciences de la vie
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Objectifs de Développement Durable
- 15. Vie terrestre
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
COUVET Denis
Loïs Grégoire
Directeur de Vigie-Nature , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Sciences participatives : Que sont les observatoires de biodiversité ? (1)
Question-clé à Denis Couvet, Professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, et à Grégoire Loïs, Directeur adjoint de Vigie-Nature
Exposés transcrits et édités par Anne Teyssèdre, 2019
DC : Les observatoires citoyens sont une combinaison entre des laboratoiresuniversitaires et des observateurs bénévoles, le laboratoire proposant le protocole et les observateurs faisant remonter les données auprès des laboratoires universitaires. Les observateurs bénévoles vont collecter les données, et l’utilisation d’Internet va permettre d’une part la mise à disposition du protocole aux observateurs, et dans le sens inverse la remontée des données des milliers d’observateurs bénévoles vers le laboratoire. Ce qui va permettre aux scientifiques de se concentrer sur la gestion et à l’analyse des données - en court-circuitant le travail de remontée des données, qui peut être extrêmement lourd et qui est favorisé par Internet.
GL : Les observatoires de biodiversité, ce sont finalement de grosses initiatives, des initiatives structurées pour collecter et analyser des données. Dans le cas de la France, cela remonte maintenant à quelques dizaines d’années, et finalement c’est la prise de conscience par la puissance publique de l’intérêt de ces données sur la nature. A l’époque (dans les années 1990), il n’y a pas d’organisme public chargé d’avoir un regard sur toute la nature. Il y a bien un organisme public pour la pêche, un organisme public pour la chasse, et puis des activités autour d’aires très patrimoniales, très protégées, mais il n’y a pas une espèce de regard transversal. Et les observatoires de biodiversité, c’est pour essayer de collecter toute cette donnée. Alors en France, l’initiation vient d’un rapprochement entre un service du Muséum (MNHN), des sociétés d’Histoire naturelle et des associations de protection de la Nature, pour notamment la publication d’atlas, c’est-à-dire la compilation de données ; il s’agissait de donner des moyens à ces associations pour porter à connaissance et diffuser leurs productions.
Maintenant il en existe des déclinaisons à diverses échelles. C’est-à-dire qu’il y a un observatoire à l’échelon national, sous l’égide de la toute nouvelle Agence Française de la Biodiversité (AFB) et copiloté par le Muséum, et des observatoires régionaux dans lesquels on trouve vraiment une espèce de cohésion entre les activités de science participative –donc des programmes de science participative qui sont vraiment pilotés par la recherche, avec l’émergence de questions de recherche qui sont co-conçues par les observateurs et les chercheurs- et puis les activités des naturalistes, qui sont généralement regroupés en associations, qui consistent à regrouper leurs données et à essayer de les massifier.
Du coup ce modèle, cette structuration de la collecte de données, de l’amassement de données, a son pendant à toutes les échelles. Par exemple au niveau européen, il y a aussi des initiatives comme ça. Et puis au niveau mondial, on pourrait presque conclure qu’au niveau le plus global par exemple c’est le GBIF : le Global Biodiversity Information Facility, qui est bien là pour collecter tout type de données sur la biodiversité, sur le vivant, et qui remonte, des amateurs éclairés, des professionnels aussi bien sûr, mais tout cela remonte vers le haut, à l’échelle globale.