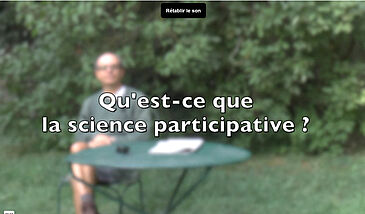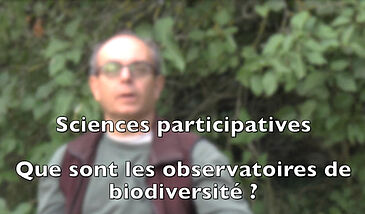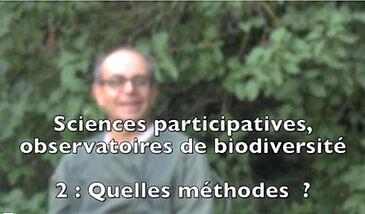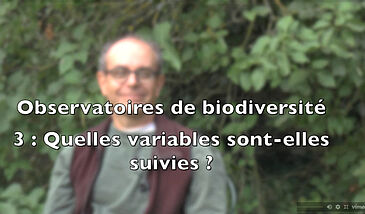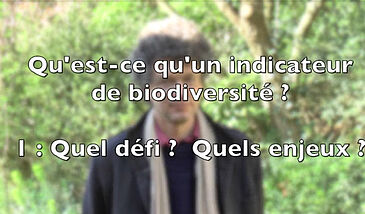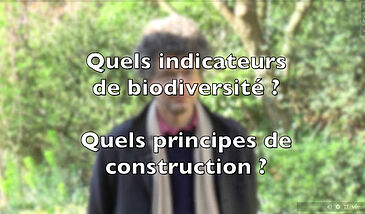En ligne depuis le 04/09/2019
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Denis Couvet, Professeur d'Ecologie au MNHN, pour le projet web Nexus Clés ("SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé"). Url : su-ite.eu/nexus-videos-cles/plan/
[Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique? ]
Conception et coordination de ce projet web, réalisation des vidéos : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Objectifs de Développement Durable
- 15. Vie terrestre
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
COUVET Denis
Les sciences participatives au MNHN : comment et pourquoi ?
Question-clé à Denis Couvet, Professeur au Muséum national d’Histoire naturelle
Exposé transcrit et édité par Anne Teyssèdre, 2019
Il existe toute une tradition des sciences participatives au Muséum, qui sont intimement liés à l’aventure coloniale de la France - puisqu’effectivement lorsque les explorateurs sont partis à la découverte du monde, il leur était demandé de rapporter des échantillons de biodiversité (à l’époque on parlait plutôt de nature, de faune et de flore) auprès du Muséum national d’histoire naturelle. C’est comme cela qu’actuellement, le Muséum national d’histoire naturelle détient l’une des collections les plus importantes aussi bien dans le domaine des plantes que des insectes.
Au-delà de cette longue expérience qu’a été l’aventure coloniale, s’est développé aussi au début du XXe siècle le baguage des oiseaux -baguage qui devait permettre de connaître les routes de migration de l’ensemble de l’avifaune. Ce baguage (coordonné par le Muséum) s’est accompagné d’une gestion d’observatoires participatifs à l’échelle nationale, qui permettait de suivre le déplacement des espèces migrant depuis la Scandinavie jusqu’au sud du Sahara.
Cette longue expérience, qui a en fait permis de collecter des données et gérant de l’ordre de 500 ornithologues, bagueurs, finalement a donné lieu ensuite à des observatoires, des observatoires qui se sont focalisés sur d’autres questions telles que les aires de distribution des espèces. Donc là nous avons tout un ensemble d’atlas de la biodiversité qui se sont développés sous l’égide du Muséum. Celui-ci animait un réseau d’observateurs qui permettait de savoir quelles étaient les aires de distribution des amphibiens, des chiroptères, de tout un ensemble d’espèces.
Et puis, au-delà de ces atlas de biodiversité, se sont finalement développés des suivis de biodiversité. Une des premières expériences a été le suivi temporel des oiseaux communs (STOC) qui s’est développé au début des années 1990. Mais le STOC finalement a perdu un peu de son élan, notamment parce que les données ne donnaient pas lieu a des publications scientifiques de grande envergure. Ce dispositif -ce STOC- a été relancé au début des années 2000, par une nouvelle équipe.
Donc là, l’idée c’est de regarder les variations temporelles des communautés, des communautés d’amphibiens, de chiroptères, d’oiseaux, variations d’abondance finalement de ces espèces. Lorsque l’on a ces données, on peut les corréler à un ensemble de facteurs environnementaux, à des pratiques notamment agricoles, de manière à voir la covariation des pratiques humaines avec les variations d’état de ces communautés. C’est comme cela que l’on a mis en évidence l’impact négatif d’un certain nombre de pratiques agricoles, notamment liées aux pesticides, sur l’état et les variations d’état des communautés d’oiseaux.
Puis, au-delà du STOC, il a été réalisé que cette expérience était très intéressante, et qu’il était sans doute fondamental de l’étendre à d’autres groupes. C’est-à-dire d’élaborer des protocoles simples, qui puissent s’adresser à un maximum d’observateurs, et qui permettent finalement de suivre des communautés d’espèces dans le temps, de regarder les variations d’abondance des espèces et de caractériser les variations d’état de ces communautés. A partir de là s’est développée (la plateforme) Vigie-Nature, qui se veut une généralisation à l’ensemble des groupes systématiques - que ce soit les plantes, les insectes, les mammifères, ...- de l’expérience et du savoir- faire du STOC.