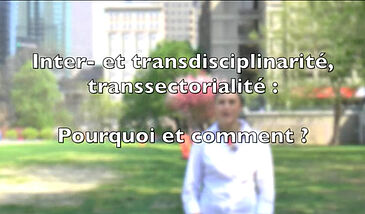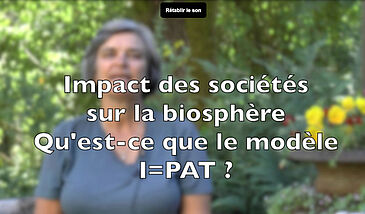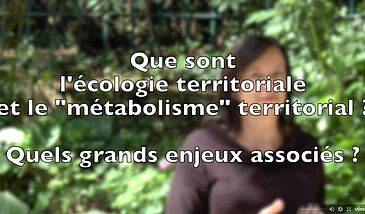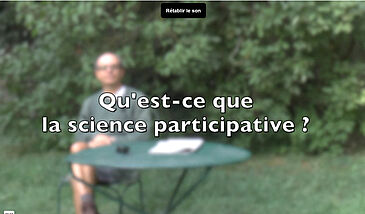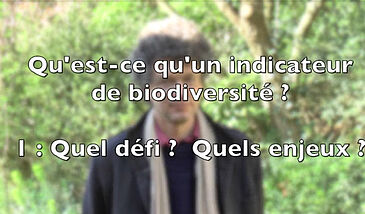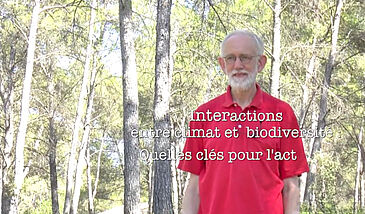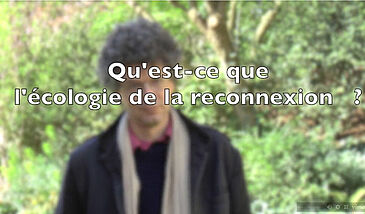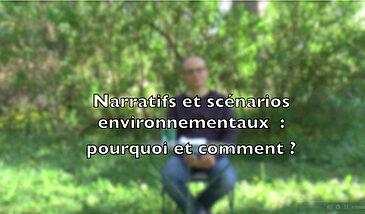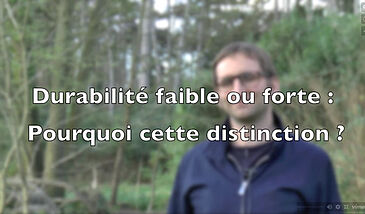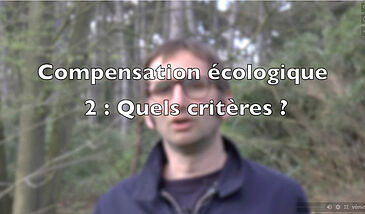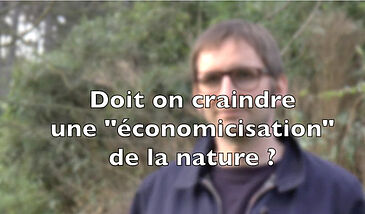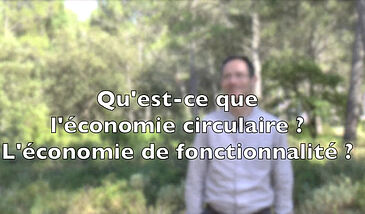En ligne depuis le 26/10/2017
0/5 (0)

Description
Bref historique, principaux arguments et concepts.
Question-clé posée à Harold Levrel, Professeur d'Economie à AgroParisTech.
pour la série vidéo "SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé"
(Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique?)
Conception et réalisation de cette série vidéo : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Economie
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Thèmes
- Finitude des ressources
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Levrel Harold
professeur , AgroParisTech
Harold Levrel, Professeur à AgroParisTech, chercheur au CIRED
Question-clé transcrite et éditée par Anne Teyssèdre
Qu’est-ce que l’économie écologique ?
Pour comprendre ce qu’est l’économie écologique, il faut un petit rappel. La notion d’économie écologique est apparue véritablement au cours des années 1980. Auparavant, on parlait plutôt de bioéconomie. C’est le terme qui était utilisé notamment par Nicholas Georgescu-Roegen [Nicholas Georgescu-Roegen, économiste et mathématicien, 1906-1994], considéré par beaucoup par un des tenants de l’approche de l’économie écologique au 20e siècle.
En fait, cette notion d’économie écologique a été portée par des économistes et des écologues, qui se sont réunis tout au long des années 1980 pour discuter notamment des bilans énergie-matière des systèmes de production économique. Un des précurseurs sur le sujet en France était René Passet [René Passet, Professeur d’économie, 1926- ], qui a repris beaucoup des arguments de Georgescu-Roegen, qui lui-même soulignait que notre système économique était non durable parce qu’il conduisait à une entropie très importante – faisant référence aux travaux sur la thermodynamique – et donc finalement à un gâchis très important au plan énergétique.
Au cours des années 1980, ce diagnostic s’est affiné, avec notamment le recours aux concepts issus de l’écologie scientifique, et avec des penseurs tels qu’Odum [Howard T. Odum, écologue américain, 1924-2002] qui ont eu un rôle très important dans l’émergence de cette discipline. L’idée, c’est –un peu comme le proposait Georgescu-Roegen- de faire des bilans « métaboliques » des systèmes socioéconomiques, des bilans « organiques » (on peut les appeler aussi comme ça) qui montrent comment le système socioéconomique consomme de l’énergie et de la matière, et qu’est-ce qu’il restitue. A partir de là, on peut évaluer les déchets, les émissions, et à la fin faire un bilan éco-énergétique du système.
De ce bilan éco-énergétique, on a pu commencer à entrevoir la possibilité de concevoir des systèmes de comptabilité matière et énergie, qui viennent s’ajouter aux comptabilités standards de type PIB, emplois, qui apportaient donc un regard très différent sur les systèmes socio-économiques, à l’échelle des États notamment, mais aussi de manière plus globale.
Un point central, dans l’économie écologique, concerne les limites de la Planète. A partir des premiers bilans énergétiques que proposaient Georgescu-Roegen, puis René Passet, on a pu commencer à questionner les limites de la Planète au regard du système de croissance économique qui existait et aussi de la croissance démographique. Cela a été le propos du modèle proposé par les époux Meadows, qui au début des années 1970 a été utilisé par le Club de Rome [The Limits to Growth, Rapport Meadows, 1972] pour montrer que notre mode de croissance n’était pas viable. Nous devions faire face, dans les décennies à venir, à un problème de surconsommation, de surproduction, par rapport aux capacités de la Planète.
Alors on est souvent un peu au fait des limites de la Planète à travers des indicateurs qui sont utilisés dans les médias, comme «l’empreinte écologique » : le fait qu’on « consomme un certain nombre de planètes » chaque année, et donc qu’on va avoir une dette écologique qui s’accumule au fil des années, parce que nous consommons beaucoup plus que la Planète peut produire.
Ces éléments, qui proposaient une analyse en termes de limites de la Planète, ont été complétés quelques années plus tard par des approches mobilisant la notion de production primaire. Production primaire de la Planète à travers la transformation de l’énergie solaire en énergie chimique, par les espèces végétales. On a découvert ces dernières années que l’Homme s’appropriait autour de 25% de cette production primaire (HANPP, Human Appropriation of Net Primary Production), ce qui ne laisse pour toutes les autres espèces (hétérotrophes) que 75% de production primaire. C’est un autre élément important quand on veut commencer à évaluer la part de biomasse disponible pour les êtres humains, au regard des autres espèces. En Asie, on est presque à 50% aujourd’hui, ce qui montre que les marges de manœuvre sont beaucoup plus faibles selon les zones géographiques qu’on analyse.
Mais pour aller un petit peu plus loin, et sortir de ces analyses strictement énergie-matière-biomasse, des économistes et des écologues ont commencé à travailler sur les fonctionnalités écologiques et sur leurs liens avec le bien être humain. De là est née la notion de service écosystémique, qui a pour objectif de voir comment les dynamiques associées aux écosystèmes sont favorables à l’Homme non seulement directement, à travers le prélèvement de ressources, mais aussi indirectement, à travers la filtration de l’eau, la filtration de l’air, le renouvellement des espèces, le recyclage des déchets organiques… Par le biais aussi des zones d’activités récréatives, par l’observation de la nature, des zones de promenade, etc.
Petit à petit, on a été sur des diagnostics de plus en plus fins autour des interactions entre dynamiques écologiques et dynamiques économiques. C’est un des propos de l’économie écologique que de travailler sur la description de ces interactions, pour essayer de voir comment peuvent se mettre en place des dynamiques de coévolution entre ces systèmes qui ne soient pas des coévolutions basées sur la destruction, mais plutôt sur les synergies.
Parmi les critères qui permettent d’évaluer la synergie entre les systèmes écologiques et les systèmes économiques, il y a le principe de durabilité qui peut être mobilisé. Pour comprendre comment on peut avoir une véritable « coévolution durable », les économistes ont distingué ce qu’on appelle la durabilité faible et la durabilité forte, la durabilité forte impliquant qu’on ne peut pas substituer du capital naturel par du capital physique. Alors que la durabilité faible, elle, considère qu’on peut substituer du capital naturel par du capital physique tant que la richesse totale pour la population augmente. C’est un élément fondamental qui distingue les économistes écologiques d’autres courants économiques - notamment l’économie de l’environnement- qui postulent qu’on peut avoir des substitutions du moment que la richesse totale augmente.
Le projet de l’économie écologique pour l’avenir est finalement :
- d’appréhender la décision dans toute sa complexité, et notamment les conflits, les négociations autour de politiques publiques, en s’appuyant sur des indicateurs qui vont refléter la diversité des points de vue et qui devraient faciliter les négociations entre acteurs,
- de faire valoir qu’il y a des limites écologiques au système et que donc la production ou la consommation doivent respecter ces limites,
- d’avoir aussi une description de la coévolution des systèmes écologiques et économiques à partir de notions telles que celle de service écosystémique, qui permet de mieux appréhender les synergies et interactions positives entre ces deux systèmes,
- pour in fine opérer des transitions dans le modèle de développement économique tel qu’il existe aujourd’hui, faire quelque chose qui soit logiquement plus durable.