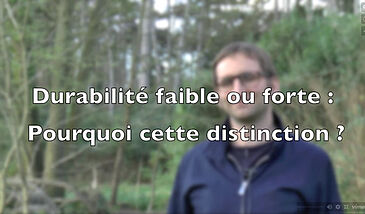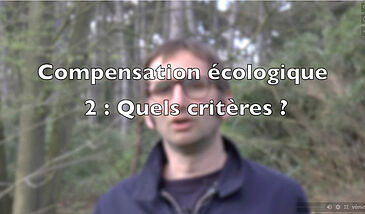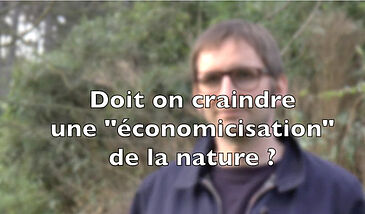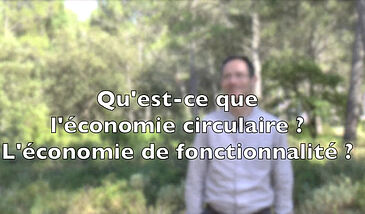En ligne depuis le 27/10/2017
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Harold Levrel, Professeur d'Economie à AgroParisTech pour la série vidéo "SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé"
(Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique?)
Conception et coordination du projet, réalisation de cette série vidéo : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Economie
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Objectifs de Développement Durable
- 15. Vie terrestre
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Levrel Harold
professeur , AgroParisTech
Harold Levrel, Professeur à AgroParisTech, chercheur au CIRED
Question-clé transcrite et éditée par Anne Teyssèdre
Économie écologique vs économie de l’environnement : quelles différences ?
La différence entre l’économie de l’environnement et l’économie écologique repose sur plusieurs aspects. Tout d’abord, l’économie de l’environnement vient de la science économique et a mobilisé l’ensemble du corpus théorique de l’économie. A ce titre, on peut parler d’une véritable approche théorique en économie de l’environnement, avec des axiomes qui sont validés depuis un certain nombre d’années par cette discipline. L’économie écologique ne s’assimile pas à une discipline, contrairement à l’économie de l’environnement.
C’est plutôt un champ de recherche, un courant de pensée. C’est donc assez différent et il est aussi assez artificiel de vouloir les opposer de manière dualiste.
La communauté des économistes écologiques s’est en partie constituée en opposition aux économistes de l’environnement, pour une raison bien simple : les économistes de l’environnement, dont la communauté s’est organisée au fil des années 1970, 1980 et 1990, utilisent les outils économiques pour les appliquer aux questions environnementales, en essayant d’atteindre un objectif d’internalisation des externalités, comme le disent les économistes – les externalités étant les pollutions, les destructions de l’environnement générées par l’activité économique.
Les économistes écologiques adoptent une position différente : ils considèrent que l’idée d’internaliser les externalités est une bonne idée -et de fait, il faut autant que possible le faire - , pour autant, ils soulignent que ce n’est pas parce qu’on procède à une internalisation des externalités qu’on va respecter un principe de durabilité forte, telle que je l’ai définie précédemment. C’est-à-dire qu’on peut avoir malgré tout une érosion du capital naturel et de ses composantes -telles que la biodiversité, le climat, les écosystèmes- et que donc il faut aller plus loin que le projet de l’économie de l’environnement.
L’un des éléments qu’on mobilise quand on s’intéresse à l’économie écologique est l’idée de cercles concentriques. On aurait à l’extérieur la biosphère, à l’intérieur de ce premier cercle le système social, et enfin le système économique. Et le système économique finalement n’aurait qu’un rôle instrumental, au service de la société, qui elle-même devrait se contraindre à des limites biophysiques.
Dans le contexte de l’écologie de l’environnement, la logique est un peu différente. On a le système économique qui domine, dans le sens où on mobilise ses outils, son cadre de pensée, ses concepts normatifs, qui vont s’appliquer au système social parce que l’économie prétend proposer des optimums économiques et de bien-être, donc un projet totalisant ; et ce système social lui-même va utiliser le capital naturel comme une ressource parmi d’autres.
Donc on constate une vision très différente entre ce que propose l’économie écologique et ce que propose l’économie de l’environnement.
L’économie écologique, par son projet, mobilise évidemment des outils qui sont très différents, notamment des outils interdisciplinaires et transdisciplinaires s’inspirant (notamment) des méthodes de l’écologie scientifique.
Il y a un gradient, on peut dire, entre une économie écologique qui serait très écocentrée jusqu’à une économie de l’environnement totalement anthropocentrée, et entre les deux, finalement, on trouve des économistes de l’environnement qui vont mobiliser des outils de l’économie écologique pour traiter leurs questions, et des économistes écologiques qui vont utiliser par exemple des évaluations monétaires, plutôt issus de l’économie de l’environnement. Fondamentalement, l’opposition qui était avancée il y a quelques années tend à se réduire aujourd’hui, et à se complexifier aussi, notamment parce que l’économie écologique est devenue un champ de recherche très large, mobilisant de nombreux courants de pensée.
L’économie écologique a par ailleurs comme particularité, par rapport à l’économie de l’environnement, d’inscrire son analyse dans un contexte de pluralité des systèmes de valeurs.
C’est-à-dire que, en économie de l’environnement, on va avoir une logique d’optimisation à partir de la modélisation d’agents rationnels, représentatifs ; alors qu’en économie écologique on ne prétend pas trop modéliser les comportements des agents, ils sont plutôt exogènes à l’analyse, c’est-à-dire qu’on va produire des outils d’évaluation qui vont après être utilisés par les décideurs. On ne modélise pas directement le comportement des acteurs ou décideurs.
Donc on va avoir des approches souvent multicritères, outils qui vont croiser des indicateurs monétaires, écologiques, sociaux, donc relativement divers, sans prétention à un objectif d’optimum, que l’on va mettre à disposition d’acteurs, si possible dans des contextes de négociation ou de décision spécifiques – l’idée étant que l’outil corresponde aux besoins de ces acteurs ou décideurs, pour que ces indicateurs reflètent au mieux les systèmes de valeur des acteurs qui vont s’en emparer.
De ce point de vue là, le projet de recherche pour les années à venir de l’économie écologique s’inscrit dans une logique à la fois participative, avec une diversité d’outils d’analyse et une vision fondamentalement systémique des problèmes. C’est sans doute cela qui distingue le plus l’économie écologique d’autres courants, comme l’économie de l’environnement notamment.