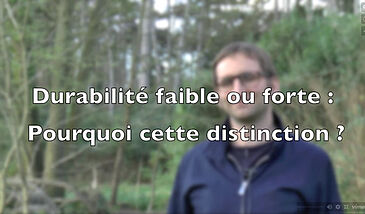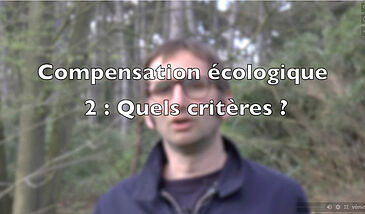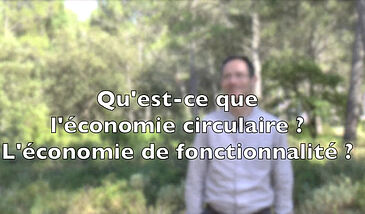En ligne depuis le 06/11/2017
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Harold Levrel, Professeur d'Economie à AgroParisTech pour la série vidéo "SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé"
(Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique?)
Conception et coordination du projet, réalisation de cette série vidéo : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Economie
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Objectifs de Développement Durable
- 15. Vie terrestre
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Levrel Harold
professeur , AgroParisTech
Harold Levrel, Professeur à AgroParisTech, chercheur au CIRED
Question-clé transcrite et éditée par Anne Teyssèdre
Doit-on craindre une « économicisation » de la nature ?
Une économie de la nature, cela peut renvoyer à beaucoup de choses. Le simple fait d’utiliser un lexique ayant une connotation économique peut être une forme d’économie de la nature.
Par exemple, le recours à la notion de service écosystémique, qui traduit les fonctions écologiques en services pour l’Homme. Le fait aussi de vouloir donner un prix à la nature, de la monétariser – quand on essaye d’estimer les services écosystémiques en termes d’équivalence monétaire ; c’est-à-dire qu’on ne les renseigne plus uniquement en termes biophysiques, mais on va leur donner une valeur monétaire, par différentes méthodes.
Une étape supplémentaire autour de l’économie de la nature, c’est de chercher à privatiser les composantes de la nature. On peut, par exemple, vouloir accaparer des territoires à travers des logiques de concessions privées, sur des forêts, sur des espaces provenant du domaine public, et là, de fait, il y a des formes de privatisation.
On a une économie de la nature, aussi, autour de la marchandisation de la nature. Le développement de marchés associés à des composantes de la biodiversité, évidemment, renvoie à ce qu’on peut appeler une marchandisation de la nature – on pense par exemple aux crédits de compensation qui peuvent être vendus sur un marché.
En fait, ces phénomènes sont très différents les uns des autres, et ils ne sont pas forcément liés. On peut avoir par exemple des marchés de compensation qui ne vont pas du tout utiliser des unités de services écosystémiques. De la même manière, on peut faire de la monétarisation de la nature sans passer par la notion de service écosystémique. Et cette monétarisation n’amènera pas forcément à la privatisation ou à la marchandisation du vivant.
Une monétarisation peut être utilisée pour de la planification publique. Donc il est important de distinguer ce qu’on entend par « économie de la nature » - parce que tous ces phénomènes sont très différents et n’ont pas du tout les mêmes conséquences.
Alors il y a beaucoup de peurs autour de cette « mise en économie » de la nature, peurs qui sont légitimes parce qu’on voit certaines dérives économiques pouvant générer des effets très négatifs sur les objets dont elle s’empare. Mais il faut aussi souligner que le fait d’utiliser des mécanismes économiques pour gérer la nature n’est pas nouveau.
Un premier élément, quand on parle d’économie de la nature, ce sont les ressources qu’on utilise directement, pour se nourrir, pour construire des maisons en bois… On a de fait une dépendance par rapport à toutes les composantes de la nature pour assouvir ses besoins.
Mais la critique qu’on formule à l’égard de la mise en économie de la nature dans son ensemble, c’est plutôt quelque chose qui s’étendrait à la biodiversité dans son ensemble, et finalement à des choses qui auparavant n’étaient pas du tout concernées par l’économie. Contrairement à ce que l’on pense, ce n’est pas si nouveau.
La spéculation sur les écosystèmes naturels existe depuis très longtemps – on retrouve des traces au Moyen-Âge de spéculation sur les zones humides, pour les assécher, parce que tout simplement il y avait une fiscalité incitative de la part du roi, qui visait à ce qu’on assèche le maximum d’espaces naturels.
De la même manière, la notion de service écosystémique, qu’on croit très nouvelle : on en trouve des traces tout au long de l’Histoire. Un exemple est celui de l’économie ornithologique du 19e siècle, qui proposait une évaluation des oiseaux à partir des services qu’ils rendaient aux agriculteurs. Il y avait d’ailleurs, au sein du Département de l’Agriculture américain, une division d’économie ornithologique qui visait à recenser les oiseaux utiles et les oiseaux néfastes, notamment à partir de l’analyse des contenus stomacaux. Donc on était très proche de cette notion de services écosystémiques, qui d’ailleurs étaient évalués à partir de critères monétaires – on estimait combien cela rapportait aux agriculteurs de bénéficier des services des oiseaux. Bref, tout ça n’est pas forcément nouveau.
Certes, la mise en économie de la nature n’est pas nouvelle – on le voit, il y a eu des précédents pour les services écosystémiques, pour la monétarisation, mais qu’en est-il aujourd’hui ?
En fait, il y a clairement des phénomènes d’appropriation du vivant qui n’existaient pas auparavant – On peut penser aux gènes, on peut penser aux semences, on peut penser aux concessions qu’on développe sur les forêts, sur les stocks de pêche, de par le monde. Mais il y a aussi des sorties de l’économie de certaines composantes de la nature. On peut penser par exemple, dans le domaine du droit, au développement depuis quelques années de servitudes environnementales.
Aux Etats-Unis, par exemple, les servitudes environnementales qui sont apparues dans les années 1980 sont très utilisées par les politiques publiques pour donner des incitations aux agriculteurs à ne plus utiliser une partie de leur terrain. Alors, comment est-ce qu’ils procèdent ? Ils proposent aux agriculteurs de les indemniser pour qu’ils renoncent à 5, 10% de leurs champs, qui correspondent à des prairies humides sur lesquelles il n’y aura pas d’assèchement, sur lesquelles il n’y aura pas d’usage dégradant, et pour cela ils doivent appliquer une servitude environnementale.
La particularité de ces servitudes environnementales, c’est qu’elles définissent une finalité environnementale pour ce terrain de manière définitive. Et y compris si l’agriculteur veut vendre son terrain - le propriétaire suivant devra respecter cette servitude environnementale, c’est définitif.
Parfois on se trompe quand on croit que certains outils économiques génèrent la privatisation du vivant. Quand on pense aux banques de compensation américaines, c’est souvent pour dire « Voila un exemple de dérive très important en matière de mise en économie de la nature ». Pour autant ces banques de compensation, qui sont plutôt de grandes réserves visant à la compensation, qui ont pour objectif de mutualiser les effets de restauration écologique sur de plus grandes surfaces, finalement, elles ont aussi pour particularité de faire sortir des composantes de la biodiversité du système économique, de manière assez inattendue.