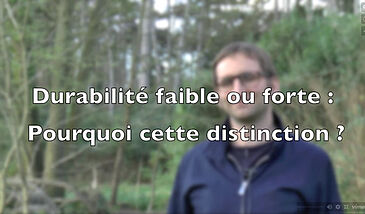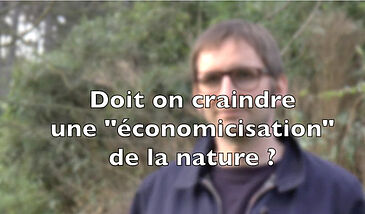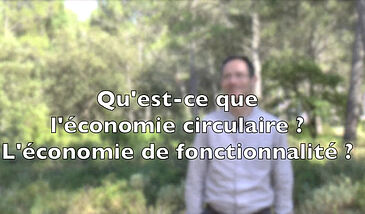En ligne depuis le 10/10/2017
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Harold Levrel, Professeur d'Economie à AgroParisTech pour la série vidéo "SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé"
(Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique?)
Conception et coordination du projet, réalisation de cette série vidéo : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Objectifs de Développement Durable
- 15. Vie terrestre
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Levrel Harold
professeur , AgroParisTech
Harold Levrel, Professeur à AgroParisTech, chercheur au CIRED
Question-clé transcrite et éditée par Anne Teyssèdre
Compensation écologique – Quels critères de mise en œuvre ?
Une fois qu’on a dit ça, la question essentielle est de savoir ce qu’est une bonne compensation écologique. Dans l’absolu, c’est un outil comme un autre, et comme souvent il peut être utilisé de manière intéressante ou au contraire de manière complètement négative pour l’environnement.
Plusieurs critères permettent de qualifier une bonne compensation écologique. Le premier, c’est la faisabilité écologique : est-ce qu’on sait restaurer un écosystème qui a été détruit ? La deuxième condition, c’est l’additionnalité : comment peut-on démontrer les gains écologiques, liés à l’action de compensation ? La troisième, c’est la pérennisation de la compensation: si on doit avoir une destruction de l’écosystème juste après la compensation, évidemment, la pérennisation n’est pas garantie. Et la quatrième concerne l’équivalence
écologique: comment mesure-t-on l’équivalence entre ce qui a été détruit, d’une part, et ce qui est compensé, d’autre part ?
On peut considérer qu’une compensation écologique a du sens à partir du moment déjà où on a évalué la faisabilité de cette compensation : est-ce qu’on sait restaurer l’écosystème pour lequel on a observé une destruction? Il y a des écosystèmes pour lesquels il est évident qu’on ne saura pas faire de compensation. Si on prend une tourbière qui a une histoire écologique de plusieurs centaines d’années, on ne peut pas prétendre compenser cet écosystème après destruction. En revanche, s’il s’agit d’une prairie humide je dirais classique, on peut être en capacité de restaurer ailleurs, sur un espace qui a été dégradé, une prairie humide. Donc, encore une fois, il y a un enjeu très fort autour de ce principe de faisabilité écologique, et c’est ce qui nous amène souvent à souligner qu’il faut évaluer une sorte de frontière de la
compensation, qui fixerait ce qu’on sait faire et ce qu’on ne sait pas faire.
Une fois qu’on a fixé cette frontière, il faut aussi pouvoir évaluer un principe qu’on appelle l’additionnalité. En fait, cette additionnalité doit être évaluée au regard des gains écologiques qu’on a pu estimer à travers une restauration écologique. Si on mène un projet de compensation qui ne démontre pas cette additionnait écologique, alors on ne peut pas prétendre à avoir compensé quoi que ce soit.
Ce type de raisonnement est essentiel quand on s’appuie notamment sur des démarches contractuelles, visant par exemple à indemniser un agriculteur pour qu’il améliore ses pratiques agronomiques - par exemple en plantant des haies, en (re)mettant en eau certaines zones de ses champs pour restaurer des zones humides- il faut être en capacité d’évaluer le gain réellement généré par ces nouvelles actions, et en quoi ces nouvelles actions ont été mises en œuvre grâce à a compensation. Elles n’ont pas été réalisées, par exemple, parce qu’il a adhéré à des mesures agro-environnementales au titre de la PAC, ou tout simplement parce qu’il avait prévu de faire ces changements de pratiques sur son terrain. C’est très difficile parfois d’évaluer l’additionnalité, et c’est pourtant un des éléments essentiels pour pouvoir
établir une équivalence au regard de la compensation écologique.
La pérennisation des actions de compensation est aussi un enjeu majeur. En effet, on a de plus en plus recours à des contrats, avec des acteurs qui ont des prérogatives en termes de gestion et d’aménagement du territoire. Par exemple avec des agriculteurs, mais aussi avec des conservatoires d’espaces naturels, avec l’Office National des Forêts, etc.
Quand l’acteur a une finalité environnementale, on peut penser que la pérennité est garantie, notamment parce que le domaine sur lequel il travaille est souvent un domaine public. Quand en revanche il s’agit de contrats qui s’établissent avec des acteurs privés, par exemple des agriculteurs, la question de la pérennité est posée. En effet, on va établir des contrats qui peuvent avoir une durée de cinq ans, dix ans, parfois vingt ans. Pour autant, qu’est-ce qui nous garantit qu’à la fin de ce contrat l’agriculteur ne décidera pas de changer de nouveau de pratique et de revenir à des activités intensives ? Si l’impact sur lequel il a travaillé en tant qu’acteur de la compensation dure ce même laps de temps, ce n’est pas un problème: si effectivement l’impact ne dure que 5 ans, 10 ans ou 20 ans, il y a une cohérence à avoir un contrat de compensation de même durée. On peut penser par exemple aux concessions : les concessions sont à durée déterminée, donc leur impact est pour une durée déterminée.
Mais, malheureusement, la plupart des impacts sont définitifs - on pense à l’urbanisation, on pense au développement routier ou des lignes à grande vitesse. Donc dans ce cadre là, évidemment, le système contractuel pose question. Une innovation récente sur le sujet est la création, dans la nouvelle loi sur la reconquête de la biodiversité, des obligations réelles environnementales.
Ces obligations réelles environnementales, qui sont des systèmes contractuels volontaires, permettent de créer une forme de servitude environnementale sur les terrains qui les ont adoptées, et donc d’être transmises au propriétaire suivant. Évidemment, là encore, la question de la durée sur laquelle cette obligation réelle environnementale va être appliquée doit être posée.
Le dernier point pour établir les critères d’une bonne compensation écologique, c’est celui de l’équivalence écologique. En effet, qui dit compensation dit une forme d’équivalence, entre ce qui est gagné d’un côté par la compensation et ce qui a été perdu d’autre part par l’impact.
Établir les outils qui permettent de mesurer cette équivalence n’a rien d’évident puisque, quand on détruit un écosystème, il y a évidemment différentes composantes qui sont à prendre en compte : la végétation, bien évidemment, les populations animales, et puis les fonctionnalités écologiques qui s’expriment au sein de cet écosystème.
On a aujourd’hui de plus en plus d’outils qui tentent, à travers des indicateurs, de mesurer de manière harmonisée ce qui est détruit d’une part et ce qui est restauré de l’autre. En France, un des problèmes que l’on rencontre, c’est qu’il n’existe pas d’outil qui soit considéré comme pertinent ou légitime auprès de l’administration et des scientifiques, et qui permette de rendre un peu plus objectives les actions en matière de compensation. C’est un des enjeux clés pour les années à venir que d’être en capacité de construire des outils un peu plus harmonisés à l’échelle nationale.
Évidemment, il ne s’agira pas d’utiliser le même outil pour travailler sur la compensation quand on fait de la restauration de communautés animales ou de communautés végétales, au titre de la loi sur l’eau ou au titre de Natura 2000, mais pour autant, on pourrait avoir des outils qui aient un caractère assez générique et qui évidemment seraient adaptés à la spécificité des contextes législatifs et écosystémiques.