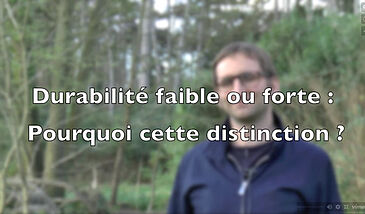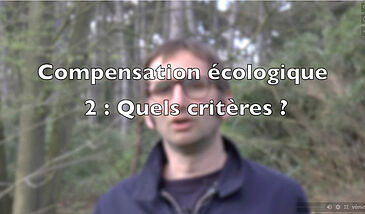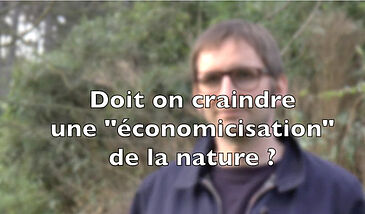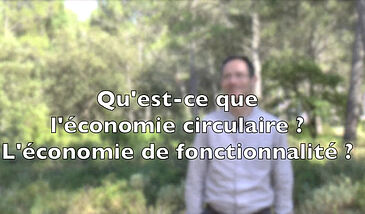En ligne depuis le 07/11/2017
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Harold Levrel, Professeur d'Economie à AgroParisTech pour la série vidéo "SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé"
(Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique?)
Conception et coordination du projet, réalisation de cette série vidéo : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Droit
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Levrel Harold
professeur , AgroParisTech
Harold Levrel, Professeur à AgroParisTech, chercheur au CIRED
Question-clé transcrite et éditée par Anne Teyssèdre
Compensation écologique – Quel principe ? Quel cadre d’application ?
La compensation écologique, c’est un concept qui a connu ces dernières années un regain d’intérêt parce qu’on l’a utilisé de plus en plus, à la fois dans le cadre réglementaire et dans le cadre volontaire. Dans le cadre volontaire, on parle parfois de « compensation Carbone », qui vise à planter des forêts à l’autre bout de la planète pour compenser des dépenses d’énergie qu’on aurait en Europe, par exemple.
C’est un cas très particulier et qui s’apparente parfois à des pratiques très « marketing ».
Dans le domaine réglementaire, les obligations de compensation sont liées à des lois en faveur de l’environnement, adoptées depuis un certain nombre d’années. On peut distinguer deux cadres. Celui des dommages accidentels -par exemple lorsqu’on a une marée noire ou la pollution d’une rivière par le déversement de produits toxiques: dans ce cas s’applique la Loi pour la Responsabilité Environnementale en France, qui nous dit qu’on doit évidemment restaurer sur le site où l’impact a eu lieu, mais aussi qu’on doit réaliser des compensations écologiques correspondant aux dommages temporels associés à la pollution.
En effet, le cours d’eau qui aura été pollué mettra quelques années avant de retrouver l’état dans lequel il était avant la pollution. Dès lors, il doit y avoir un travail de compensation écologique, qui en fait renvoie au principe de préjudice écologique, c’est-à-dire qu’on considère que la nature a subi un préjudice pour elle-même, et donc il faut pouvoir faire une action pour la nature sur un autre site (assez proche de celui où l’impact a eu lieu).
Par exemple, en amont ou en aval du site qui a été pollué, on va renaturaliser des berges, on va réintroduire des espèces, et donc on va participer à un travail de restauration écologique.
L’idée est que ce travail de restauration va compenser les pertes temporelles de fonctionnalités écologiques sur la zone qui a été dégradée, et qui a donc mis un certain temps pour retrouver ses fonctions.
Cela, c’est dans le cadre des dommages accidentels. Mais on a aussi recours à la notion de compensation dans le cadre des dommages autorisés et c’est sans doute dans ce cadre là qu’on en parle le plus.
La compensation écologique dans le cadre des dommages autorisés, cela fait partie de la séquence qu’on appelle « Éviter, Réduire, Compenser ». Le principe est le suivant: quand vous avez un impact lié à un aménagement, on va vous demander tout d’abord de l’éviter au maximum, en contournant éventuellement la zone d’impact ; on va vous demander aussi de réduire votre impact - par exemple, si c’est une route, en mettant des pilotis qui vont permettre de « survoler » la zone de l’impact ; et puis, comme il y aura malgré tout des impacts résiduels, on va vous demander de faire une compensation écologique pour ces impacts résiduels.
Alors soulignons que, dans cette séquence, nous n’assimilons pas l’évitement au renoncement. Or, on peut tout à fait imaginer que l’on puisse renoncer à un projet si les impacts que génère ce projet ne sont pas évitables, réductibles ou compensables.
Lorsqu’on parle de compensation écologique, on a parfois une réaction qui est de dire « on va compenser pour détruire, donc c’est un simple droit à détruire ». On peut nuancer ce propos parce que certes on va demander une autorisation pour détruire, et cette autorisation sera dépendante d’un travail de compensation écologique réalisé ailleurs, et à ce titre on pourrait considérer que c’est bien un droit à détruire, mais d’un autre côté, pendant très longtemps on n’a jamais eu « besoin » de compenser les destructions que l’on générait à travers ces activités. De compensation écologique, il n’était jamais question. On parlait de compensation monétaire, pour les personnes qui subissaient un préjudice suite à la destruction d’un écosystème, mais le fait de donner un droit à la nature, à être compensée pour elle-même, n’existait pas. Donc de ce point de vue là, on peut considérer que c’est un droit à la nature qui est donné à travers ce principe de compensation écologique.