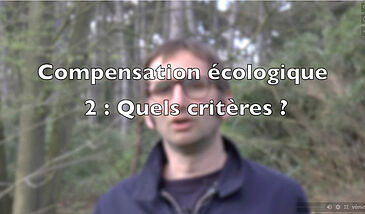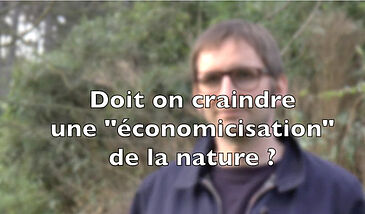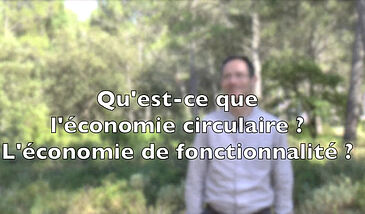En ligne depuis le 08/10/2017
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Harold Levrel, Professeur d'Economie à AgroParisTech.
pour la série vidéo "SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé"
(Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique?)
Conception et réalisation de cette série vidéo : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Economie
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
- Éthique et responsabilité environnementale
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Levrel Harold
professeur , AgroParisTech
Harold Levrel, Professeur à AgroParisTech, chercheur au CIRED
Question-clé transcrite et éditée par Anne Teyssèdre
Durabilité forte, ou faible – Pourquoi ces concepts ?
La durabilité est un concept qui est apparu suite au fait que le principe de développement durable a perdu de sa pertinence et de sa « performativité » depuis l’avènement de ce concept, au cours des années 1980. Finalement, un certain nombre d’économistes ont suggéré qu’avoir un raisonnement en termes de durabilité était insuffisant. Insuffisant parce qu’on prévoyait que pour les générations futures on puisse avoir quelque chose de durable, à partir du moment où ces générations avaient autant de richesse que celles d’aujourd’hui. Ce qui impliquait par exemple de pouvoir substituer des formes de capitaux naturels -tels que des forêts- par du capital physique - une usine, une route - tant que la richesse totale pour la population visée - les générations futures - reste constante.
Ceci est apparu comme problématique, pour des raisons à la fois éthiques - est-ce qu’on peut détruire la nature et la remplacer par du capital physique sans que cela pose des problèmes moraux à la société ?- mais cela a aussi questionné, pour des raisons pratiques, la durabilité.
En effet, si l’on cherche à distinguer la durabilité forte et la durabilité faible, c’est d’abord parce que le concept de durabilité en lui-même est assez mou (quelque part). On a un critère, celui qui date du Rapport Brundtland [Rapport Brundtland sur Développement et Environnement (Our common future, 1987], qui est de dire que l’on doit maintenir le bien-être des générations futures ; mais ce bien-être est évalué à l’aulne d’un indicateur économique assez classique tel que le PIB, et pour maintenir ce PIB on peut finalement investir dans du capital naturel, du capital physique ou du capital humain. Ces différents types de capitaux ne sont pas très importants pour évaluer la durabilité d’un système au regard du critère de durabilité défini dans le Rapport Brundtland - puisqu’on peut avoir substitution du capital naturel par du capital physique, une forêt par du bâti, ou des routes, du moment que le niveau de richesse ne décroît pas.
D’un point de vue conceptuel, on a cherché à distinguer la durabilité forte de la durabilité faible par rapport à ça: la durabilité faible est basée sur le principe qu’on peut substituer les différentes formes de capitaux tandis que la durabilité forte, elle, considère que cette substitution a des limites, en particulier pour ce qui concerne le capital naturel.
On ne doit pas, pour des raisons à la fois éthiques et techniques, considérer comme substituable le capital naturel dans son ensemble. Pour des raisons éthiques tout d’abord, parce qu’il n’est pas forcément considéré comme moral de remplacer du capital naturel par du capital physique, et puis pour des raisons techniques, parce qu’en dessous d’un certain niveau de capital naturel, on prend le risque de voir s’effondrer le système dans son ensemble. On a des exemples d’écosystèmes, comme les lacs par exemple, qui sont très vulnérables à des changements importants comme les apports chimiques, ou aux changements d’usage en termes d’exploitation des ressources, qui peuvent basculer dans un système d’équilibre complètement différents si on passe en dessus d’un certain niveau de capital naturel; donc on parle parfois de capital naturel critique.
Tout cela a amené les économistes à développer un concept qu’on appelle le principe de durabilité forte, qui insiste sur le fait qu’on ne peut pas substituer du capital naturel par du capital physique.
Alors, cela peut paraître logique d’établir un principe de cette nature pour prendre en compte la nature de manière plus pertinente dans les systèmes économiques actuels, pour autant ce n’est pas évident de voir comment on peut mettre en œuvre le respect d’un principe de durabilité forte. Ceci pour la raison bien simple qu’une fois qu’on a dit que la nature n’était pas substituable par du capital physique, on peut admettre en revanche que, dans le capital naturel, il puisse y avoir différentes composantes de ce capital qui sont substituables entre elles. Par exemple, on pourrait admettre que l’on puisse substituer la destruction d’une forêt par la construction sur ce même site d’une zone humide, parce qu’on pourrait avoir des activités humaines sur cet espace ou parce que cela permet de filtrer l’eau utile à une ville en contrebas.
Cela pose évidemment des questions éthiques, écologiques aussi, très importantes. Une manière de répondre à cet enjeu autour de ce qu’on peut substituer dans le cadre d’une durabilité forte, finalement, c’est d’avoir recours à la règlementation. La règlementation offre des normes pour qualifier le bon état écologique de certains écosystèmes, comme la Directive Cadre sur l’Eau (Directive européenne Cadre sur l’Eau, 2001) par exemple, ou la nouvelle Loi sur la Biodiversité (Loi de Reconquête de la Biodiversité, 2016) qui mentionne qu’on doit avoir une absence de perte nette de biodiversité dans le cadre de la séquence « Éviter, Réduire, Compenser » (Séquence ERC : Éviter, Réduire, Compenser), appliquée à l’occasion des études d’impact des projets.