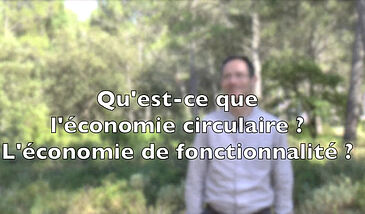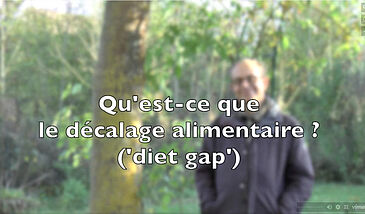En ligne depuis le 21/08/2017
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Florence Habets, hydrométéorologue, Directrice de recherche CNRS au METIS, Université Pierre et Marie Curie, Paris, pour la série vidéo "SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé"
(Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique?)
Conception et réalisation de cette série vidéo : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Habets Florence
hydrométéorologue, Directrice de recherche CNRS au METIS
Florence Habets, hydrométéorologue, Directrice de recherche au METIS
Question-clé transcrite et éditée par Anne Teyssèdre
Eau virtuelle, empreinte hydrologique – Comment et pourquoi ces concepts ?
L’eau virtuelle, c’est la quantité d’eau qu’il faut pour fabriquer quelque chose. On conçoit très bien cela pour des fruits et légumes par exemple, je crois qu’un kilo de tomates ça consomme 10 à 15 litres d’eau, quelque chose comme ça. Mais cela peut se considérer aussi pour d’autres choses. Par exemple, le poulet mange aussi de la nourriture, et du coup, quand la poule pond un œuf, on peut considérer que cet œuf est associé à une certaine quantité d’eau –pour un œuf, je crois que c’est dans les 40 litres d’eau. Et pour un bœuf, un kilo de bœuf, c’est de l’ordre de dizaines de milliers de litres d’eau, je crois que c’est à peu près l’ordre de grandeur. Et donc, tout ce qu’on produit peut se rapporter à un équivalent en eau.
Alors pourquoi considère-t-on cela ? C’est en fait parce que cela permet de se rendre compte qu’en faisant du commerce international, en plus de consommer des matières premières, et bien on consomme également de l’eau qui a été utilisée pour fabriquer cette matière. Par exemple, lorsqu’on importe des oranges du Maroc, il faut bien se rendre compte qu’on importe de l’eau, du Maroc, en même temps que l’orange.
Cela permet de se rendre compte un petit peu des échanges internationaux en termes d’eau. Actuellement on constate que la majorité des pays qui sont ‘riches en eau’ exportent massivement leurs productions (avec l’eau dedans), mais il y a quelques pays qui sont assez pauvres en eau et qui exportent finalement beaucoup de cette quantité d’eau à l’extérieur.
Et donc là on a quelque chose qui est assez antagoniste, qui n’est pas très équilibré et qui pourrait poser problème. Je crois que la Thaïlande et l’Inde exportent beaucoup de productions agricoles qui contiennent beaucoup d’eau (virtuelle).
C’est vrai aussi pour les produits comme les jeans, qui sont faits en coton, ou le papier bien sûr, qui est une production du bois. Tous ces produits là peuvent être exprimés en quantités d’eau associées à cette matière.
Avec l’eau virtuelle, on peut estimer une empreinte hydrologique, qui serait en gros la quantité d’eau que consomme un citoyen quelque part, et qui donc serait l’addition de toutes les formes d’eau qu’il consomme, que ce soit l’eau potable, bien sûr l’eau associée aux aliments, mais aussi l’eau associée à l’énergie ou aux vêtements que la personne consomme. Donc ça, cela fait une empreinte hydrologique, et on peut ensuite comparer l’empreinte hydrologique d’habitants de différents pays du monde. Et c’est là qu’on se rend compte qu’en France on fait partie des endroits où on a pas mal de ressources en eau, en tout cas virtuelle. On fait partie des pays où les gens ont une empreinte hydrologique supérieure à la moyenne.