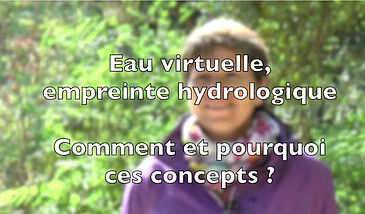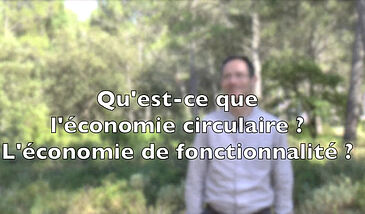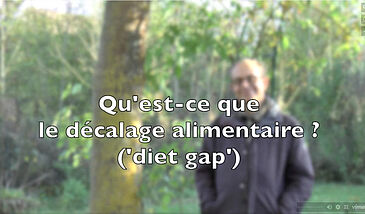En ligne depuis le 10/08/2017
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Luc Abbadie, Professeur d'Ecologie à l'Université P. et M. Curie, Directeur de l'Institut d'Ecologie pour la série vidéo "SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé"
(Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique?)
Conception et réalisation de cette série vidéo : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Sciences de la vie
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Objectifs de Développement Durable
- 15. Vie terrestre
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Abbadie Luc
professeur émérite , Sorbonne Université
Luc Abbadie, professeur d’Écologie à Sorbonne Université Sciences
Question-clé transcrite et éditée par Anne Teyssèdre
Structure et dynamique des sols : Quelles implications pour l’agriculture ?
Beaucoup de sols sont très dépendants de la dynamique de la végétation. Si je caricature un tout petit peu, vous avez finalement deux grands types de sols dans le monde. Vous avez des sols qui contiennent de l’argile, du bon argile, et quand on a de l’argile on peut établir des liaison assez robustes entre ces argiles, donc en fait entre la partie minérale du sol et la matière organique du sol. Et ces liaisons font que (je ne vais pas rentrer dans les détails) l’activité enzymatique -d’origine biologique- est très faible, et donc cette matière organique est stabilisée pour un temps long. C’est pour ça que, dans un sol argileux, vous pouvez mesurer des âges de matière organique qui dépassent mille ans par exemple, ce n’est pas un problème. Cela montre que cette matière organique est très stabilisée. Donc les argiles confèrent un potentiel d’activité physique d’accumulation de la matière organique des sols.
Dans des sols sableux -c’est le cas en Amazonie, c’est le cas dans beaucoup de régions en Afrique, pour des raisons pédogénétiques à long terme -, vous n’avez pas cette capacité physique d’accumulation de la matière organique. Et là, du coup, la teneur de la matière organique du sol, et finalement la stabilité de la matière organique du sol, dépendent totalement de la dynamique de la végétation. Sur un sol sableux, si vous mettez en place une végétation, vous pouvez avoir une multiplication par deux ou par trois, finalement très rapide, du stock de matière organique. Mais en fait, c’est un faux stock en quelque sorte. C’est une espèce de flux, il y a un flux massif de composés organiques qui rentrent dans le sol, qui ont tendance à augmenter le niveau de matière organique, sachant que le flux sortant est massif aussi. Donc c’est en fait un processus complètement dynamique, ce qui veut dire que dès que vous réduisez l’intensité de la production végétale, vous réduisez l’entrée de carbone dans le sol et donc vous réduisez votre stock.
Donc un sol sableux peut accumuler beaucoup de carbone, à condition que vous ayez la gestion adéquate de la couverture végétale. Quand on déforeste en Amazonie, outre le CO2 qu’on émet, outre la perte de biodiversité, et bien en fait on crée un tas de sable, puisque la dynamique de la matière organique dans ce type de sol est complètement liée à la dynamique de la végétation, et ça on a tendance à l’oublier.
Or que fait-on en Amazonie ? Et bien on déforeste, on crée des sols agricoles qui tiennent le coup quelques années seulement, puisque la conséquence pratique de ce que je viens de dire c’est qu’il n’y a pas de réserve. Donc le sol, c’est un tas de sable plus ou moins, il va être épuisé très vite, et donc vous avez un sol complètement dégradé. Et aujourd’hui, le grand paradoxe, c’est que pour rétablir la qualité de ces sols, dans de larges régions de l’Amazonie, on replante des graminées – dont certaines d’ailleurs sont d’origine africaine- donc on remet en place une dynamique de la végétation et on commence à recharger le sol et à lui redonner une valeur biologique, éventuellement une valeur productive. Cela, c’est un point majeur.
En France, dans les pays tempérés, ce lien entre végétation et sol existe aussi, évidemment.
Mais comme on a une grosse réserve grâce à la capacité physique d’accumulation liée aux argiles, les variations sont beaucoup plus difficiles à détecter. Mais la mécanique derrière évidemment est la même.
Donc, en clair : un sol sableux, c’est uniquement une dynamique biologique, un sol argileux c’est à la fois une dynamique physique et une dynamique biologique. Il est clair qu’un sol argileux va être beaucoup plus résistant à la dégradation qu’un sol sableux, par exemple.