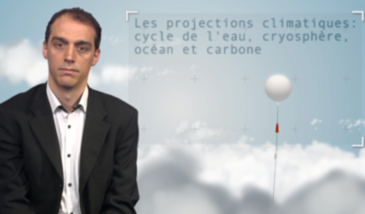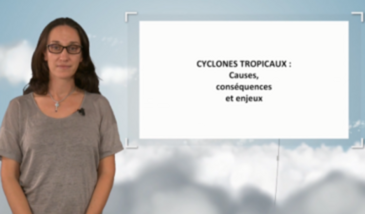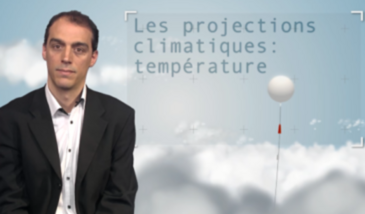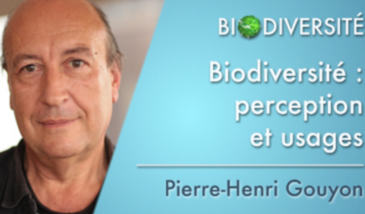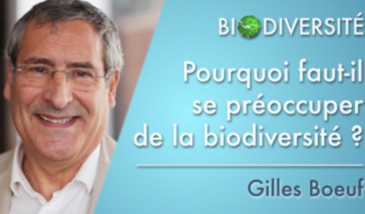En ligne depuis le 04/05/2015
4.5/5 (10)

Description
Bruno David, directeur de recherche au CNRS, revient sur les grandes crises d'extinction de la biodiversité. Il en fait l'inventaire depuis plusieurs centaines de millions d'années et il discute des facteurs qui peuvent en être à l'origine : oxygénation du milieu marin, climat, volcanisme, ou encore météorites. Pour finir, il évoque la situation actuelle et le risque d'une sixième crise d'extinction de la biodiversité.
Objectifs d'apprentissage :
- Appréhender les grandes crises d'extinction de la biodiversité
- Connaître les facteurs qui peuvent en être à l'origine
- Comprendre la situation actuelle et le risque d'une sixième crise d'extinction de la biodiversité.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Mentions Licence
- Sciences de la Terre
- Sciences de la vie
- Sciences de la vie et de la Terre
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
- Les bases
Types
- Grain audiovisuel
Contributeurs
David Bruno
ancien Président , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Ce document est la transcription révisée, chapitrée et illustrée d’une vidéo du MOOC UVED « Biodiversité ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.
Les grandes crises de la biodiversité
Bruno DAVID, Directeur de recherche - CNRS
1. Les crises du passé
Je vais vous parler des crises anciennes qui ont affecté la biosphère depuis 550 millions d'années. Depuis 550 millions d'années, on a eu cinq crises majeures mais également une cinquantaine d'autres crises que l'on peut considérer comme étant plus mineures. Cela fait environ une crise tous les 10 millions d'années ; ceci pour seulement 15 % de l'histoire de la vie puisque ces 550 millions d'années ne représentent que 15 % de l'histoire de la vie. Il y a certainement eu des crises avant mais simplement pour ces crises antérieures, on n'a pas de témoignages parce que le registre sédimentaire ne nous permet pas d'en avoir. Ça signifie que la vie s'est beaucoup adaptée. Ça signifie que l'histoire de la biosphère ça n'a pas été un chemin long et tranquille. Ça a été un chemin long mais pas tranquille du tout depuis 3800 millions d'années. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'une crise nouvelle, une sixième grande crise est annoncée ? Est-ce qu'elle est comparable à celles du passé ? Quelle est la pertinence d'une comparaison passé / présent ? Les ampleurs sont-elles de même ordre ou pas ? Les processus en jeu identiques ou pas ? Et la fragilité de la biosphère d'aujourd'hui comparable ou pas à celle des biosphères du passé ? Pour avoir une réponse à ça, essayons de voir comment les crises anciennes ont pu fonctionner et on va faire un focus sur les cinq crises majeures. Je vous les énumère rapidement, elles sont indiquées dans la colonne de gauche qui est une colonne stratigraphique : la crise à l'Ordovicien supérieur dans une période qui s'appelle l'Hirnancien, la crise au Dévonien à la limite Frasnien-Famennien, la crise qui est la plus importante de toutes au permien supérieur à la limite Permien-Trias, celle au Trias supérieur, à la limite Trias – Jurassique, et la dernière, au Crétacé supérieur qu'on appelle aussi crise K-T à la limite Crétacé tertiaire. Cette dernière est la plus célèbre, celle a vu l'extinction des ammonites et des dinosaures. Sur l'image de droite vous avez des petites flèches rouges qui vous positionnent ces cinq crises sur une courbe qui représente le nombre de familles marines qui ont peuplé la planète depuis le début du primaire jusqu'à l'époque actuelle, l'ancien étant à gauche et le plus récent, l'actuel, étant à droite sur cette image.
2. Étude de ces crises
Ces crises anciennes, à quoi correspondent-elles ? Ce sont autant de cas particuliers. Si on regarde par exemple la distribution des continents, trois crises sont figurées : celle de l'Ordovicien, celle du Permien et celle du Crétacé. On voit que les paléogéographies étaient totalement différentes avec au Permien, par exemple, des continents regroupés en une seule masse alors qu'au contraire au Crétacé ils étaient totalement éclatés. En termes de statisme de niveau marin, on s'aperçoit que la plupart des crises correspondent à des périodes de régression, avec une diminution du niveau marin, une disparition des plates-formes continentales. Une seule, celle du Dévonien, correspond à une transgression.
En termes d'oxygénation des eaux, on a souvent des baisses d'oxygénation des eaux avec des dysoxies voire une anoxie pour celle du Dévonien où les eaux étaient vraiment extrêmement pauvres en oxygène. En termes de climat, qui est toujours le paramètre le plus important et qui impacte le plus la biosphère ou les biosphères, on a des conditions également différentes d'une crise à l'autre. Donc ce ne sont que des cas particuliers. Sur le climat, j'insiste, les épisodes climatiques qui ont marqué les crises sont souvent des alternances chaud/froid ou froid/chaud. C'est ça qui a été le plus déstabilisateur. Quand on a une météorite qui frappe la Terre, ou quand on a un épisode volcanique majeur qui impacte la Terre, qu'est-ce qui se passe ? Il y a d'abord des émissions de particules dans l'atmosphère et dans la haute atmosphère qui obscurcissent un petit peu la planète, même beaucoup la planète. On a une sorte d'hiver nucléaire ou de nuit en quelque sorte et à ce moment-là la Terre se refroidit, la surface de la planète se refroidit. Mais ensuite, assez rapidement, les gaz à effet de serre qui ont été émis à ce moment-là font l'effet inverse, c'est-à-dire que notamment par exemple le CO 2 mais également des sulfures, vont provoquer un effet de serre et un réchauffement.
Donc on a souvent une alternance de refroidissement suivi d'un réchauffement, c'est ce qu'on a pu observer dans la plupart des crises. Peut-être pas à celle de l'Ordovicien qui a plutôt correspondu à une énorme glaciation.
Qu'est-ce qu'on constate si on essaie de caler des grands événements volcaniques ou des chutes de météorites en face des différentes crises ? On s'aperçoit que pour celle de l'Ordovicien on n'a rien, on n'a rien pu caler. Pour celle du Dévonien on a un doute sur un épanchement volcanique qui s'est produit à Vilui, en Scandinavie et qui est assez mal calé stratigraphiquement, donc on n'est pas certain que ce soit ça. Ensuite, pour les autres crises, on a des grands épanchements volcaniques soit en Sibérie, soit dans l'Atlantique central, soit au Deccan en Inde qui correspondent à d'énormes masses de lave puisque ça correspond à plusieurs kilomètres de lave sur la surface de la France qui ont été émis en quelques millions d'années.
En termes de météorites, on a seulement trois impacts de météorites qui se calent plus ou moins bien avec des épisodes de crise. Pour les autres, il n'y en a pas. C’est donc assez difficile de généraliser. Si on regarde un petit peu plus en détail ce qui se passe pour les météorites, on a une bien faible corrélation. Il n'est que deux crises en face desquelles on peut mettre une chute de météorite, c'est celle qu'on a à la limite Trias - Jurassique où on a une météorite au Canada et c'est la célèbre crise du Crétacé, où on a la météorite qui a frappé la Terre au Yucatán, au Mexique avec un énorme cratère qui fait environ 200 kilomètres. Mais on a également d'autres chutes de météorites qui ont été renseignées, qui ont pu être observées dans le registre fossile et pour lesquelles il n'y a pas de crise à mettre en face. Deux seulement coïncident avec des crises, les plus gros impacts ne sont pas associés à une crise, ce qui veut dire que les météorites ça n'est un facteur ni suffisant ni nécessaire.
Qu'en est-il du volcanisme ? Nous avons repris ici une courbe célèbre de Courtillot et Renne, de 2003, qui met en relation plus ou moins les crises, l'âge des crises avec l'âge, les datations des grands épanchements basaltiques. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate d'abord qu'il y a un certain nombre d'épanchements en face desquels il n'y a pas de crise. Donc, l'épanchement c'est bien mais ça n'est pas un facteur suffisant pour déclencher une crise. La condition pour qu'il soit nécessaire c'est-à-dire qu'on ait un épanchement en face de chacune des crises, ça serait que l'âge de Vilnui, qui correspond au point rouge tout en haut à droite du diagramme soit mieux précisé parce que pour le moment il y a des barres d'erreur, des barres d'incertitude qui nous empêchent de préciser exactement s'il y a une vraie corrélation entre cette crise du Dévonien et ces épanchements. Et puis on n'a rien pour l'Ordovicien, on n'a pas d'épanchement pour l'Ordovicien, ceci étant dit c'est une période qui est très ancienne et on peut imaginer que ces épanchements aient disparu dans les zones de subduction depuis cette époque donc ce n'est pas invraisemblable. Donc globalement on a une assez bonne corrélation.
La moralité de tout ça, la moralité c'est qu'une crise c'est long, c'est généralement polyphasé, c'est plutôt complexe, qu'elles sont différentes les unes des autres, que ce qui impacte la biodiversité c'est en premier ordre le climat avec des événements déclencheurs qui sont les météorites, le volcanisme, donc quel qu'en soient les mécanismes initiateurs c'est généralement le climat qui va impacter le plus la biosphère, que les facteurs forçant de manière globale sont divers, avec un volcanisme de nouveau lui qui est très souvent présent et que la biogéographie joue également un rôle majeur, la distribution des continents joue un rôle majeur dans les crises.
3. La crise actuelle
Si on en vient à la crise actuelle maintenant, voici un diagramme avec quelques taux d'extinction d'un certain nombre de groupes animaux actuels, des espèces marines, des mammifères, des oiseaux, des amphibiens, donc globalement des vertébrés depuis quelques 100 - 150 ans. On a un taux d'extinction ramené en nombre d'espèces par milliers d'années qui a été rapporté comme ça. Par ailleurs, les paléontologues sont capables de nous faire ce genre de courbe.
Qu'est-ce que c'est que cet histogramme ? On a découpé le temps sur les 500 derniers millions d'années en tranches d'un million d'années. Pour chacune de ces tranches on a regardé quel était le pourcentage d'espèces qui s'étaient éteintes. On a fait cet histogramme et on s'aperçoit qu'en moyenne, sur chacune des tranches, le taux d'extinction est de l'ordre de 20 %. Pour les périodes des cinq crises majeures de la biodiversité, on est à peu près 80 % d'extinction. Si on extrapole ce que l'on connaît pour l'extinction des faunes actuelles, ce que nous sommes en train de vivre, on serait à peu près 8000 % pour les mammifères. donc là on a les cheveux qui se dressent sur la tête évidemment parce qu'on se dit 80 % pour une crise majeure, 8000 % actuellement, on va 100 fois plus vite qu'une crise majeure. Alors c'est sans doute à prendre avec précaution, d'abord parce qu'on peut se tromper dans ces chiffres et ensuite parce que ce que nous observons, c'est une vitesse instantanée et ce que nous donne la courbe de droite, l'histogramme de droite, ce sont des vitesses moyennes sur 1 million d'années. Mais néanmoins, ce sont quand même des extrapolations qui sont très inquiétantes parce que ça veut dire que pour le moins, même si on se trompait de deux ordres de grandeur, on va largement aussi vite que les crises anciennes.
La question des vitesses est quelque chose de très important. Les extinctions actuelles se déroulent entre 10 et 100 ans. Les apparitions, pour fabriquer une nouvelle espèce d'animal, se font sur environ 10 000 ans. La durée de vie d’une espèce est d’environ un million d'années. Le véritable handicap est donc la vitesse du changement, plus que son ampleur.