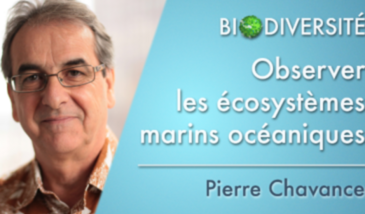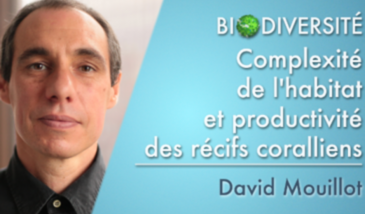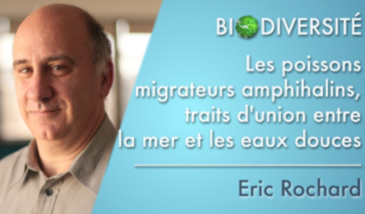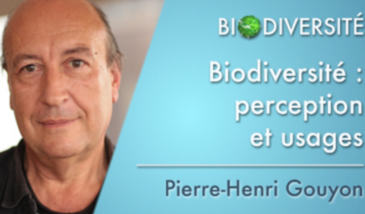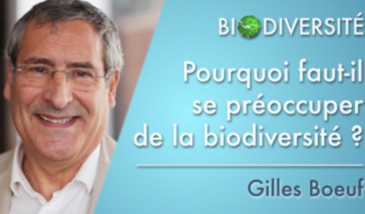En ligne depuis le 04/05/2015
3.3/5 (3)

Description
Gilles Boeuf revient sur les grandes étapes de l'histoire de la vie. Il part des océans, où la vie est apparue il y a plus de 3,5 milliards d'années, évoque la conquête des terres, et termine par l'apparition des groupes humains et par les transformations associées.
Objectifs d'apprentissage :
- Appréhender les grandes étapes de l'histoire de la vie
- Comprendre l'apparition des groupes humains et les transformations associées
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
Types
- Grain audiovisuel
Contributeurs
BOEUF Gilles
Sorbonne Université
Ce document est la transcription révisée et chapitrée d’une vidéo du MOOC UVED « Biodiversité ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.
Histoire de la biodiversité
Gilles BOEUF, Professeur, Université Paris Sorbonne
1. L’océan
Tout a commencé dans l'océan. Cet océan est extrêmement stable. Depuis 100 millions d'années il n'a pas changé. Mais alors pourquoi cet océan si immense n'abrite que 13 % des espèces connues aujourd'hui ? Il y a deux raisons. La première vient de sa connectivité : il n'y a pas différents océans, il y a un océan global. La seconde vient de sa stabilité depuis aussi longtemps : même acidité, même température, même salinité, même composition en oxygène - quand on est au large bien sûr, quand on se rapproche de la côte ça change.
2. Sortie de l’océan
Cette vie va apparaître dans l'océan et elle va le quitter, plusieurs fois, à différents endroits et sous différentes formes. Elle va ensuite exploser dans les forêts du Carbonifère. Il y a beaucoup plus de niches sur les continents ce qui va expliquer pourquoi aujourd'hui on a beaucoup plus d'espèces sur les continents que dans l'océan. Sur les 2 millions d'espèces connues, 400 000 sont des coléoptères et on ne connaît que 350 000 plantes. Cela faisait dire à Haldane : "si Dieu existe, il aime les coléoptères".
Cette vie est plastique. Par exemple, quelques espèces ont été capables de sortir de l'océan mais elles y sont reparties il y a environ 55 millions d'années quand les grands dinosauriens ont disparu, sur les continents et dans le milieu marin. Dans l'océan de l'époque et bien des niches vont être occupées par de nouveaux arrivants qui vont être capables de différencier, sans aucun dessein intelligent, des capacités à se débrouiller dans ces milieux. C’est par exemple l'écholocalisation chez les cétacés qui partent d'animaux qui ressemblent au début un petit peu à des loutres ou des loups et qui finiront par ces dauphins et ces baleines actuelles.
Pourquoi la vie sort de l'océan ? Il n'y aucune réponse scientifique à une telle question. La vraie réponse scientifique c'est : pourquoi au début n’y parviennent chez les animaux que les vertébrés et les arthropodes, les crustacés, qui vont devenir ensuite les insectes qui ont si bien réussi au niveau continental ?
3. Humanité
La vie s'organise en écosystèmes. Les espèces s'organisent entre elles ; elles créent des écosystèmes sur lesquels toutes les pressions humaines actuelles vont s'établir. On s’interroge sur la capacité de résistance d'un écosystème. Comment il va réagir face à une agression ? Ça peut aller jusqu'à sa destruction totale. Si on ne va pas jusqu'à la destruction totale, on peut voir le système repartir, c'est ce qu'on appelle la résilience avec un retour à un certain niveau plus ou moins proche de l'antérieur. C'est là qu'est notre question aujourd'hui : est-ce que nos écosystèmes continentaux et marins sont prêts à supporter aujourd'hui les pressions qu'on leur fait subir ?
Les grandes étapes de l'humanité ont été tout d’abord la domestication du feu par Homo erectus, il y a 800 000 ans. Cela va socialiser l'humain : on se raconte des histoires le soir au coin du feu, on prolonge la lumière du jour, on prolonge la tiédeur de l'été, on durcit les épieux de guerre ou de chasse et puis surtout, bien entendu, plus tard on découvrira qu'en chauffant les aliments, en les cuisant on s'intoxique beaucoup moins et en on consomme beaucoup moins à une époque où l'accès à la ressource était très difficile. La deuxième grande date est bien sûr le Néolithique. Les femmes ont fait beaucoup de bébés, on s'arrête de bouger, on invente agriculture et élevage, vers 8 000 – 10 000 ans. La dernière grande date est la machine à vapeur inventée par James Watt. Du jour au lendemain il nous faut du charbon et du pétrole sur cette biodiversité antérieure qui nous a apporté, bien sûr, ces deux produits. Ceci a amené un prix Nobel de chimie, Paul Crutzen en 2000, à proposer le terme d'anthropocène : la fraction de l'histoire de la Terre durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution est justement la présence de l'humain sur la planète.