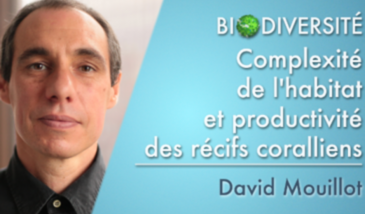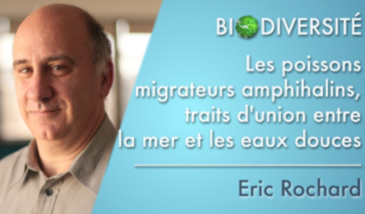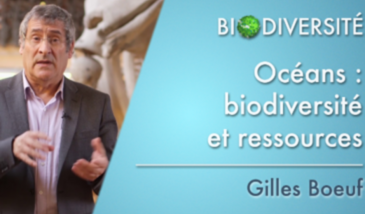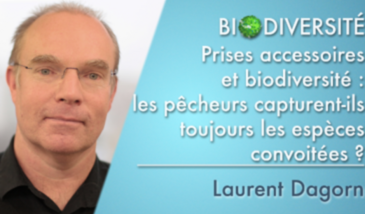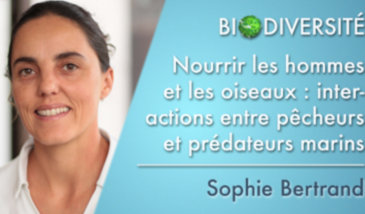En ligne depuis le 04/05/2015
3.5/5 (15)

Description
Les milieux marins étant difficiles d'accès, Pierre Chavance expose plusieurs moyens qui sont aujourd'hui mis en œuvre pour mieux connaître l'état de la biodiversité et des ressources marines. Il se focalise sur les dispositifs d'accompagnement et de surveillance des navires de pêche, et notamment ceux pratiquant la pêche à la senne.
Objectifs d'apprentissage :
- Connaître plusieurs moyens mis en œuvre pour mieux évaluer l'état de la biodiversité et des ressources marines
- Connaître les dispositifs d'accompagnement et de surveillance des navires de pêche, et notamment ceux pratiquant la pêche à la senne.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+1
- Bac+2
Types
- Grain audiovisuel
Contributeurs
Chavance Pierre
IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Ce document est la transcription révisée et chapitrée d’une vidéo du MOOC UVED « Biodiversité ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.
Observer les écosystèmes marins océaniques
Pierre CHAVANCE, Directeur de recherche, IRD
Contrairement aux écosystèmes côtiers, les écosystèmes marins et océaniques sont très difficiles d'accès, très vastes, et difficiles à étudier. Je vais évoquer la façon dont les scientifiques s’organisent pour disposer d'informations fiables et régulières sur ces écosystèmes.
1. Contexte
On qualifie souvent ces vastes écosystèmes océaniques comme le grand désert, dans la mesure où la nourriture y est extrêmement dispersée. Les principales espèces qui y vivent ont donc besoin de se déplacer beaucoup pour y trouver leur nourriture. D'ailleurs, ce sont le plus souvent des espèces migratrices, qui se déplacent entre les différents océans, et qu’on retrouve dans les trois océans mondiaux. Ce sont également des espèces qui sont exploitées au niveau mondial, à un niveau assez important : 4 500 000 tonnes par des pêcheries industrielles, surtout, mais également par des pêcheries artisanales qui exploitent les ressources côtières. L'océan Pacifique est l'océan le plus concerné par cette pêche qui domine largement avec pratiquement 60 % de la production, suivi par l'océan Indien et l'océan Atlantique. Les principaux pays pêcheurs de thon à travers le monde sont le Japon, en première position, suivi d'assez près par l'Europe si on considère l'Espagne et la France qui, à eux deux, occasionnent 10 % des captures mondiales de thon.
2. La pêche à la senne
Pour étudier ces ressources, l'Institut de Recherche pour le Développement s'est associé à la pêche professionnelle pour disposer d'informations fiables sur ces milieux et sur les ressources qui sont exploitées. On s'est notamment associé à la pêche à la senne qui est une pêche particulière, pratiquée dans les océans tropicaux et qui cible essentiellement trois espèces : le thon à nageoires jaunes, la bonite à ventre rayée, et le thon obèse. Ces bateaux sont de grande taille, de 60 à 90 mètres, et ils utilisent une "senne", qui est un grand filet de 200 à 300 mètres de chute et de 1500 mètres de long. Il est opéré un peu comme un grand filet à papillons et son objectif est d'entourer le banc de poissons et de le piéger en fermant une coulisse qui se trouve dans la partie inférieure du filet.
Cette pêche passe une grande partie de son temps à essayer de localiser ces bancs de poissons migrateurs et elles utilisent pour ça un très grand nombre de technologies extrêmement avancées. Dans un premier temps, elles cherchent à localiser les principales zones de pêche en utilisant des imageries satellitales. Mais elles utilisent aussi, à bord, pour repérer les bancs à distance, des jumelles à fort grossissement et des radars qui permettent d'identifier la présence d'oiseaux. Ces derniers trahissent généralement le fait qu'il y a de la nourriture et qu'il y a probablement du thon en dessous. Ils utilisent également des sonars qui, dans l'eau, permettent d'identifier des concentrations particulières qui peuvent être du thon mais également d'autres choses. Il y a donc beaucoup de technologies pour identifier des traces de poissons en mer.
Ces bateaux passent une grande partie de leur temps à essayer de localiser des indices dans le milieu marin trahissant la présence de thons. Notamment, ils essaient de trouver des frisottements en mer. Quand ils ont localisé ce genre de présence, - c'est souvent du thon -, ils s'approchent et ils essayent, si possible, d'encercler ce banc. C'est assez risqué : en moyenne une fois sur deux l'opération se solde par un échec. Mais c'est une opération qui est tout de même encore très recherchée car ce sont des poissons de bonne qualité et de très grande taille et donc de bonne commercialisation.
3. La pêche sur épave
Depuis quelques années, les pêcheurs se sont rendus compte qu'un débris, une bille de bois, un morceau de filet, quelquefois même un animal mort à la surface de l'océan attire la vie autour d’eux : des tortues, des petits poissons et des thons. Depuis une trentaine d'années à peu près, cette pêcherie s'est mise à pêcher sur objets flottants. Elle dispose elle-même des objets flottants artificiels dans l'eau avec des systèmes de localisation, de façon à ce qu'ils puissent les retrouver facilement et aller pêcher dessus. C'est d'ailleurs une pêche qui actuellement fait l'objet de pas mal de discussions au niveau scientifique. Le problème de cette pêche sur objets flottants est qu'il y a un certain nombre d’espèces accessoires comme des poissons, quelquefois des tortues qui sont relâchées vivantes, mais aussi des requins qui, eux, bien souvent ne survivent pas. Il y a donc une vraie problématique de pêche durable autour de cette pêcherie sur épave qui se développe.
4. Données scientifiques
Les scientifiques disposent d'un certain nombre de données qu’ils collectent à bord de cette pêcherie. Le premier est issu des carnets de pêche : chaque patron, chaque capitaine est tenu de remplir chaque jour et pour chaque opération de pêche sa position, les quantités et les compositions spécifiques de sa capture. Nous disposons de 100 % de couverture, pour tous les bateaux et pour tous les jours.
Ensuite, nous disposons d'un échantillonnage à terre dans les différents ports de débarquement de cette pêcherie. Là, des échantillonneurs de l’IRD assurent un échantillonnage pour déterminer précisément les quantités débarquées, les compositions spécifiques mais également les structures de taille de ces différentes espèces.
Également, depuis quelques années, l'embarquement d’observateurs scientifiques se développe. Ils sont associés à tout l’ensemble des opérations de toute la marée et notent les informations sur les positions, la stratégie de pêche, les captures, la durée des captures, les espèces, les tailles, capturées, conservées mais également celles qui sont rejetées. Ce sont des informations dont on ne peut disposer en faisant uniquement des observations à terre.
Enfin, nous avons des informations concernant le positionnement exact de ces navires grâce au système VMS (Vessel Monitoring System), qui est un système obligatoire depuis les années 2000. Il nous permet de vérifier la position exacte du navire toutes les heures environ et on se sert de ces informations pour répartir ces captures par zone économique exclusive, ce qui permet de maintenir des accords de coopération entre les armements et les pays côtiers et également les accords de pêche européens.
5. Conclusion
Les environnements océaniques sont des milieux extrêmement vastes et difficiles d'accès. Ils sont difficiles à étudier avec les moyens conventionnels de la recherche. On a utilisé, au sein de l'observatoire thonier, les données issues de la pêche et on collabore en particulier étroitement avec la pêche à la senne. Cette collaboration est extrêmement fructueuse sur le plan scientifique, sur le plan des données mais c'est aussi une très bonne occasion de maintenir un dialogue avec les professionnels pour travailler ensemble à l'établissement d'une pêche durable dans ces milieux extrêmement fragiles.