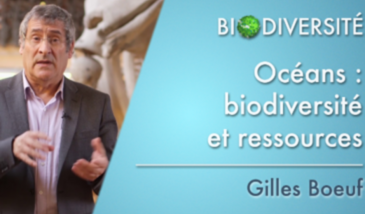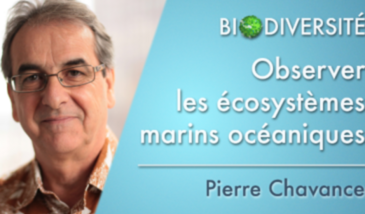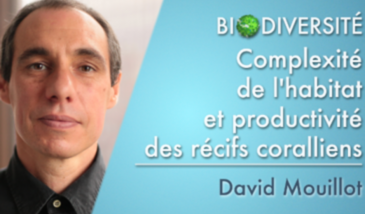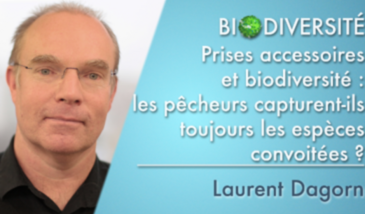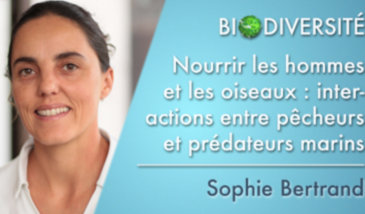En ligne depuis le 18/11/2014
4/5 (2)

Description
Christian Chaboud présente quelques modèles et enjeux liés à l'approche économique des pêches et des ressources marines. Il revient notamment sur le modèle de Gordon Schaefer ainsi que sur l'évaluation économique des services écosystémiques.
Objectifs d'apprentissage :
- Connaître quelques modèles et enjeux liés à l'approche économique des pêches et des ressources marines
- Comprendre le modèle Gordon Schaefer
- Appréhender l'évaluation économique des services écosystémiques
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Mentions Licence
- Economie
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+3
- Bac+4
Objectifs de Développement Durable
- 14. Vie aquatique
Types
- Grain audiovisuel
Contributeurs
Chaboud Christian
IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Ce document est la transcription révisée et chapitrée d’une vidéo du MOOC UVED « Biodiversité ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.
Économie des ressources et de la biodiversité marines
Christian CHABOUD, Chargé de recherche, IRD
1. Contexte
On considère aujourd'hui que la situation des ressources et de la biodiversité marine est alarmiste. La FAO, qui suit depuis longtemps l'évolution des ressources marines exploitées, a mis en évidence qu’entre 1974 et 2009, il y avait une réduction considérable de la part des stocks sous-exploités. Ils sont passés de 40 % à 12 % alors que la part des stocks surexploités avait augmenté de façon significative de 10 à 30 % et que celle des stocks pleinement exploités avaient connu une légère augmentation de 50 à 57 %.
Cette situation a des conséquences économiques graves, à commencer par la rentabilité des pêcheries. Ainsi, un bilan mondial des pêches réalisé en 2004 a fait ressortir pour l'ensemble de ce secteur une perte annuelle 5 milliards de dollars. Une gestion optimale de ce même secteur aurait pourtant permis de générer un profit de 45 milliards pour un effort de pêche inférieur de 50 %. Par ailleurs, l'ensemble des pêcheries reçoivent des subventions abondantes et qui sont très coûteuses pour la société et relativement peu efficaces dans leurs effets. On peut citer par exemple le cas de la France où il a été mis en évidence qu’entre 1960 et 2010, les aides accordées à ce secteur par l'État ont été proches de la valeur des débarquements. Au niveau mondial, on a montré qu'en 2003 les subventions mondiales étaient proches de 25 milliards de dollars et qu'elles représentaient près de 35 % de la valeur des débarquements.
Il est donc important de mettre en place une approche économique scientifique. Elle va contribuer tout d'abord à évaluer les coûts et les avantages des différents usages des ressources et de la biodiversité. Elle va aussi permettre d’aider et d’évaluer les politiques publiques dans le domaine de la gestion des ressources halieutiques mais aussi pour la mise en place de politiques environnementales marines, qu'elles concernent la conservation, la réduction des impacts anthropiques sur ces écosystèmes ou la mise en place d'incitations économiques qui encouragent des usages plus durables de ces ressources.
2. L’économie des pêches
L'économie des ressources marines, notamment des pêches, utilise des modèles. Il s’agit notamment de modèles bio économiques qui vont aider à la gestion de ces activités mais également à comprendre la dynamique de ce secteur. Ces modèles représentent l'évolution de la pêche comme une interaction entre plusieurs composantes :
- une ressource exploitée, composée d'un ou de deux stocks de poissons,
- un secteur économique avec des moyens de production et bien sûr une force de travail des pêcheurs,
- un contexte économique, avec un marché, des coûts de production,
- un cadre législatif et institutionnel qui va définir le cadre des règles de gestion ; des décisions de gestion sont prises qui vont impacter à la fois la ressource exploitée mais aussi le secteur économique et ses résultats.
Le modèle de Gordon-Schaefer, que l’on peut facilement retrouver, est un exemple caractéristique de l'approche bio économique. Sur l'axe horizontal, on a l'effort de pêche qui est constitué de l'ensemble des moyens matériels et humains qui sont utilisés pour capturer du poisson. Les courbes qui figurent dans le graphe représentent 1) l'évolution des revenus en fonction de l'effort de pêche, et 2) l'évolution de la richesse créée par la pêche, c'est-à-dire le profit. Lorsque l'effort de pêche se développe, deux optimums sont possibles : un optimum économique et un optimum biologique. L'optimum biologique correspond au maximum de production possible en valeur tandis que l'optimum économique va correspondre au profit maximum. Pour obtenir un profit maximum, il est nécessaire d'utiliser un effort de pêche qui est significativement inférieur à celui qui permet d'obtenir la production maximale.
Par ailleurs, on considère que si l'effort de pêche n'est pas régulé, les pêcheries auront tendance à se développer spontanément jusqu'au point d'équilibre dit « de libre accès » où le revenu est égal au coût. Cela implique que le profit dans ce cas-là est nul, et donc que la pêcherie ne produira plus de richesses pour la société. Cette situation bien sûr n'est pas souhaitable d'un point de vue collectif parce qu'elle correspond d’une part à une situation avérée de surpêche biologique : on produit moins de poissons que l'on pourrait en produire avec moins de bateaux. Elle correspond d’autre part à une situation de surpêche économique, à savoir qu'on ne crée pas de richesses alors que l’on pourrait créer une richesse beaucoup plus significative pour la société si on diminuait l'effort de pêche.
3. Les outils de gestion proposés
Pour faire face à cette situation de surexploitation dans les pêcheries, différents outils de gestion sont proposés. Il y a tout d'abord des outils qui visent le contrôle des moyens de production. Ces moyens de production peuvent faire l'objet d'un contrôle physique direct à travers la mise en place de licences de pêche, de permis de pêches qui vont limiter le nombre d'unités autorisées. On peut également faire un contrôle physique indirect en agissant sur les caractéristiques des engins et bateaux - et non pas sur leur nombre -, ou encore en mettant en place des fermetures spatiales ou des fermetures saisonnières de la pêche. Il y a aussi des outils qui concernent les moyens de production à travers le contrôle de leur coût, que ce soit à travers la mise en place de redevances de pêches qui vont être associées aux licences de pêche. Chaque unité de pêche va payer un droit de pêche chaque année. On peut aussi mettre en place des taxes ou des subventions sur les intrants utilisés par les unités de pêche.
Le contrôle de la production quant à lui passe principalement par la limitation physique des captures. Le principal outil ici est le total admissible de captures (TAC) qui définit la capture maximale annuelle que ne peut pas dépasser une pêcherie. C'est un outil qui est défini pour la plupart des grandes pêcheries dans le cadre de la Politique Commune des Pêches en Europe. Le TAC, une fois défini, peut être divisé en quotas individuels qui vont être répartis entre les pêcheurs. On peut également agir en définissant une taille légale de capture pour les espèces cibles et également en limitant le volume des captures accessoires de la pêche. Enfin, on peut agir sur les prix à la production à travers la régulation des marchés mais hormis les prix de soutien pour certaines espèces, ces derniers outils sont relativement peu utilisés.
4. L’économie de l’environnement marin
L'économie de l'environnement marin vise une perspective beaucoup plus large que l'économie des pêches. Il s'agit là de faire prendre conscience de la vraie valeur des écosystèmes marins et de leur biodiversité grâce à leur évaluation économique. Il s'agira de corriger ou de proposer des méthodes économiques qui compléteront les méthodes économiques standards qui sont souvent non adaptées, en l'absence de prix de marché pour les biens environnementaux ou en présence d'imperfections sur leur marché.
Évaluer la valeur des écosystèmes marins passe par l'évaluation des services écosystémiques marins. Les services écosystémiques marins sont les biens et services marchands et non marchands qui sont offerts par ces écosystèmes à la société et qui vont contribuer au bien-être économique et social. Il s'agit là d'une approche anthropocentrée et il est clair que l’on doit distinguer les services écosystémiques des fonctions écologiques des écosystèmes qui elles sont étudiées par l'écologie.
Le Millennium Ecosystem Assessment qui a été réalisé au débit des années 2000 a proposé un cadre général pour analyser les services écosystémiques. On a une typologie qui va distinguer les services écosystémiques d'approvisionnement (par exemple la nourriture et les matières premières qui sont extraites des écosystèmes), les services écosystémiques de régulation (par exemple à travers la régulation climatique, le contrôle de l'érosion), les services écosystémiques culturels (qui concernent les activités récréationnelles mais également aussi les aspects esthétiques voire la dimension spirituelle), et enfin les services écosystémiques de supports (tels que la production primaire dans les écosystèmes et le recyclage des nutriments). Ces différents services écosystémiques vont contribuer aux éléments constitutifs du bien-être économique et social des populations, que ce soit à travers leur sécurité, les supports matériels de l'existence, la santé ou les relations sociales.
En 1997, un travail pionnier dans ce domaine a été réalisé par Costanza et al. dans un article publié pour la revue Nature. Il s'agit d'un des premiers essais d'évaluation, au niveau mondial, de la valeur des services écosystémiques qui ont été estimés pour l'ensemble des biomes présents sur la planète et rapportées par une unité de surface. Si on veut faire un zoom sur les résultats de cette étude sur les écosystèmes marins, on voit que la valeur des services écosystémiques marins a été évaluée à 21 000 milliards de dollars américains, ce qui représenterait 64 % des services écosystémiques mondiaux. Au sein des services écosystémiques marins, ce sont les écosystèmes côtiers qui dominent, en offrant 59 % des services écosystémiques marins. Enfin, les services écosystémiques de support sont les plus importants, notamment à travers la production primaire des écosystèmes.
5. Conclusion
Le concept principal que les économistes mettent en œuvre pour évaluer les écosystèmes est celui de la valeur économique totale. Elle est égale à la somme des valeurs d'usage marchand et non marchand (les usages marchands sont abordés à travers les outils classiques de l'économie de marché), ainsi que des valeurs de non-usage, notamment les valeurs d'existence intrinsèque des différentes composantes des écosystèmes. L'économie de l'environnement a produit des méthodes pour pallier la difficulté d'évaluation des services écosystémiques non marchands. Ces méthodes aujourd'hui sont bien connues et il va s’agir désormais, pour les écosystèmes marins, de les utiliser de façon plus systématique.