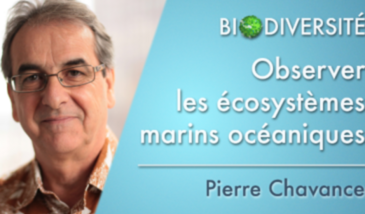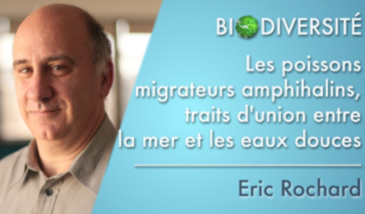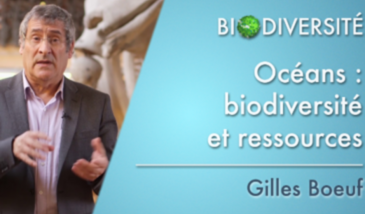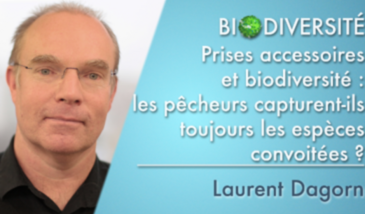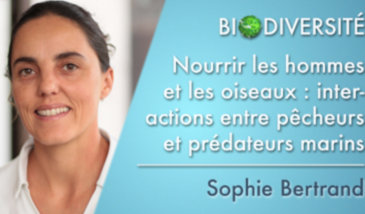En ligne depuis le 04/05/2015
4.8/5 (4)

Description
David Mouillot propose une analyse des récifs coralliens en matière de biodiversité et de productivité. Il cherche à préciser l'importance des habitats coralliens pour le développement de larges réseaux trophiques, pouvant être utilisés de manière durable par les populations humaines des littoraux concernés.
Objectifs d'apprentissage :
- Appréhender les récifs coralliens sous l'angle de la biodiversité et de la productivité
- Comprendre l'importance des habitats coralliens pour le développement de larges réseaux trophiques
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
Types
- Grain audiovisuel
Contributeurs
Mouillot David
Université de Montpellier
Ce document contient la transcription textuelle d’une vidéo du MOOC UVED « Biodiversité ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres aux interventions orales des auteurs.
Complexité de l'habitat et productivité des récifs coralliens
David Mouillot
Professeur – Université de Montpellier
Nous sommes désormais plus de 2,5 milliards sur la bande côtière. La majeure partie de cette population va s'accroître sur les zones tropicales. Cela induit une forte dépendance aux systèmes coralliens, à la fois d’un point de vue économique - via les pêcheries artisanales -, mais aussi d’un point de vue nutritionnel - via l'apport en protéines et en oligo-éléments -, à plus de 400 millions de personnes qui ont peu d'alternatives. Nous allons donc avoir une forte pression de pêche sur ces systèmes extrêmement vulnérables. La question est de savoir si ces systèmes coralliens, qui produisent en moyenne 5 tonnes par kilomètre carré et par an de ressources marines, pourront soutenir cette demande. Elle est aussi de savoir quels sont les mécanismes sous-jacents à cette productivité pour mieux anticiper leur diminution.
1. Problématique
L'empreinte écologique permet de mesurer si les systèmes coralliens peuvent soutenir la demande actuelle. Des auteurs ont montré que cette empreinte écologique pouvait se mesurer par un ratio entre la production de pêche et la production du récif. Lorsque ce ratio est égal à 1, on est à l'équilibre. On extrait autant que le système corallien produit de biomasse. Au-delà de 1, le système est surpêché. En dessous, le système est durable. Les auteurs ont démontré, en prenant 50 systèmes insulaires, que la plupart sont en surpêche avec une empreinte écologique supérieure à 1. Peu de systèmes sont viables sur le long terme. Le but est donc de savoir ce qui peut soutenir cette production pour ne plus être autour de 5 mais pourquoi pas essayer d'être entre 10 et 15 tonnes par kilomètre carré et par an afin de subvenir à la demande au niveau mondial.
La question clé est de savoir comment l'habitat peut influencer cette productivité. Nous savons que l'habitat corallien est dégradé sur 75 % de la surface du globe et que la diversité et la biomasse de poissons sont essentielles au maintien d'un récif en bon état. En effet, lorsque le poisson est péché, on passe plus facilement d'un système corallien vers un système algues. On sait aussi à travers des observations empiriques que la productivité est très variable, entre 1 et 15 tonnes par kilomètre carré et par an. Cette variabilité doit venir de processus qui vont expliquer la mise à disposition de protéines et de nutriments pour les humains.
2. Démarche scientifique
Nous allons adopter une approche en modélisation qui permet de décortiquer les mécanismes et d'orienter les politiques de conservation. L'approche en modélisation est simplement basée sur un modèle multi-trophique, mettant en jeux quatre compartiments principaux des récifs coralliens : les prédateurs, les poissons herbivores, les invertébrés du benthos, les algues et les détritus. Tous ces compartiments se consomment les uns sur les autres par prédation.
L'idée des auteurs a été d'intégrer la notion de vulnérabilité sur les récifs coralliens. Elle est simplement liée au nombre et à la diversité des cavités présentes sur ces récifs. L’hypothèse est toute simple : la présence de cavités baisse la vulnérabilité à la prédation pour différentes classes de taille. C'était valable à la fois pour les juvéniles des prédateurs et pour conserver une grande biomasse de proies. La présence des cavités va moduler les interactions trophiques et les abondances.
3. Résultats
Les auteurs, en ayant ajusté ce modèle à des données sur les Caraïbes, démontrent qu'un récif plus complexe peut produire trois fois plus de biomasse consommable par l'homme qu’un récif dégradé sans cavités. Ils montrent que le nombre de cavités influence positivement la biomasse avec simplement le fait que ces cavités peuvent accueillir une plus grande biomasse de proies. Elles peuvent donc aussi accueillir une plus faible prédation sur les juvéniles des top prédateurs.
On s'aperçoit aussi qu'une relation quadratique s'installe entre la taille des cavités et la productivité. Au départ, c'est tout à fait intuitif : lorsque ces cavités augmentent de taille on tend à augmenter la production du système. Des espèces de plus en plus grosses pourront s'y réfugier et donc être moins susceptibles à la prédation. Ensuite, au-delà de poissons d’un kilo, on s'aperçoit que la relation descend : des très grandes cavités ne sont pas très productives pour le système. En effet, les prédateurs nécessitent des proies de grande taille qui ne doivent pas pouvoir se cacher dans le récif sinon elles ne peuvent être consommées.
4. Discussion
Préserver la qualité des habitats coralliens est donc un facteur clé pour maintenir la productivité des systèmes. Ce défi est d'autant plus délicat dans un monde plus chaud, plus acide, plus pollué et soumis à une présence de pêche de plus en plus forte. On peut, à minima, identifier les zones les plus vulnérables pour les récifs coralliens. Si on regarde les projections d'ici 2070 par l'action conjuguée de l'acidification et de l’augmentation de température, on s'aperçoit que la dégradation attendue est très hétérogène à la surface des océans. Elle est prononcée près du « triangle de corail » où se concentre une majorité d'habitants tropicaux et une grande proportion de la biomasse et de la biodiversité en poissons.
Cette vulnérabilité peut induire des trappes socio-écologiques où des boucles de rétroaction vont se mettre en place entre la qualité de l'habitat, la pêcherie et la quantité de biomasse de poissons. Ainsi, un habitat dégradé fournit peu de productivité. Le peu de poissons restant dans le système subit une surpêche. Moins de poissons signifie une qualité d'habitat encore moins bonne, etc.. Cela induit des boucles de rétroaction et une véritable trappe socio-écologique. Pour en sortir, des actions de remédiation des récifs coralliens pourraient être nécessaires, conjuguées à des méthodes de pêche sélective et la mise en place de réserves marines. Tout cela aurait pour but d'aider les populations locales à maintenir un récif productif sur le long terme. Le modèle nous a donc permis d'identifier des mécanismes à la base de la productivité et in fine d’orienter des politiques de conservation.