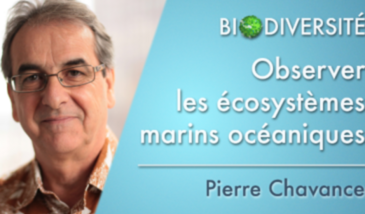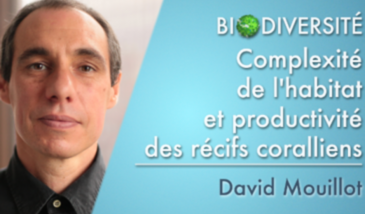En ligne depuis le 30/10/2014
4/5 (1)

Description
Cette intervention d'Eric Rochard porte sur les poissons migrateurs amphihalins, poissons effectuant des migrations entre les eaux douces et la mer. Après une présentation de ce mode de fonctionnement et un aperçu des espèces emblématiques, il revient sur leurs intérêts écologiques, alimentaires, récréatifs et culturels.
Objectifs d'apprentissage :
- Comprendre ce que sont les poissons migrateurs amphihalins
- Comprendre leur mode de fonctionnement
- Avoir un aperçu des espèces emblématiques
- Appréhender leurs intérêts écologiques, alimentaires, récréatifs et culturels
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Contributeurs
Rochard Eric
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Ce document contient la transcription textuelle d’une vidéo du MOOC UVED « Biodiversité ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres aux interventions orales des auteurs.
Les poissons migrateurs amphihalins, traits d’union entre la mer et les eaux douces
Éric Rochard
Directeur de recherche - IRSTEA
Les poissons migrateurs amphihalins sont des poissons qui effectuent des migrations entre les eaux douces et la mer pour accomplir leur cycle vital. Il faut, de plus, que ces migrations aient lieu à des dates prévisibles et à des stades bien particuliers du cycle de vie. Il faut également que ces migrations soient réalisées par l'essentiel des individus de ces populations pour que ce soit vraiment des poissons migrateurs amphihalins.
1. Cycles de vie
En Europe métropolitaine, on rencontre 28 espèces de deux types différents. Le premier type concerne des espèces qui vont se reproduire en rivière. Les jeunes vont commencer leur croissance en rivière, puis ils vont traverser les estuaires et vont réaliser l'essentiel de leur croissance en mer. Lorsqu'ils approchent de la période de la maturité sexuelle, ils vont retraverser les estuaires et revenir en rivière pour se reproduire. C'est le cas notamment des aloses, du saumon atlantique, de la truite de mer, des lamproies et d'espèces moins connues comme l'éperlan ou les esturgeons. On appelle ces espèces « potamotoques ». Cela veut dire, en grec, qu’elles se reproduisent en rivière. On en compte 25 espèces en Europe. Le deuxième type fait un cycle de vie inverse. Ce sont des espèces qui se reproduisent en mer. La reproduction peut avoir lieu près des côtes, comme pour le mulet porc ou le flet, ou au contraire elle peut être très lointaine, comme pour l’anguille européenne qui se reproduit dans la mer des Sargasses près des côtes américaines. La reproduction a lieu en mer, et elle est généralement suivie par un stade larvaire qui va se déplacer de la mer vers les estuaires. Il va traverser les estuaires et va amener les individus en eau douce où ils vont accomplir l'essentiel de leur croissance. Lorsqu'ils approchent de la maturité sexuelle, ils vont entamer un chemin inverse, en retraversant les estuaires et en retournant sur les zones de reproduction. Ils se reproduisent en mer et on les appelle donc « thalassotoques ». Il n'y en a que trois espèces en Europe.
Ces diversités de cycle de vie et de forme correspondent à une diversité d'habitat utilisés depuis la partie basse, dans les estuaires, jusqu’aux torrents à l’amont en passant par la partie moyenne des fleuves jusque dans les petites rivières. Cette diversité de formes correspond également à une diversité des régimes alimentaires. Certaines espèces se nourrissent de poissons, comme les lamproies durant leur phase marine, les saumons dès qu’ils ont une taille assez grande, ou l'anguille. D'autres se nourrissent de plancton, comme la grande alose. D'autres vont se nourrir de petites algues comme des diatomées ; c’est le cas des jeunes stades de lamproies durant leur phase en eau douce.
En termes de reproduction, les petites espèces se reproduisent plus tôt. C'est le cas par exemple de l'éperlan qui peut se reproduire à partir d'un an pour une vingtaine de centimètres. A l'opposé, l’esturgeon européen doit attendre entre 10 et 15 ans pour pouvoir se reproduire lorsqu'il arrive à une taille autour de 1m50. Les périodes de reproduction sont également variables. On les rencontre en hiver pour les salmonidés et les lamproies et plutôt au printemps ou en été pour les aloses ou l’esturgeon européen. Certaines espèces ne peuvent se reproduire qu'une seule fois et meurent après cette reproduction unique : c'est le cas des lamproies et de l'anguille. D’autres, au contraire, se reproduisent régulièrement : c’est par exemple l’alose feinte ou le mulet porc.
2. Symbolique et usages
Ces espèces ont une forte charge symbolique parce qu'elles sont associées à de nombreux biens et services. Elles constituent par exemple des ressources alimentaires. Ce n’est plus trop le cas en Europe mais c’est encore important dans certaines régions du globe comme par exemple au Bangladesh ou en Afrique, où les petites aloses sont une partie importante des protéines à disposition des populations. En Europe, ce sont plus des espèces qui ont un intérêt gastronomique : le caviar issu de l'esturgeon, la lamproie à la bordelaise, le saumon fumé, etc.
Au-delà de cet intérêt alimentaire, ce sont des espèces qui sont un support de loisirs. On va les pêcher : saumon dans le nord de l'Europe, truite en Normandie, petite morue migratrice, ou encore poulamon atlantique (pêché au Québec l'hiver sous la glace).
Au-delà de la pêche, ce sont également des espèces qui ont un intérêt en termes de tourisme. Il y a des visites importantes pour aller voir les sites de reproduction de ces espèces qui arrivent en masse lors de leur migration. On a tous vu les migrations de ces saumons du Pacifique rouges dans des eaux très peu profondes au milieu des ours. Il y a énormément d'activités touristiques associées à cela. C'est également le cas des chambres de vision qui ont été aménagées dans les passes à poissons. Elles permettent de voir les migrateurs passer. C'est un des rares moments où on peut voir des poissons vivants. On peut aussi les voir via des webcams spécialisées qui permettent d'avoir ces images.
Ce sont également des espèces qui sont support de traditions et de symboles. Ce sont des choses qui remontent à loin puisque par exemple, sur le blason de la ville de Caudebec-en-Caux, on voit l'éperlan. C’était l'espèce qui a amené la richesse à la ville par l’activité de pêche. Ce sont également des symboles actuels comme on peut le voir sur des représentations beaucoup plus récentes.
Certaines espèces sont également associées à une qualité d'eau particulière. Ainsi, sur une pub de la RATP, on peut voir un salmonidé migrateur qui saute hors de l'eau. L'idée que veut faire passer la RATP sur cette publicité est qu’elle a lavé l’eau qui a lavé les bus. C’est pour cela qu’on met une illustration avec un poisson symbole de qualité d'eau.
Cela peut être également quelque chose de beaucoup plus traditionnel comme ces confréries ou ces fêtes qui existent un peu partout là où il y a des poissons migrateurs.
3. Ecologie
Ce sont des composants des écosystèmes. On a vu qu'elles avaient différents types de proies. Dans certains cas, en tant que prédateurs, elles peuvent être considérées comme un élément perturbateur. C'est le cas par exemple de la lamproie marine dans les grands lacs américains où elle se nourrit d'autres espèces plus prisées. Elle y est considérée comme un nuisible dont il faut se débarrasser. Mais elles peuvent aussi être des proies, mangées par des oiseaux, des baleines, des phoques, ces derniers ayant longtemps été accusés de détruire les saumons sur les côtes nord-américaines.
Enfin, les poissons migrateurs représentent le seul flux de matière entre la mer et les eaux douces. C'est le seul flux qui remonte et, à l'extrême, ce sont des espèces qui peuvent être considérées comme ce que l'on appelle des clés de voûte. Cela signifie que le fonctionnement général de l'écosystème dépend d’elles. C'est le cas le long de quelques rivières de la côte pacifique où les saumons, quand ils remontent, sont attrapés par les grizzlis. Ces derniers ratent plein de saumons et ces saumons qui se décomposent, servent de nutriments pour la végétation qui borde ces rivières. La migration des saumons induit ainsi un certain mode de fonctionnement de l'écosystème.