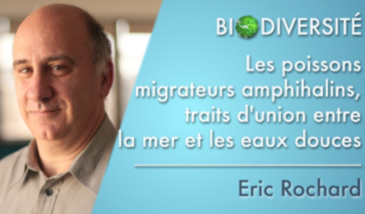En ligne depuis le 19/11/2014
5/5 (2)

Description
Cette intervention de Christian Chauvin porte sur les végétaux aquatiques des cours d'eau. Après une définition des macrophytes et quelques précisions concernant leur fonctionnement d'un point de vue écologique, il revient sur leur utilisation en tant que bioindicateur de la qualité des cours d'eau.
Objectifs d'apprentissage :
- Connaître les végétaux aquatiques des cours d'eau et leur fonctionnement d'un point de vue écologique
- Appréhender leur utilisation en tant que bioindicateur de la qualité des cours d'eau
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+3
- Bac+4
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Contributeurs
Chauvin Christian
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Ce document est la transcription révisée et chapitrée d’une vidéo du MOOC UVED « Biodiversité ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.
Les végétaux aquatiques : de la biodiversité à la bioindication
Christian CHAUVIN, Ingénieur de recherche, IRSTEA
1. Les macrophytes aquatiques
Ce vocable, qui est une classification purement fonctionnelle et non basée sur la floristique, englobe toutes les plantes qui ont un aspect macroscopique. On les voit donc à l'œil nu dans l'eau, par opposition aux microphytes. On trouvera dans ces macrophytes des phanérogames, qui sont des grandes plantes parfois complètement immergées, des hydrophytes flottantes, des hélophytes qui sont enracinées dans le substrat et qui vont développer leur appareil végétatif hors de l'eau, des bryophytes avec des hépatiques et des mousses, et des colonies algales qui forment un ensemble qui est macroscopique.
Ces peuplements ont des interactions fortes avec leur habitat. Les échanges peuvent se faire avec l'eau, les sédiments ou l'atmosphère. Ces échanges vont se faire de façon différente en fonction de la forme de la plante. La forme de la plante n'est donc pas uniquement descriptive mais elle correspond aussi à un rôle précis dans l'écosystème. En retour, les macrophytes ont des actions sur leur habitat. Ils peuvent par exemple modifier localement des écoulements d'eau ou des mécanismes de sédimentation. Ces peuplements jouent un rôle central dans l'écosystème aquatique. En tant que producteur primaire, ils sont bien sûr une des bases importantes du réseau trophique. Leurs peuplements structurent également l'habitat d'autres compartiments de l'écosystème comme les poissons ou les invertébrés. Tous ces peuplements sont conditionnés par l'ensemble des facteurs qui régissent leur environnement. Cet objet d’étude est l’hydrogéochimie. Il inclut les nutriments, en particulier azotés et phosphorés, le substrat et sa dynamique, l’éclairement, l’occupation des berges, l’hydrologie, l’hydraulique ou la thermie.
2. La bio-indication
Comment peut-on utiliser ces macrophytes en tant qu'indicateurs ? Il faut revenir sur des notions d'écologie fondamentales. Il y a par exemple la valence écologique : pour un facteur écologique donné (ex : la température, la teneur en ammonium), certaines espèces vont répondre pour des valeurs très précises de ce gradient, soit des valeurs faibles, soit des valeurs importantes. C'est ce qu'on va appeler les espèces sténoèces, qui seront des indicateurs extrêmement sensibles. D'autres espèces, au contraire, vont être beaucoup moins sensibles, voire très tolérantes et c'est ce qu'on va appeler les espèces euryèces. Un autre aspect de ces peuplements qui va pouvoir être décrit est leur structure. Quelles sont les espèces qui composent ce peuplement ? Quel est le nombre d'espèces ? Quelle est leur abondance ? Quels sont leurs traits biologiques et écologiques ?
Un bio-indicateur est un organisme, une partie d'organisme ou un ensemble d'organismes qui va être utilisé pour connaître l'état de son environnement et de son habitat. Pour ces macrophytes aquatiques en cours d'eau, un indicateur a été développé dans le début des années 2000. Il s’agit de l’IBMR (Indice Biologique Macrophytes en Rivière). C’est une méthode qui est biocénotique, c'est-à-dire qu'elle s’intéresse à l'ensemble du peuplement et qui est basée sur deux aspects principaux : d'une part, la composition du peuplement (quelles sont les espèces présentes ?), et d'autre part l'abondance relative de ces espèces qui composent ce peuplement. 208 taxons aquatiques ont été retenus pour définir le calcul de cet indicateur. Ces 208 taxons correspondent à la plus grande partie de ce qu'on peut trouver comme espèces strictement aquatiques dans les cours d'eau français. Deux valeurs ont été définies pour chacun de ces taxons : d'une part une côte spécifique qui correspond au degré d'affinités pour un niveau trophique donné, exprimé de 0 à 20 ; d’autre part un coefficient de sténoécie qui est la capacité d'un taxon à indiquer une valeur assez précise sur un gradient donc en l'occurrence de ce niveau trophique. L'indice monométrique, qui est exprimé sous la forme d'une seule valeur, est calculé comme une moyenne des cotes spécifiques de tous les taxons présents, par l'abondance et la sténoécie de chacun des taxons.
3. Usages
Comment utiliser un indicateur de ce type dans l'évaluation de l’état écologique ? Avec la mise en place de la directive européenne sur l'eau au début des années 2000, il a été nécessaire de développer des méthodes d'évaluation à partir de bio-indicateurs. Prenons l'exemple de la végétation aquatique.
On commence par une mesure, appelée hydrobiologique. C'est un relevé de macrophytes sur un tronçon de cours d'eau selon un protocole qui est très bien standardisé. A partir de ces résultats, on calcule un indicateur, en l’occurrence l’IBMR. On obtient une valeur, par exemple de 9,8. Cette valeur, pour être exploitée, doit être rapprochée des références. Dans le développement de la méthode, une des premières phases a été de travailler sur les valeurs de référence justement pour définir des notes IBMR de référence sur chacun des types de cours d'eau qu'on peut trouver sur le territoire métropolitain. Si dans notre exemple la valeur de référence est de 12, nous calculons l’écart à la référence en faisant le ratio entre la valeur observée sur la valeur de référence. Ici, cela donne 0,82. En se reportant dans une grille dont les seuils ont été définis dans l'élaboration de la méthode, nous voyons qu'on obtient une classe de couleur verte, c'est-à-dire un bon état écologique. Ce type de méthode permet donc d'avoir une vision synthétique de l'état écologique des cours d'eau à l'échelle d'un territoire national, comme la France.
4. Perspectives
Quelles sont les pistes d'évolution de ce bio-indicateur ? Les équipes d’IRSTEA à Bordeaux s'intéressent à définir des indicateurs un peu plus évolués qui vont répondre à des pressions de façon beaucoup plus précise. On va se focaliser sur des profils écologiques qui vont nous permettre d'avoir un aperçu assez rapide de l'affinité pour un niveau de paramètres particuliers (ex : paramètres physico-chimiques, paramètres hydro-morphologiques).
Que peut-on retenir de cette approche visant à utiliser les macrophytes en bio-indicateur ? Tout d'abord, la diversité des peuplements macrophytiques est un bon reflet de la richesse du fonctionnement de l'écosystème aquatique. Aussi, les peuplements macrophytiques sont conditionnés par tous les éléments et tous les mécanismes qui régissent leur environnement et qu'ils conditionnent eux-mêmes l'habitat d'autres éléments biologiques. Enfin, l’utilisation de différents descripteurs de peuplement va renseigner sur l’état écologique des systèmes, et plus globalement sur l'impact que subissent ces systèmes du fait des pressions anthropiques sur leur bassin versant.