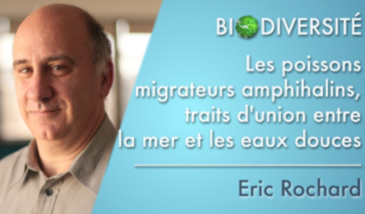En ligne depuis le 30/10/2014
5/5 (1)

Description
Marion Gosselin propose un aperçu des dynamiques écologiques associées aux milieux forestiers, appelées également successions écologiques. Elle en présente les grandes étapes, des stades pionniers aux stades matures, en se focalisant à chaque fois sur la biodiversité associée. Pour finir, elle met en parallèle ces évolutions naturelles et les stratégies actuelles de gestion forestière.
Objectifs d'apprentissage :
- Connaître les dynamiques écologiques associées aux milieux forestiers (successions écologiques)
- Appréhender les grandes étapes des successions écologiques forestières
- Comprendre les évolutions naturelles et les stratégies actuelles de gestion forestière
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
Types
- Grain audiovisuel
Contributeurs
GOSSELIN Marion
Ce document contient la transcription textuelle d’une vidéo du MOOC UVED « Biodiversité ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres aux interventions orales des auteurs.
Succession forestière et biodiversité en milieu tempéré
Marion Gosselin
Ingénieur - IRSTEA
La succession écologique est la colonisation d'un milieu par les êtres vivants et la suite des communautés d'espèces qui vont se succéder sur ce milieu au cours du temps.
1. La notion de niche écologique
Pour comprendre ce qu'est que la succession forestière et l'influence que ça a sur la biodiversité en forêt, il faut comprendre ce qui permet la présence d'une espèce dans un lieu donné. Il y a deux grands facteurs en présence. D'une part, il y a la présence de ressources alimentaires ad hoc pour l’espèce, qu'elle va exploiter pour se développer et se reproduire. D'autre part, il y a des facteurs environnementaux, par exemple la température, l'humidité ou l'altitude, qui influencent la performance de l'espèce quant à l'exploitation de ces ressources. Ces grands facteurs constituent ensemble ce qu'on appelle la niche écologique d'une espèce. On peut dire que la niche écologique, c'est l'association à la fois d'une gamme de ressources exploitées (quelles sont les proies de l'espèce ?), d'une gamme de contraintes environnementales qu'elle peut supporter (par exemple quelle température supporte-t-elle ?), et la place qu'elle occupe dans l'environnement (en forêt, est-ce qu'on va trouver les individus de l'espèce plutôt au sol, sur le tronc ou dans les branchages en hauteur par exemple ?).
On distingue la niche fondamentale d'une espèce qui est la niche théorique et la niche réalisée de l'espèce, souvent plus restreinte parce que c'est lié à la présence éventuelle de compétiteurs. Un habitat est un lieu géographique donné dont les caractéristiques permettent à une espèce d'y établir une population viable, c'est-à-dire de réaliser sa niche. Si un habitat donné présente les caractéristiques de la niche écologique de l'espèce, si l'espèce est présente ne serait-ce que sous forme de graines dans le sol ou alors si elle est présente à proximité et qu'elle peut ensuite coloniser le milieu et si localement il n'y a pas d’espèces trop concurrentielles, alors l'espèce peut s'installer, réaliser sa niche et avoir une population viable au moins à court terme.
2. Successions forestières
Une succession primaire s'établit à partir d'un sol nu. Au départ, il y a très peu d'espèces en présence et il y a une forte concurrence par rapport aux maigres ressources que présente le milieu. Dans ce cas-là, seules s’installent quelques espèces dites pionnières qui sont très peu exigeantes et qui ont une forte capacité de croissance. Par la suite, ces espèces pionnières ont des individus qui meurent, qui se décomposent et leur décomposition vient enrichir le sol. À la faveur de cet enrichissement du sol, de nouvelles espèces un peu plus exigeantes peuvent parvenir à s'installer. On passe alors à un stade dit post-pionnier.
Ces nouvelles espèces constituent elles-mêmes de nouvelles ressources alimentaires pour d'autres espèces potentielles. Elles créent de nouveaux habitats et c'est ainsi que peu à peu d'autres espèces viennent s'installer à la faveur de la présence des premières espèces. La succession forestière se fait donc en fonction du jeu des interactions entre les espèces. On pense en premier lieu à toutes les interactions trophiques, la présence d'une proie par exemple peut permettre l'installation d'un prédateur mais il y a aussi d'autres types d'interactions, par exemple, des questions d'inhibition entre espèces (certaines plantes émettent des substances toxiques pour d'autres plantes mais aussi des systèmes de facilitation au contraire où la présence de certaines espèces facilite l'installation des autres). Typiquement, la présence d'espèces pionnières qui créent un ombrage léger au-dessus du sol permet l'installation d'espèces dites post-pionnières dont les semis ont besoin d'un léger ombrage et qui ne pourrait pas se développer en pleine lumière.
La succession primaire se poursuit ainsi au fur et à mesure jusqu'à la colonisation par des espèces dites dryades dont les semis se développent plutôt à l'ombre. À tout moment dans la succession, il peut intervenir des perturbations qui provoquent un retour en arrière à un stade intermédiaire. Ces perturbations peuvent être d'origine naturelle comme le feu ou alors des dégâts de tempête ou d'origine anthropique, par exemple les coupes sylvicoles.
3. Successions et biodiversité : exemples
Comment ces successions s'expriment-elles en termes de biodiversité ? Comment les espèces se succèdent-elles au cours de la succession forestière ?
Un premier exemple concerne l'évolution des plantes depuis une perturbation de coupe rase. On est donc dans une succession secondaire. Au tout début de la succession, les plantes qui s’installent sont des espèces héliophiles qui ont besoin de beaucoup de lumière. Ce sont elles qui dominent dans les premiers temps de la succession (par exemple la digitale jaune). Dans un deuxième temps, des espèces aux comportements intermédiaires par rapport à la lumière vont commencer à s'installer tandis ce que les espèces héliophiles déclinent. Dans un troisième temps, alors que les arbres en grandissant provoquent de plus en plus d'ombrage, on assiste au déclin des espèces héliophiles qui ont trop d'ombre pour persister, au déclin aussi peu à peu des espèces intermédiaires. Puis ce sont des espèces dites sciaphiles qui tolèrent bien l’ombrage qui s'installent dans les derniers stades. Par exemple l’ail des ours ou alors la néottie nid d’oiseau.
Un deuxième exemple est celui de la succession des groupes d’oiseaux au cours de la croissance d'un peuplement géré en futaies régulières, depuis les stades de régénération des semis jusqu'au stade de la futaie âgée. Dans un premier temps, lorsque les arbres font moins de 2 mètres de haut, on est dans les stades de régénération "de fourrés" : les espèces d’oiseaux qui s’installent sont les espèces qui nichent au sol. Dans un deuxième temps, à partir du stade "perchis", lorsque les arbres atteignent au moins 3 mètres de haut, ce sont les espèces qui nichent dans les arbustes et les arbres qui s'installent. Elles vont pouvoir se maintenir jusqu'au dernier stade de la succession. Les espèces qui nichent dans les cavités ont besoin, elles, d'arbres hauts et vieux pour s'installer, ce qui explique qu'elles ne soient présentes que dans les derniers stades de la succession en futaie. Enfin, quelques espèces sont caractéristiques des stades de régénération qui sont des milieux et des peuplements forestiers très ouvert avec quelques gros arbres semenciers épars sur la parcelle et les espèces caractéristiques de ces stades de régénération sont des espèces qui nichent dans des milieux ouverts, avec des arbres isolés.
4. Biodiversité
D'une manière générale, on observe souvent que la diversité en nombre d'espèces est maximale au stade intermédiaire. Mais cette vision comptable en nombre d'espèces ne suffit pas… Il faut prendre en compte la nature des espèces qui est très différente selon les stades. À l'échelle d'un massif forestier, ce qui fait la diversité biologique est la juxtaposition de stades différents avec leur cortège d'espèces différentes adaptées à chacun. La juxtaposition de ces stades différents au sein d'un massif forestier crée une mosaïque changeante d'habitats, changeante parce que ces stades eux-mêmes évoluent, parce qu'ils sont chacun soumis localement à la possibilité de retour en arrière à cause de perturbations, donc de successions secondaires. Finalement, c'est l'interaction entre cette mosaïque changeante d'habitat à l'échelle du massif forestier et les traits des espèces qui les occupent, leur niche, leur compétitivité ou alors leur capacité de dispersion, qui fait en résultante la diversité biologique à l'échelle du massif forestier.
5. Cas des cycles sylvicoles
Dans le cycle sylvigénésique naturel des forêts, on assiste en général en l'absence de perturbations à la succession classique, de phases pionnières, post-pionnières, phases matures et puis de phases de vieillissement, de phases terminales. Dans les phases terminales, les très gros et vieux arbres finissent par mourir et s'écrouler, créant des trouées dans le peuplement forestier, à l'intérieur desquelles une régénération se met en place et un nouveau cycle repart.
Mais qu'en est-il dans les forêts qui sont gérées pour la production de bois par exemple ? On a là un cycle sylvicole dans lequel le forestier travaille en général au profit d'essences post-pionnières et dryades. Typiquement, dans une régénération qui contiendrait à la fois des espèces pionnières comme le bouleau et des espèces post-pionnières comme le chêne, le forestier travaillera directement au profit du chêne en éliminant les bouleaux, si bien que la phase de régénération, la phase pionnière est raccourcie voire court-circuitée. À l'autre bout du cycle, dans les stades terminaux, c'est la même chose en forêts gérées : les arbres sont exploités et abattus bien avant l'âge de leur longévité naturelle. Si bien qu'on peut dire schématiquement que les coupes sylvicoles sont une imitation des perturbations naturelles mais très inégale… d'autant plus que le bois abattu est exporté, que la régénération est en général accélérée au profit d'espèces commerciales et que les éclaircies sélectionnent en général les individus les mieux conformés pour ne laisser sur pied que les plus beaux individus parce qu'ils seront les semenciers du futur peuplement.
Ces pratiques sylvicoles entraînent plusieurs types de conséquences. D'une part, le cycle est tronqué : les stades de début et de fin de cycles sont perdus et avec eux tout le cortège d'espèces qui leur est associé. D'autre part, ces pratiques ont aussi une influence sur la diversité génétique des peuplements puisque les éclaircies font une sélection sylvicole qui vient contrebalancer la sélection naturelle. Enfin, dans les forêts gérées, on a souvent beaucoup moins de micro habitats tels que les cavités, le bois mort, les décollements d’écorce sur les troncs, que dans les forêts naturelles parce que les arbres porteurs de micro habitats sont en général éliminés et que les très vieux stades sont tronqués. De ce fait, les espèces qui sont liées à ces micros habitats et qui sont souvent des espèces typiquement forestières sont moins abondantes dans les forêts gérées.
6. Conclusion
La biodiversité forestière n'est pas figée. Elle évolue tout au cours de la succession forestière, en fonction des stades sylvicoles ou des stades sylvigénésiques. Elle est aussi influencée par la gestion forestière. Il est donc important de prendre en compte la biodiversité dans la gestion forestière avec une stratégie en deux temps. D'une part, il est nécessaire de concevoir des réseaux d'aires protégées dont l'objectif principal est la conservation de la biodiversité. Et d'autre part, il importe d'avoir des matrices de forêts qui sont gérées durablement, c'est-à-dire qu’en dehors de ces réseaux d'aires protégées, la gestion forestière cherchera à concilier la production de bois et la protection de la biodiversité, des sols et des paysages.
Pour cela, plusieurs points de vigilance sont à prendre en compte. Il faut avoir une attention particulière sur les forêts anciennes dont le couvert forestier permanent depuis plusieurs siècles a permis de faire des réservoirs d'espèces forestières qui ne pourraient pas se maintenir ailleurs. Les points de vigilance sont aussi les espèces typiquement forestières, la diversité génétique des essences, les stades âgés parce qu'ils comportent une grande quantité d'espèces forestières, ainsi que les bois morts et les micros habitats qui sont deux éléments incontournables pour la biodiversité forestière.