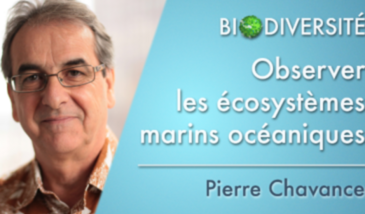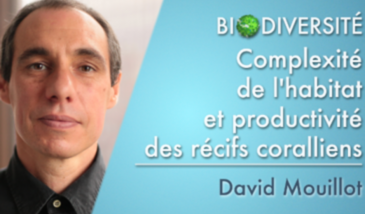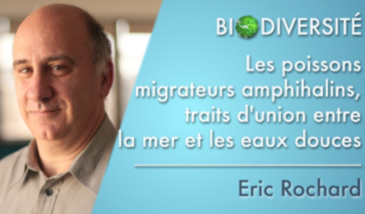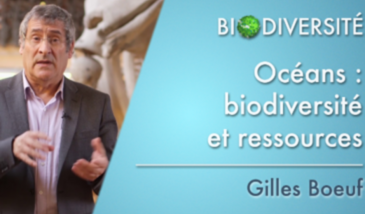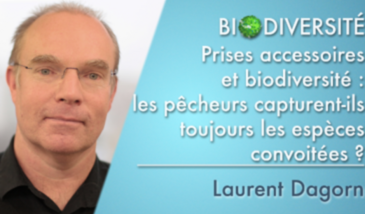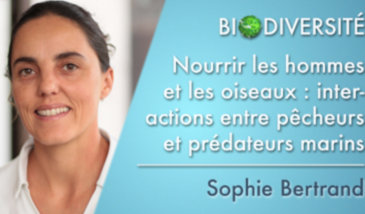En ligne depuis le 04/05/2015
5/5 (2)

Description
Audrey Darnaude nous amène à découvrir le rôle et l'importance des lagunes pour le fonctionnement de la biodiversité. Elle montre notamment à l'aide d'exemples dans le Golfe du Lion que la productivité côtière est étroitement liée à ces écosystèmes.
Objectifs d'apprentissage :
- Découvrir le rôle et l'importance des lagunes pour le fonctionnement de la biodiversité
- Comprendre le lien entre productivité côtière et écosystèmes
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
Types
- Grain audiovisuel
Contributeurs
Darnaude Audrey
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Ce document est la transcription révisée et chapitrée d’une vidéo du MOOC UVED « Biodiversité ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.
Les lagunes littorales : importance pour la productivité côtière des océans
Audrey DARNAUDE, Chargée de recherche, CNRS
1. Définition
Les lagunes sont des plans d'eau peu profonds, en général au maximum 10 mètres, qui sont situées à l'interface entre le domaine marin et le domaine continental. Elles sont séparées de la mer par une bande de sable et de galets meubles, qu’on appelle en général le lido et ce lido peut s'ouvrir sur l'océan par l'intermédiaire d'une ou plusieurs passes qu'on appelle des graux. Suivant le nombre de passes et l'intensité des échanges avec le milieu océanique, on dénombre dans le monde quatre grands types de lagunes. Il y a tout d'abord les lagunes estuariennes, qui sont en général situées à l'embouchure des grands fleuves, qui communiquent largement avec le domaine marin et ont une forme plutôt allongée vers l'intérieur des terres. Il y a aussi les lagunes ouvertes où en général se jettent plusieurs rivières et qui communiquent largement avec la mer. Il y a les lagunes semi-fermées qui ont moins d'apports continentaux et en général un seul grau. Enfin, il y a les lagunes fermées que ce soit de façon permanente ou temporaire.
En général, la présence de marnage faible est la condition la plus optimale pour le développement de lagunes littorales mais ça n'empêche pas les lagunes de se retrouver sur les côtes de tous les océans du globe, depuis le domaine arctique jusqu'en zone tropicale, en passant par les zones tempérées voire désertiques. La superficie des lagunes est extrêmement variable. Elle va de quelques dizaines de mètres carrés jusqu'à plus de 10 000 kilomètres carrés comme par exemple la lagune Dos Patos au Brésil, d'ailleurs visible depuis l'espace.
Au final, les lagunes représentent à elles seules 13 % du linéaire mondial recensé à ce jour. La côte de plusieurs continents dans le monde présente une succession sur de grandes distances de lagunes bien développées qui vont former une espèce de filtre entre la terre et l'océan.
2. Fonctionnement
Dans ces zones, les apports en rivières qui sont chargés en boues vont être piégées dans les lagunes, avant d'atteindre (et potentiellement d’enrichir) la zone côtière. Ca peut avoir une importance capitale pour la productivité de ces zones. Beaucoup de travaux ont démontré, depuis les 20 dernières années, que la productivité des zones côtières océaniques était souvent reliée aux apports en matières organiques continentales des fleuves et des rivières. C'est ce que nous avons pu démontrer dans le golfe du Lion où on a trouvé une forte corrélation entre les débarquements de poissons plats – comme la sole - et le débit du Rhône qui constitue la principale source d'apports continentaux en Méditerranée nord-occidentale.
Ce lien s'explique par l'exploitation de la matière organique particulaire amenée par le fleuve par les communautés benthiques vivant sur le fond. Le décalage temporel entre les crues du fleuve et les débarquements de soles s'explique complètement par la biologie et l'écologie de cette espèce. Il s'explique par son alimentation et par les délais de réponse aux crues des vers polychètes qui lui servent de proie préférentielle, au stade juvénile comme au stade adulte.
L'ensemble de ces résultats ont permis de mettre en évidence l'importance prépondérante de la matière organique particulaire dans la productivité des zones marines côtières. Or c’est essentiellement dans les lagunes littorales qu’elle se retrouve piégée.
3. Recherche
Les chercheurs se sont intéressés au piégeage potentiel de cette matière organique particulaire dans la chair des juvéniles de poissons marins qui visitent les lagunes pour ensuite retourner se reproduire en mer. Ils ont voulu estimer l'importance de ce comportement, à la fois pour le maintien des stocks exploités en mer mais également pour la productivité marine côtière.
Plusieurs poissons, en France, utilisent de façon importante les lagunes pendant leur stade de vie juvénile parce qu'ils sont capables de tolérer une dessalure importante pendant cette phase de vie. On les retrouve donc, année après année, en quantité très importante dans les lagunes littorales. Jusqu'à maintenant, on ignorait complètement l'importance pour le maintien des stocks en mer et pour la productivité côtière de ce comportement, notamment vis-à-vis de l'export vers la mer du carbone qui est potentiellement piégé dans la chair de ces poissons pendant leur vie lagunaire.
Les chercheurs se posaient cette question parce que si les lagunes représentent des avantages indéniables pour les juvéniles d'espèces euryhalines qui les fréquentent (ex : exclusion des prédateurs exclusivement marins), elles sont plus soumises que les zones côtières à tout ce qui est perturbations climatiques (ex : gelées hivernales, crises anoxiques estivales) ou pollutions bactérienne ou chimique. Ceci fait des lagunes autant de pièges potentiellement mortels pour les juvéniles de poissons qui choisissent d'y grandir et également potentiellement des voies sans issue pour les espèces qui choisissent de les coloniser.
C'est ce qui a été testé pour la sole et la dorade dans le golfe du Lion, qui sont toutes les deux connues pour fréquenter massivement les lagunes littorales malgré leurs biologies et leurs morphologies très différentes. On a capturé des adultes des deux espèces en mer et grâce à différents traceurs biogéochimiques présents dans leur chair et dans certaines de leurs pièces calcifiées, on a essayé de reconstituer leur histoire migratoire et leur histoire alimentaire.
4. Résultats
Ceci a permis de mettre en évidence l'importance forte des lagunes pour la constitution des stocks pêchés en mer puisque pour la dorade on avait au final uniquement 15 % des individus ayant survécu jusqu'à l'âge adulte qui avaient initialement grandi en mer. Dans le stock, on avait une dominance d'individus issus des lagunes dessalées. Pour la sole, on avait également une importance très forte des lagunes, de l’ordre d’à peu près 55 %. On voit donc que le maintien des stocks de ces deux espèces, qui sont exploitées en mer, dépend fortement de la qualité et de la diversité des habitats rencontrés par les juvéniles dans les lagunes. Il faut donc préserver l'ensemble de ces milieux.
Mais l'importance des lagunes pour la productivité côtière ne s'arrête pas là. Nos résultats ont permis de montrer que même si les apports en matière organique continentale dans les lagunes sont extrêmement variables d'une lagune à l'autre et également dans le temps au sein d'une même lagune, l'ensemble des organismes lagunaires sont capables de les exploiter. Ceci se traduit par un piégeage systématique de matières organiques d'origine continentale dans la chair de ces deux espèces malgré leur régime alimentaire différent. Evidemment, ce piégeage est différent suivant le type de lagune avec une importance plus marquée pour les lagunes de type dessalé où les apports sont plus importants mais il peut atteindre chez certaines dorades jusqu'à 75 % de la chair des individus et chez certaines soles jusqu'à 80 %. Donc ces résultats mettent en évidence un export non négligeable vers la mer de matières organiques continentales qui sans ces poissons seraient piégées dans les lagunes littorales. Ce genre de résultats est en ce moment en train d'être démontré pour d'autres lagunes, dans d'autres milieux et pour d'autres espèces, que ce soit en zone tropicale ou en zones tempérées. Mais dans tous les cas, il ne doit absolument pas être ignoré pour mieux comprendre la productivité des zones côtières et également le cycle du carbone, notamment en ce qui concerne les transferts entre le continent et l'océan.