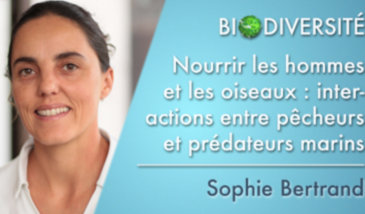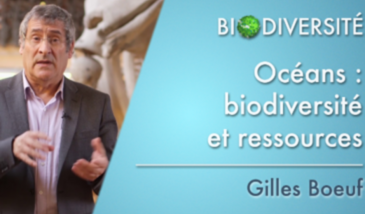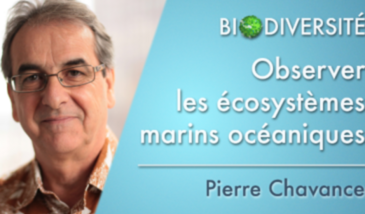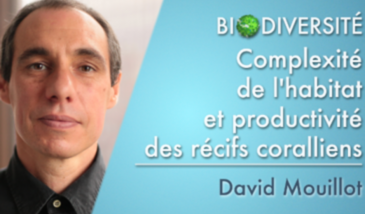En ligne depuis le 05/12/2014
5/5 (2)

Description
Laurent Dagorn pose le problème des prises accessoires dans le domaine de la pêche. Ces prises correspondent à ce qui est prélevé au milieu marin mais non recherché par les pêcheurs. Après avoir défini les termes de cette problématique, il expose quelques orientations et actions qui permettraient d'accroître l'efficacité de la pêche.
Objectifs d'apprentissage :
- Appréhender le problème des prises accessoires dans le domaine de la pêche
- Connaître les termes de cette problématique
- Orientations et actions pour accroître l'efficacité de la pêche.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+1
- Bac+2
Objectifs de Développement Durable
- 4. Education de qualité
Types
- Grain audiovisuel
Ce document est la transcription révisée et chapitrée d’une vidéo du MOOC UVED « Biodiversité ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.
Prises accessoires et biodiversité : les pêcheurs capturent-ils toujours les espèces convoitées ?
Laurent DAGORN, Directeur de recherche, IRD
Derrière les termes de pêche durable et raisonnable, on comprend en général des problèmes de pressions un peu trop fortes de pêche et des problèmes de quantité. Mais ce n'est pas simplement ça ! C'est aussi un problème de qualité. Le problème est de savoir si les pêcheurs capturent toujours les groupes espèces convoitées.
1. Prises cibles et prises accessoires
Cela nous amène à considérer deux statuts d'espèces différentes : des espèces cibles et des espèces accessoires. Lorsqu'un bateau part en mer, il part pour capturer une ou plusieurs espèces voulues. Ce sont les espèces cibles. Mais de manière accidentelle avec son engin de pêche il va pouvoir capturer à un moment donné d'autres espèces qui n'étaient pas convoitées, et qu'on va appeler des espèces accessoires. Une capture d'un bateau de pêche va donc correspondre à la capture d'espèces cibles et d'espèces accessoires.
Une espèce donnée n'a pas un statut d'espèce cible ou d'espèce accessoire. Ça va dépendre de la pêcherie, de l’engin de pêche et donc de la motivation également du pêcheur. Si on prend l'exemple de la pêche thonière à la senne, qui part pour capturer des thons listao, ils vont pouvoir capturer de manière accidentelle des coryphènes. Si on s'occupe de la pêche artisanale côtière, les pêcheurs vont aller en mer pour capturer des coryphènes et de manière accidentelle, cette fois, vont capturer des thons listao. On se rend donc bien compte que ce n'est pas un statut qui est donné pour une espèce une fois pour toutes. C'est un statut qui va dépendre de la pêcherie.
2. Diagnostic
Est est-ce que pêcher accidentellement des espèces qui ne sont pas voulues est une pratique acceptable et durable ? En fait, tout va dépendre des espèces, de la quantité qui est pêchée et du devenir de ces captures. Il faut se resituer dans le cadre de l'approche écosystémique des pêches. Traditionnellement, il faut se rappeler que l'objectif était de gérer des populations d'espèces cibles. Par exemple si on prend la pêcherie thonière, l'objectif était de gérer les populations de thons. Mais l'approche écosystémique nous a montré qu'on ne pouvait plus s'occuper que de ces espèces cibles mais qu'il faut justement s'occuper également des espèces accessoires. Comment y arriver ?
Tout d'abord, le premier pas est de pouvoir inventorier tout ce qui est pêché. Cela passe par des observateurs qui embarquent à bord des bateaux de pêche et qui vont voir et identifier l'ensemble des espèces qui sont capturées, mesurer leur taille et compter combien de poissons sont péchés. Si on prend par exemple la composition théorique d'une capture d'un bateau de pêche, on va tout d'abord avoir l'espèce cible qui est la raison pour laquelle le bateau est parti en mer. On va ensuite avoir une partie de la capture qui est composée d'espèces accessoires qui vont être gardées à bord soit pour une consommation par l'équipage, soit parce qu’en rentrant au port, ils vont pouvoir la commercialiser. On va aussi avoir une catégorie d'espèces accessoires qui cette fois vont être rejetées en mer parce qu'il n'y a pas d'intérêt commercial pour le pêcheur. On peut avoir une catégorie avec des espèces en danger qui elles aussi sont donc rejetées.
3. Gestion
Les objectifs de gestion concernent principalement deux catégories. Ça va être tout d’abord les espèces accessoires qui sont rejetées. Il va falloir les garder à bord, notamment pour un enjeu de sécurité alimentaire. Il faut avant tout éviter le gaspillage. L’autre enjeu est un enjeu de conservation. Il faut éviter d'effectuer des mortalités sur des espèces en danger, de manière à pouvoir ne pas impacter ces populations à risque.
Est-ce que pêcher plusieurs espèces est un problème ? Quand on regarde la Convention pour la Diversité Biologique, on se rend compte qu’un élément clé de l'approche écosystémique est justement de pouvoir conserver la structure et le fonctionnement d'un écosystème. Ce qui est un peu étonnant est qu’un des paradigmes qui était en cours dans la plupart des pêcheries dans le monde était justement d’essayer d'avoir une très bonne sélectivité des engins de pêche. Est-ce compatible justement avec maintenir la structure et le fonctionnement d'un écosystème ? La sélectivité est un processus à travers lequel la pêche va produire une capture. Mais cette capture aura une composition différente de ce qui existe dans l'habitat naturel. Il faut savoir que tout engin de pêche de toute façon est sélectif. Le risque est d'avoir une sélectivité qui va être mal appropriée. Et si elle est accompagnée d'une pression de pêche trop importante, on va pouvoir conduire à des modifications importantes d’un écosystème. C'est ce qu'il faut éviter.
4. Le concept d’exploitation équilibrée
Tout cela nous amène à considérer le concept d'exploitation équilibrée. Il faudrait pouvoir exploiter un écosystème en tenant compte de sa structure et de son fonctionnement, et en considérant l'ensemble des espèces, l'ensemble des tailles, en proportion à la productivité naturelle. Le concept est de modifier un peu le système actuel qui était de pouvoir gérer des populations. Or c'est une erreur ! On n’exploite pas des populations, on exploite un écosystème. C’est ce vers quoi il faut aller pour justement pouvoir avoir des pêcheries durables et raisonnables.
Il faut considérer le problème particulier des espèces en danger et notamment les espèces qui sont des mammifères marins, des requins, des tortues ou des oiseaux. Dans ce cas, il faut réussir à éliminer la mortalité de pêche. Il est important de faire un focus particulier sur les requins qui sont souvent des espèces mal connues. Les requins ont une biologie particulière, une maturité sexuelle tardive, une gestation longue de plusieurs mois. Une femelle va produire très peu de petits. On se retrouve donc dans une biologie qui est très différente des autres poissons, notamment des poissons téléostéens. Cette biologie ne permet pas aux requins de subir des exploitations importantes. Ils vont donc rapidement se retrouver dans des situations difficiles suite à une exploitation. L'objectif est alors de trouver des méthodes, des techniques, des mesures de gestions qui vont permettre de diminuer les captures de ces requins par les bateaux. Par exemple, pour la pêche à la palangre qui utilise des hameçons, si on remplace les appâts qui sont traditionnellement des calamars par des poissons, on peut réduire d'environ un tiers la capture des requins. On diminue ainsi l'impact de ces pêcheries sur les populations de requins.
5. Conclusion
D'une manière plus générale, il faut adopter des bonnes pratiques. Il faut que les pêcheurs, lorsqu'ils vont en mer, puissent adopter des bonnes pratiques à commencer par l’identification des espèces qu’ils capturent. Lorsque ce sont des espèces à risque, il faudra pouvoir les remettre à l’eau dans des bonnes conditions, en optimisant leur survie. C'est là-dedans qu'il faut accompagner les pêcheurs de manière à ce qu'ils puissent avoir des pêcheries durables et raisonnables, pas simplement en adaptant la pression de pêche. L’enjeu est de bien considérer qu'ils vont exploiter un écosystème, composé de plusieurs espèces, au regard desquelles les pratiques devront être adaptées.