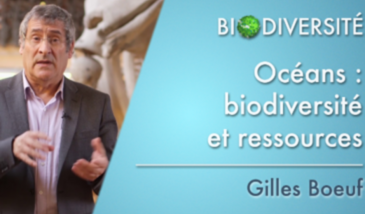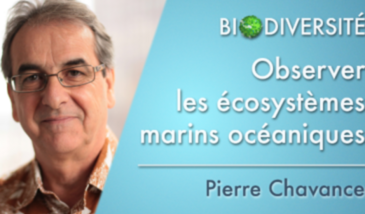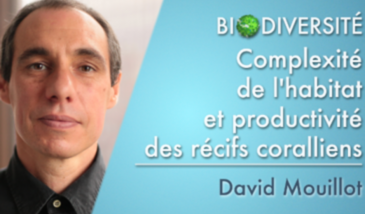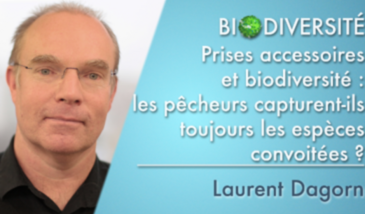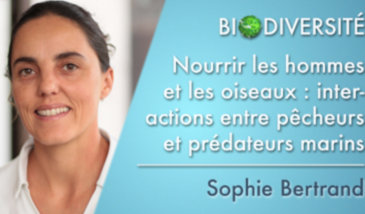En ligne depuis le 18/11/2014
5/5 (4)

Description
Florence Galletti, Chargée de recherche à l'IRD, propose un aperçu du droit de la mer et revient sur les grands enjeux qui lui sont associés. Elle pose un certain nombre de définitions essentielles pour bien comprendre ce domaine, revient sur les grandes évolutions de ce champ, et présente les défis à relever, comme par exemple la sécurisation des délimitations maritimes, l'encadrement des pêches en eau profonde, ou encore l'efficacité du droit international des pêches maritimes.
Objectifs d'apprentissage :
- Connaître les définitions essentielles pour comprendre le droit de la mer
- Appréhender les grands enjeux qui lui sont associés.
- Connaître les grandes évolutions de ce champ et les défis à relever
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Mentions Licence
- Droit
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
Types
- Grain audiovisuel
Contributeurs
Galletti Florence
IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Ce document contient la transcription textuelle d’une vidéo du MOOC UVED « Biodiversité ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres aux interventions orales des auteurs.
Droit international de la mer et ressources situées en mer : quels enjeux actuels ?
Florence Galletti
Chargée de recherche - IRD
1. Définition
Aborder la question des défis de la gouvernance environnementale des océans n'est pas détachable de la question du droit de la mer. Le droit de la mer est une matière juridique dont il faut aborder un minimum de définitions, de contenus, de principes et d'évolutions. Ce droit de la mer est assez peu souvent défini dans les ouvrages et les manuels. Une de ces définitions - elles sont peu nombreuses -, pourrait être celle-ci : l'ensemble des règles de droit international relatives à la détermination et au statut des espaces maritimes et au régime juridique des activités ayant pour cadre le milieu marin.
Si les espaces océaniques entrent parfaitement dans le champ de compétences du droit de la mer, la notion des mers qui entrent sous la compétence du droit de la mer est plus fine et plus complexe. Le droit de la mer va être compétent ; il va donc appliquer ces règles à des mers ouvertes et même à des mers quasiment fermées ou semi-fermées. Par contre, des mers totalement fermées ne seront pas concernées par la compétence du droit de la mer.
On peut donner plusieurs exemples. La mer Méditerranée est ouverte sur un espace océanique. Cette ouverture, par le détroit de Gibraltar, est une condition pour la qualifier de mer semi-fermée. Cette ouverture des mers semi-fermées vers l'océan peut se faire soit à travers des espaces sous statut de haute mer comme c'est le cas avec le détroit de Gibraltar, soit en passant par des zones d'exclusivité économique de plusieurs états riverains qui ont cette mer en partage. Un autre exemple de mer semi-fermée est celui de la mer Baltique dont l'ouverture sur la partie océanique se fait par le Danemark. Le Danemark a donc deux façades maritimes, une donnant sur une mer semi-fermée et l'autre donnant sur l'océan. On pourrait citer d'autres mers semi-fermées comme les mers asiatiques par exemple.
Le droit de la mer est une matière juridique issue du droit international dont il est finalement une branche. Ceci a un certain nombre de conséquences. La première de ces conséquences est que si les règles du droit international de la mer ne peuvent pas être imposées aux états mais, ceux-ci doivent les accepter. Ils les acceptent soit dans le cadre du droit de la mer coutumier, soit en signant et en ratifiant des conventions internationales écrites portant sur le droit de la mer et les usages maritimes. Une autre des conséquences est de mettre l'État en tant qu'institution publique comme premier acteur de l'application du droit de la mer en droit interne. Dans les problématiques de droit de la mer, se font face des Etats et non des opérateurs privés.
2. Transformations
Le droit de la mer est une matière qui a évolué dans ses perceptions et dans ses contenus. Que reste-t-il par exemple aujourd'hui de la controverse célèbre du XVIIIe siècle entre la mer libre, mare liberum, et la mer réservée, mare closum, de John Selden ? Il reste que c'est la mer libre dans ses usages et ses voies de communication qui l'a emporté jusqu'à aujourd'hui. La mer est d'usage libre bien que l'extension de l'emprise des états côtiers sur le milieu marin puisse faire penser de plus en plus que la mer dans certaines de ses parties est réservée à certains.
L’une des grandes transformations contemporaines est le développement extrêmement important, au XXe siècle, de la source écrite qu'on appelle aussi la source conventionnelle du droit de la mer. Le meilleur exemple est la signature presque quasiment universelle - bien que tous les Etats ne l'aient pas signée -, de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer du 10 décembre 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994. Mais il existe d'autres textes qui abordent les questions de droit de la mer, de droit des pêches etc.
Une autre transformation est celle de la souveraineté des Etats sur des espaces marins et sur des ressources de plus en plus éloignées des côtes. Un autre aspect est que sur le fond d'universalisme et d'uniformisation que l'on souhaiterait pour le droit de la mer, il se produit un certain nombre de doctrines maritimes régionales et expansionnistes. On a des pays d'Amérique du Sud, par exemple, qui ont une vision très régionaliste du droit de la mer. Mais on pourrait également citer l'interprétation chinoise du droit de la mer en mer de Chine.
On citera aussi l'intérêt clairement réactivé aujourd'hui pour des espaces situés au-delà des zones de juridiction. Par ailleurs, ne sommes-nous pas passés, aujourd’hui, à une ère de la protection des ressources marines pour elles-mêmes, via une entrée par la diversité biologique marine ? Avec un intérêt qui ne serait pas seulement le fait du caractère hautement commercial ou halieutique de certaines ressources de la mer ? Le statut de la haute mer lui-même est questionné quant à sa capacité à répondre à des problèmes nouveaux. Enfin, dans le devenir du droit de la mer, on soulignera le poids des conventions évidemment mais aussi des organisations intergouvernementales ou non-gouvernementales, en particulier dans le champ du droit de l'environnement.
3. Résultat
On a aujourd'hui une physionomie juridique des mers et des océans qui est différente d'une description biogéographique, physique et écologique. On ne peut parler de zone maritime en droit que face à des espaces qui ont chacun un régime juridique propre et qui ne peut être inventé. Les Etats ont donc sur ce principe établi des zones maritimes qui se distribuent entre des espaces marins classiques, parmi lesquels eaux intérieures, mers territoriales, zones d'exclusivité économique, plateau continental juridique par exemple, et des espaces marins plus particuliers : les îles sur le plan juridique, les baies sur le plan juridique, les détroits juridiques, les canaux internationaux, les eaux archipélagiques. Nous arrivons donc à une situation de fragmentation en espaces délimités horizontalement et verticalement sur la mer faute de s'être entendu sur un régime juridique unique pour les mers et les océans. On se trouve face à un dessin des espaces maritimes qui sont choisis par l'État dans un certain nombre de limites.
Le tracé des mers territoriales et de la haute mer révèle ceci : s'il est de coutume et de conventions écrites que les mers territoriales ne puissent pas excéder une largeur de 12 milles marins ce qui fait à peu près 22 km aujourd'hui, certains états ont des mers territoriales moins larges, comme par exemple la Grèce à six milles nautiques. De la même façon, la haute mer n'est pas à la même distance des côtes selon les façades et selon les Etats côtiers.
À la fragmentation des espaces maritimes correspond une fragmentation des régimes juridiques avec trois grandes directions. Un certain nombre d'espaces maritimes proches de la côte sont sous le régime juridique de la souveraineté en mer. Les espaces qui sont plus éloignés de la côte, par exemple les zones d'exclusivité économique et avant elles les zones contiguës, relèvent du régime juridique des eaux sous juridiction. Enfin, au-delà de la limite extérieure de ces zones sous juridiction, nous avons recours à des raisonnements qui portent sur la nationalité ou le droit du pavillon arboré par un navire, ou alors sur les compétences d'organisations internationales comme les organisations de gestion des pêches par exemple, qui permettent d'instituer des portions de règles juridiques et de droits sur des zones de haute mer.
4. Défis
De ce qui vient d'être dit ressort un contexte. Ce contexte est celui des défis actuels pour la gouvernance environnementale des mers et des océans, dont voici les principaux. D'abord il faudrait arriver à établir des délimitations maritimes sécurisées et apaisées. Ce n'est pas le cas : il y a à peu près 250 accords de délimitation maritime entre états et peut-être que 250 sont encore attendus. Il faudrait aussi augmenter le niveau d'efficacité du droit international des pêches maritimes y compris sur la haute mer, et y compris sur certaines questions comme la pêche illégale, non rapportée et non réglementée. Enfin, il nous faudra absolument arriver encadrer plus clairement et plus sévèrement les pêches spécifiques comme par exemple les pêches en eaux profondes. Il nous faudra aussi réglementer les nouvelles techniques d'exploration ou d'exploitation des ressources, notamment pour préserver l'hydrothermalisme ou la biodiversité marine des zones des grands fonds marins.
La protection juridique des environnements marins est un défi énorme. Dans ce contexte, on glisse d’un modèle de protection (celui des aires marines protégées aujourd'hui distribuées essentiellement à la côte et à l'intérieur des eaux sous juridiction) vers des formes de protection des ressources marines et des écosystèmes marins en réseau. Cela pose le problème de la couverture juridique de réseau écologique marin pour peu qu'on les connaisse et qu'ils aient été documentés et renseignés.
Enfin, le droit de la mer est un droit stratégique. Il l'a toujours été mais il l'a été un temps pour certains types de pays. Par exemple, les pays en développement ont réussi à faire passer l'idée de la zone d'exclusivité économique à 200 milles marins en mer, soit à peu près 370 kilomètres de linéaire depuis la ligne de base, ce qui leur permettait de contrôler les ressources situées dans la colonne d'eau.
Aujourd'hui, les Etats qui bénéficient du droit de la mer sont peut-être d'autres types d'Etats : des Etats à très grands linéaires côtiers, à très longues façades maritimes, des Etats archipélagiques qui disposent d'un domaine public maritime extrêmement important ainsi que celui qui leur est reconnu par le droit de la mer, et aussi peut-être des Etats qui ont des opérateurs capables de lancer les grandes campagnes d'exploration et, demain, d'exploitation de ressources de la mer qui ne sont pas seulement des ressources vivantes mais qui sont aussi des ressources minérales (ex : sulfures polymétallique).