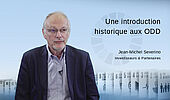En ligne depuis le 10/01/2022
3.9/5 (35)

Description
Les territoires français d'Outre-mer doivent aujourd'hui relever plusieurs défis, touchant aussi bien les aspects écologiques, économiques ou sociaux. Cet ensemble de vidéos permet de mieux comprendre ce besoin de développement durable dans les Outre-mer, et il vise à montrer que des personnes et des acteurs sont déjà engagés autour de ces questions, et ce sur tous les territoires ultramarins.
Objectifs d'apprentissage :
- Comprendre la diversité des points de vue qui existent quand on parle de développement durable dans les Outre-mer.
- Découvrir les 17 Objectifs de Développement Durable.
- Comprendre les caractères universels et indivisibles des 17 Objectifs de Développement Durable
- Appréhender les enjeux de développement durable les plus saillants pour les Outre-mer.
- Découvrir des personnes et des structures, dans tous les Outre-mer, engagées pour l'atteinte des Objectifs de Développement Durable.
- Comprendre l'importance des partenariats et de la coopération dans la mise en place de projets de développement durable.
- Comprendre les freins et les leviers pour la mise en place, par les différents acteurs du territoire, de projets de développement durable.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Cours
- Entretiens et témoignages
Niveau
- Bac
- Bac+3
Objectifs de Développement Durable
- 1. Pas de pauvreté
- 10. Inégalités réduites
- 11. Villes et communautés durables
- 17. Partenariats pour la réalisation des objectifs
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Introduction : Points de vue sur le Développement durable dans…

A la découverte des 17 Objectifs de Développement Durable

Les ODD dans le contexte des Outre-mer : 4 enjeux prioritaires

Exemples d'initiatives pour relever le défi du développement…

Conclusion : La mobilisation de tous les acteurs pour l'action…
Ce document est la transcription révisée, chapitrée et illustrée, d’une vidéo du MOOC UVED « Objectifs de développement durable ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.
Universalité sectorielle des ODD : tous les domaines sont couverts
Sarah Marniesse,
Ancienne directrice du Département de la mobilisation de la recherche et de l'innovation à l'IRD
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement, adoptés en 2000 par la communauté internationale, ont permis une forte mobilisation autour des enjeux de développement et un arrêt du déclin de l'aide publique au développement. Ils ont également permis des progrès spectaculaires dans certains domaines particuliers : la scolarisation, la santé maternelle et infantile ou la lutte contre les maladies transmissibles, surtout. Mais ils avaient quelques défauts.
1. Les OMD : quels défauts ?
Les OMD reposaient sur une approche très traditionnelle du développement, conçue comme un rattrapage socio-économique des pays du Sud sur les pays du Nord, avec un très fort focus sur la pauvreté et sur les secteurs sociaux. Il faut se souvenir que nous sortions de décennies d'ajustements structurels qui avaient vu l'explosion de la pauvreté. Ils avaient un autre défaut, celui de reposer sur une vision du monde en silo. Une approche qui fait très peu de place à l'intégration des objectifs, à l'étude des relations entre ces objectifs.
2. Emergence des ODD : le contexte
En 2015, les Objectifs du développement durable émergent dans un contexte qui est radicalement différent. C'est un contexte où on assiste à un brouillage des découpages, avec l'émergence de puissances du Sud. Nous ne sommes plus dans un monde binaire, mais dans un monde multipolaire, avec des puissances émergentes au Sud. Nous sommes dans un monde où les menaces se multiplient, où les risques explosent, en conséquence d'une croissance qui a été surtout quantitative, très peu qualitative. Une croissance économique qui détruit les ressources naturelles, qui dérègle les cycles, qui dérègle le climat, en particulier. Une croissance qui creuse les inégalités. Les limites planétaires commencent à être dépassées dans un certain nombre de domaines. On n'a pas de solution, on n'a pas de plan B. Il faut repenser les modèles de développement de tous les pays, bien sûr en tirant parti des énergies, de la créativité et en particulier de la révolution technologique et scientifique à l’œuvre. Mais c'est une autre histoire.
3. L’agenda 2030 du développement durable
À quoi ressemble cet agenda du développement durable ? Il se caractérise par trois grandes évolutions par rapport à l'agenda précédent.
- D'abord, un équilibre beaucoup plus net entre les trois piliers du développement durable : pilier économique, pilier social, pilier environnemental. Les Objectifs du Développement Durable concernant la planète sont beaucoup plus nombreux.
- Ensuite, cet agenda a cherché une beaucoup plus grande exhaustivité aux objectifs traditionnels qui concernaient la pauvreté, la santé et la scolarisation. On a ajouté des objectifs qui concernaient les biens publics mondiaux. Donc le climat on l'a vu, océans, par exemple. On a ajouté des objectifs qui reflétaient des débats internationaux très importants, par exemple le rôle de la gouvernance ou le rôle de la lutte contre les inégalités. On a ajouté un objectif très important également, qui concerne les partenariats. Parce que, aujourd'hui, c'est ensemble, ensemble pour les pays du monde, mais ensemble pour les acteurs, d'où qu'ils viennent, qu'il s'agit de construire cet agenda du développement durable.
- Nous sommes donc sur un agenda qui est beaucoup plus exhaustif, mais également qui fait la place à des objectifs intégrés, parce qu'on reconnaît la complexité du monde. On a besoin de cette intégration d'objectifs comme, par exemple, la construction de villes durables, qui mêle des problématiques très diverses, environnementales, sociales et économiques.
4. 17 ODD et 169 cibles
Pourquoi 17 Objectifs du développement durable ? D'abord, pour ne rien oublier. Les contributions ont été nombreuses, remontant du terrain, remontant de lobbys, également. Ces objectifs du développement durable reflètent non seulement ces nombreuses contributions, mais aussi la complexité du monde. Donc, on est sur un grand nombre de sujets. En même temps, huit objectifs du millénaire pour le développement, c'était beaucoup, alors 17, c'est un nombre important. On a essayé de réduire au maximum. On est arrivé à 17, un chiffre un peu bizarre, mais qui montre que rien n'était joué d'avance.
17 ODD, mais également 169 cibles. Et ce sont ces 169 cibles qui surtout montrent l'ambition de l'agenda. Des cibles de différents types, des cibles thématiques ou des cibles de moyens. Parmi les cibles thématiques, on peut citer, par exemple : d'ici à 2030, assurer l'accès universel et équitable à l'eau potable à un coût abordable. Des cibles de moyens, on peut citer : mobiliser les ressources financières pour préserver la biodiversité et les écosystèmes. Il faut aussi ajouter la forte ambition de certaines de ces cibles, qui se veulent vraiment transformatives.
- La cible 1 de l'objectif 10 sur les inégalités, par exemple, explique qu'il faut faire en sorte que les revenus des 40 % les plus pauvres de la population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national. Cette cible est très exigeante.
- La cible 3 de l'objectif 15 sur la vie terrestre, également, demande à parvenir à un monde sans dégradation des terres. C'est un sujet fondamental aujourd'hui.
5. Intérêts de cet Agenda
Que penser de cet agenda ? Il faut d'abord souligner le grand succès de participation qui a conduit à son élaboration. C'est un accord politique de près de 200 pays qui a fait accoucher de cet agenda. Ensuite, il faut noter que ces consultations exhaustives, ces négociations ont conduit à peu d'oubli, même s'il faut déplorer l'oubli de la culture, par exemple. L'accent a été mis sur des domaines clés pour construire un développement durable comme l'environnement, on l'a beaucoup dit, mais aussi la lutte contre les inégalités ou ce sujet si important qu'est la gouvernance. Enfin — et c'est important de le souligner — cet agenda essaie de raconter une histoire. Il illustre un changement de paradigme. On est à la fin d'un cadre binaire Nord-Sud. On est dans un monde complexe, on a besoin de vision intégrée, de vision systémique, mais aussi de vision positive de l'humanité future et de son cadre de vie.
Cet agenda essaie de construire les conditions d'un avenir souhaitable pour l'humanité et il fait appel à la participation et à la responsabilité de tous. Bien sûr, il existe de nombreux risques de critiques et de risques inhérents à sa construction. Des risques de SDG-washing, par exemple. Tout est ODD, et on l'entend souvent : si tout est ODD, rien n'est ODD. Il y a aussi un risque de piquer et de choisir ses objectifs sans critère. Il y a un risque de choisir sans priorités, alors qu'il y a des antagonismes, avec des choix qui ne seront pas nécessairement optimaux pour les pays qui choisissent sans critère. L'objectif est fixé, mais il n'y a pas de feuille de route. Donc, il faut construire ces feuilles de route. C'est un travail énorme.
6. Réaliser cet Agenda
La question la plus importante n'est pas traitée. C'est celle de la possibilité de réaliser cet agenda dans un contexte où les ressources sont limitées. Le chemin n'est pas indiqué. Il est difficile à trouver, mais pourrons-nous le trouver ? C'est vraiment la question essentielle aujourd'hui. Ce chemin existe-t-il ? La réalisation de cet agenda, aujourd'hui, entraîne une pression anthropique très forte. Serons-nous capables d'inventer des chemins qui limitent la pression anthropique ? Serons-nous capables de réaliser cet agenda en diminuant cette pression ?
Il faut inventer de nouveaux modèles. Il faut être créatif. Il faut inventer de nouveaux modèles qui limitent la consommation de ressources. Il faut ouvrir des voies, aller chercher dans des voies existantes, dans celles qui ont un autre rapport à la nature. Des voies comme le Buen Vivir, en Amérique latine, des voies comme celles qui sont tracées par l'économie symbiotique. Il faut être créatif pour parvenir à construire cet agenda du développement durable, à le mettre en œuvre dans un contexte de ressources limitées.
7. Evaluer les progrès
La question du suivi va être essentielle pour la réussite de cet agenda. 241 indicateurs de suivi ont été fixés par la Commission de statistique des Nations Unies. Ces indicateurs, ils sont évolutifs. Ils vont profiter des progrès faits dans les statistiques, dans la science. Ils vont s'améliorer au fil du temps. Ces indicateurs doivent également être complétés par les différents pays, pour coller à leurs caractéristiques, pour s'ancrer dans des contextes nationaux. Un réseau des processus de suivi et de revue a été mis en place, un forum politique de haut niveau annuel est là pour faire le point sur les avancées et un rapport sera produit tous les quatre ans. Mais la question importante concernant ces indicateurs est celle de la production de statistiques dans les pays les plus pauvres. La question du renforcement des capacités à produire des statistiques est essentielle, car il faut être capable de suivre, de mesurer les indicateurs concernant sa vie sociale, sa vie économique, sa vie politique, sa vie environnementale, pour parvenir à mettre en place un agenda du développement durable.
Contributeurs
Ferdinand Malcom
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Trottmann Charles
directeur du département des Trois Océans , AFD - Agence française de développement
Hierso Daniel
président d'Outre-Mer Network
Merckaert Jean
Directeur Action Plaidoyer France Europe à Secours Catholique-Caritas France
Moatti Jean-Paul
Professeur Emerite , Université Aix-Marseille
Severino Jean-Michel
Waisman Henri
Marniesse Sarah
AFD - Agence française de développement
PELLAUD Francine
Haute École Pédagogique de Fribourg (Suisse)
Ndour Yacine Badiane
Solano Philippe
Chotte Jean-Luc
Tribollet Aline
directrice de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
de Pracontal Nyls
président du groupe Outre-mer du comité français de l'UICN
Zammite Jean-Michel
directeur des Outre-mer , OFB - Office Français de la Biodiversité
Hermet François
Université de La Réunion
Briolin Sara
présidente de Femmes en Devenir
Martin-Prével Yves
directeur de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Roch Jérôme
directeur régional - Guadeloupe , ADEME
Demenois Julien
chargé de mission "4 pour 1000" , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Chignoli Claire
ingénieure "économie circulaire et déchets" , ADEME
Gaspard Sarra
professeure , Université des Antilles
Perche Mélanie
coordinatrice du REGAL Réunion
Devakarne Jaëla
coordinatrice d'Isopolis
Jacob Vincent
chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Reboul Lucile
Goût Nature
Law-Weng-Sam Betty
USEP Nord Réunion
Brunette Cléa
Assistante de projet au sein d'Unite Caribbean
Ozier-Lafontaine Harry
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Comier Annick
maire de la commune de Fonds-Saint-Denis en Martinique
Douine Maylis
médecin chercheur au Centre d'investigation clinique Antilles-Guyane
Edant Caroline
cheffe de projet Biodiversité , AFD - Agence française de développement
Charles Mahé
coordinateur technique du Secrétariat de l'initiative Kiwa
Dangles Olivier
directeur de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Souffou Tchico
chargé d'opération construction de la mairie de M'Tsangamouji à Mayotte
Lhoste Matthieu
directeur des travaux et de l'entretien de la mairie de M'Tsangamouji à Mayotte
Géraux Hubert
expert "Conservation & Plaidoyer Nouvelle-Calédonie" , WWF France
Bizien Thibaud
cofondateur de Caledoclean
Daniel Justin
professeur , Université des Antilles