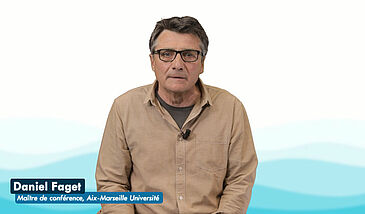En ligne depuis le 29/09/2021
0/5 (0)

Description
Rémi Mongruel, chercheur à l'Ifremer, discute dans cette vidéo de l'approche économique desproblématiques maritimes. Il s'intéresse tout particulièrement à l'évaluation économique des services rendus par les écosystèmes marins et à l'usage de ces évaluations pour les politiques d'exploitation et de conservation de l'océan.
Objectifs d’apprentissage :
- Découvrir les fondements et les approches de l'évaluation économique des services écosystémiques marins.
- Appréhender les intérêts et les limites de l'évaluation économique des services écosystémiques marins.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+5
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Mongruel Rémi
IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
Rémi Mongruel, Chercheur à l'Ifremer
Il existe, bien évidemment, une grande diversité d'approches en économie pour aborder les problématiques maritimes. Et, ce faisant, contribuer à l'aide à la décision et aux politiques publiques. On peut, par exemple, utiliser l'économie sectorielle, qu'on appelle l'économie industrielle, pour analyser l'évolution des activités maritimes. Ou bien l'économie des ressources naturelles renouvelables pour étudier les problèmes liés à l'exploitation des ressources halieutiques ou encore l'économie institutionnelle pour comprendre comment les acteurs s'organisent et mettent en place des systèmes de gestion.
Ici, je vais centrer mon propos sur une problématique particulière qui intéresse l'économie écologique : celle des politiques de préservation des écosystèmes marins. Ces politiques s'appuient de plus en plus fréquemment sur la notion de service rendu par les écosystèmes et posent donc non pas une mais deux questions aux économistes. Premièrement, comment évaluer les services écosystémiques, notamment marins ? Et deuxièmement, en quoi ces évaluations de services écosystémiques peuvent être utiles à la gestion des écosystèmes et aux arbitrages entre conservation et utilisation ?
L'idée que la nature rend des services à l'homme est probablement très ancienne. Dans sa conception moderne, l'approche par les services écosystémiques est née dans le contexte de la grande crise environnementale des années 1960-1970. La dégradation des écosystèmes est devenue une préoccupation, notamment pour le mouvement de la biologie de la conservation. Un de ses membres les plus éminents, Harold Mooney, affirmait dans un article de 1983 que toutes les tentatives de trouver des substituts aux services que rendent les écosystèmes se sont soldées par de lourds et coûteux échecs. C'est ainsi que l'approche moderne par les services écosystémiques va devenir une démarche de production de connaissances en appui aux politiques de conservation des écosystèmes et de la biodiversité. Pour les économistes, cette affirmation de Mooney fait écho à un débat qui s'était installé, là aussi, dans les années 1970, sur les modes de développement.
Le débat entre la soutenabilité faible et la soutenabilité forte. Avec cette idée que la soutenabilité faible se fixe simplement un objectif de maintien du capital total. Avec pour hypothèse que toutes les formes de capitaux sont substituables entre elles. Tandis que la soutenabilité forte impose le maintien d'un certain niveau de capital naturel qu'on appelle le capital naturel critique. Critique car non remplaçable.
Partant de là, les économistes qui travaillent sur les services écosystémiques vont se placer, s'ils sont cohérents, dans la perspective de la durabilité forte et s'intéresser aux questions de savoir pourquoi et comment, c'est-à-dire de la manière la plus efficace ou acceptable socialement, conserver ces fameux écosystèmes et services qui n'ont pas de substituts. Ou encore, jusqu'à quel point et comment on peut réaliser des arbitrages entre conservation et développement. On va trouver ces économistes principalement au sein de la mouvance de l'économie écologique. Mais la science économique n'étant pas une science unifiée, ils ne sont pas forcément d'accord entre eux, même au sein de l'économie écologique. Nous y reviendrons.
On classe habituellement les services écosystémiques en 4 catégories : les services d'approvisionnement, culturels, de régulation et de support. Ces 2 dernières catégories étant souvent regroupées. Les services écosystémiques sont extrêmement nombreux. Dans sa dernière version de 2018, la Common International Classification of Ecosystem Services, la CICES, en liste près d'une centaine, dont environ la moitié peuvent concerner les écosystèmes marins. Dans le cadre d'une évaluation nationale conduite pour le compte du programme EFESE du ministère de l'Écologie, nous avons listé les principaux groupes de services écosystémiques rendus par les écosystèmes marins, en réduisant cette liste à une quinzaine de groupes de services principaux.
Il existe différentes manières de mesurer ces services. En principe, une évaluation utile pour la gestion devrait distinguer pour chaque service le potentiel de service, le flux de service, c'est-à-dire la consommation effective de ce service par la société et la demande, qui peut être différente du flux car elle n'est pas toujours satisfaite. Et peut également prendre différentes formes, on y reviendra. En pratique, c'est compliqué. Les données manquent et on se contente le plus souvent d'une évaluation des flux, ce qui est très réducteur car on ne sait pas forcément si l'utilisation est durable, ce que nous confirmerait la connaissance de la capacité qui ne doit pas être dépassée par le flux, et satisfaisante socialement, ce sur quoi nous renseignerait l'analyse de la demande. Si on s'en tient aux mesures des flux, il y a une diversité d'approche, principalement 2, en fait. Les indicateurs physiques et les indicateurs monétaires. S'agissant des indicateurs monétaires. On a tendance à croire qu'ils reflètent la valeur des services écosystémiques. C'est beaucoup plus compliqué que cela. En réalité, ces indicateurs monétaires pouvant correspondre à différents types de valeurs selon la manière d'interagir avec l'écosystème dont ils rendent compte. De façon simple, on peut distinguer au minimum les valeurs d'usage, qui traduisent un rapport de consommation directe ou indirecte avec les services écosystémiques. Et les valeurs d'existence et de legs qui vont traduire le besoin de conserver certains services ou l'écosystème dans son ensemble, lorsque celui-ci apparaît très menacé à la société. Les valeurs d'usage sont en général mesurées par les prix de marché. Prix de marché du poisson pêché pour les services d'approvisionnement, dépenses de déplacement des usagers des services récréatifs. Les valeurs d'existence ou de legs sont mesurées par le coût des mesures prises pour conserver un service. On parlera d'approche par les coûts de maintien, ou par les consentements à payer par la mise en place d'une réserve, par exemple, on parlera ici de méthode des préférences déclarées.
Il n'y a donc pas une valeur monétaire unique des services écosystémiques, mais une grande diversité d'indicateurs monétaires qui se rattachent à des contextes socio-écologiques spécifiques et permettent simplement de mieux les comprendre.
Quel est le type de demande qui s'exprime ?
Est-ce une demande d'utilisation ou de conservation ?
Quel est l'état de l'écosystème faisant l'objet de ces demandes ?
Ce qui se joue avec l'évaluation économique de la nature est donc complexe. Une autre manière de le comprendre est de regarder cette courbe que l'on doit à David Pearce. On y voit que ce que mesure l'évaluation monétaire, c'est la valeur marginale de quelque chose. C'est-à-dire concrètement, le bénéfice marginal, le degré de satisfaction supplémentaire que l'on obtiendrait si l'on disposait d'un petit peu plus, une unité supplémentaire de ce que l'on possède déjà. Il faut lire cette courbe de la droite vers la gauche. Dans la partie droite, les écosystèmes sont abondants et en très bon état. Nous sommes donc déjà très satisfaits. Il y aurait alors peu d'avantages, de bénéfices marginaux, à attendre d'une unité supplémentaire de n'importe quel écosystème. C'est pour cela que la valeur est "paradoxalement" plutôt basse. Mais, si, au contraire, nous commençons à nous déplacer vers la gauche, nos écosystèmes deviennent plus rares, les milieux naturels se dégradent. Et la valeur que nous leur accordons, concrètement, le bénéfice marginal qu'il y aurait à recevoir une unité supplémentaire de nature, c'est-à-dire à retourner dans l'autre sens, cette valeur s'élève, voire se met à tendre vers l'infini si nous nous approchons des seuils critiques. Concrètement, dans ces situations, les demandes de conservation prennent le dessus sur les demandes d'utilisation. Ce qui nous impose d'adapter la manière dont on va utiliser l'évaluation économique.
On doit alors raisonner dans le cadre de la durabilité forte, c'est-à-dire considérer que le capital naturel restant n'a plus de substitut, subit des dommages potentiellement irréversibles et doit donc être protégé en tant que tel.
Bref, on en revient aux observations que l'on faisait tout à l'heure à propos de l'article d'Harold Mooney. Bien qu'elle continue à être répandue, y compris au sein du mouvement de l'économie écologique, et même dans le cadre des débats actuels de l'ONU sur la comptabilité environnementale, l'idée selon laquelle l'évaluation monétaire des services écosystémiques permet de connaître par sommation sur l'ensemble des services la valeur d'un écosystème, est erronée. Et l'identité qui suggère que la valeur du capital naturel est égale à la somme de la valeur actualisée nette, c'est-à-dire sur plusieurs années, des flux de services rendus par l'écosystème qui constituent ce capital naturel, est tout simplement fausse.
Regardez cette évaluation économique que nous avons faite pour les services écosystémiques marins du golfe normand-breton. Cette évaluation ne va rien nous dire sur la valeur économique totale de cet écosystème marin. Mais elle va nous montrer de façon distincte et sans les sommer, l'ensemble des moyens que différents groupes d'usagers, professionnels ou récréatifs d'une part, et la collectivité dans son ensemble d'autre part, mettent actuellement en œuvre, c'est-à-dire sur une année courante, pour utiliser les services écosystémiques marins ou pour les conserver. Ce qui est très utile pour réfléchir à la manière d'améliorer l'état de cet écosystème.