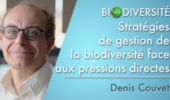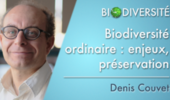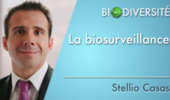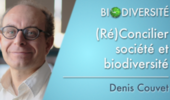En ligne depuis le 04/05/2015
2.6/5 (368)

Description
L'objectif du MOOC "Biodiversité", réalisé et coordonné par UVED, est d'amener les apprenants à mieux comprendre ce qu'est la biodiversité et les enjeux qui lui sont associés en matière de développement humain et territorial (culture, santé, ville, agriculture, etc.).
En apportant des points de repères sur ces questions et en montrant que la préservation des dynamiques écologiques est l'affaire de tous, ce MOOC entend contribuer à l'évolution des perceptions sociales en matière de biodiversité ainsi qu'à l'accroissement du niveau d'implication des acteurs sociétaux dans sa préservation. Ce MOOC introductif, qui ne nécessite pas de prérequis particulier, présente un intérêt pour l'ensemble des citoyens.
Référent scientifique : Gilles Boeuf (Muséum National d'Histoire Naturelle)
Gilles Boeuf est professeur à l'Université Pierre & Marie Curie, spécialisé en physiologie environnementale et biodiversité. Il est le président du Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) et a été Professeur invité au Collège de France en 2013-2014 sur la Chaire "Développement durable, énergie, environnement et société". Il est membre du Bureau d'IPBES, du Conseil Scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité (Ministère de l'Ecologie et du Développement durable) et du Comité de Perfectionnement du Centre scientifique de Monaco.
Objectifs d'apprentissage :
- Mieux comprendre ce qu'est la biodiversité
- Appréhender les enjeux qui lui sont associés en matière de développement humain et territorial (culture, santé, ville, agriculture, etc.)
- Comprendre que la préservation des dynamiques écologiques est l'affaire de tous
Deux niveaux de difficulté sont proposés selon les contenus de ce parcours : le niveau "Débutant" s'adresse aux apprenants de niveau Bac à Bac+3 (Licence), tandis que le niveau "Approfondi" est plutôt destiné aux apprenants de niveau Master et +.
Domaines
- Nature & Biodiversité
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Niveau
- Bac+1
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Biodiversité : définition et enseignement des crises du passé (12…

Océans : biodiversité et ressources (12 vidéos)

Biodiversité continentale : rivières et forêts (8 vidéos)

Biodiversité et agronomie (8 vidéos)

Biodiversité et santé (8 vidéos)

Biodiversité et ville (5 vidéos)

Gestion de la biodiversité (10 vidéos)

Biodiversité et société (11 vidéos)
Ce document est la transcription révisée, chapitrée et illustrée d’une vidéo du MOOC UVED « Biodiversité ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.
Biodiversité et services écosystémiques
Denis COUVET,Professeur - Muséum d'Histoire Naturelle
La notion de service écosystémique est tout à fait indispensable à la préservation de la biodiversité. Un service écosystémique est un bénéfice que les écosystèmes apportent aux humains.
1. Définition générale
Le Millennium Ecosystem Assessment, qui est une expertise mondiale réunissant plus d'un millier de scientifiques, a en 2005 standardisé et normalisé la notion de service écosystémique. Il a reconnu 24 services écosystémiques majeurs, arrangés en quatre catégories de services écosystémiques.
Ces quatre catégories représentent des enjeux sociaux et biophysiques très variés. Ceux qui vont nous intéresser plus particulièrement, en ce qui concerne la préservation de la biodiversité, sont les services de régulation et les services de support. Les services de support sont la base du fonctionnement des écosystèmes. La régulation environnementale est l'ensemble des services qui régulent le fonctionnement des écosystèmes.
2. Exemples de régulations environnementales
Un premier exemple de régulation apportée par les écosystèmes est la régulation du climat. Les forêts, les zones humides, stockent du carbone et, à travers ce stockage du carbone, atténuent le réchauffement climatique. Elles absorbent (les forêts, les zones humides, les océans) quelques 40 % des émissions de gaz à effet de serre. Sans cette absorption, et bien le climat se réchaufferait de manière beaucoup plus rapide. À travers ce stockage du carbone, on s'aperçoit que les forêts, notamment les forêts tropicales qui sont très menacées par l'extension d'un certain type d'agriculture, jouent un rôle tout à fait indispensable aux sociétés humaines en régulant le climat. Un autre type d'écosystèmes qui acquiert une valeur de totalement remarquable, ce sont les zones humides. Les zones humides jusqu'à récemment étaient considérées comme des territoires qui étaient hostiles aux populations humaines, aux sociétés parce que c'était des espaces qui étaient impropres à l'agriculture, et qui éventuellement étaient des vecteurs de maladies. A travers la notion de service écosystémique, notre conception des zones humides change radicalement. Des zones qui étaient hostiles aux humains deviennent des zones qui sont hautement bénéficiaires pour les humains parce qu'elles stockent du carbone, purifient l'eau, retiennent les nitrates, retiennent les polluants, etc. Maintenant, on essaie de les protéger pour des raisons qui peuvent très utilitaristes.
Un autre type de service écosystémique tout à fait important est la pollinisation. Pendant très longtemps, on s'en est peu préoccupé alors qu'elle est tout à fait indispensable à un certain nombre de cultures et, plus généralement, au maintien d’un grand nombre d'espèces végétales puisque 90 % des espèces végétales sont pollinisées par les insectes. On s'en est si peu préoccupés que cette pollinisation a pu disparaître d'un certain nombre d'écosystèmes. Actuellement, par exemple en Chine, dans certains types de productions agricoles, les agriculteurs sont forcés de remplacer les pollinisateurs qui ont disparu. Evidemment c’est énormément de travail pour ces agriculteurs chinois de remplacer les insectes pollinisateurs.
Un troisième type de service écosystémique est ce que l'on appelle le contrôle biologique. Le contrôle biologique, ce sont les espèces qui sont prédatrices des ravageurs des cultures. Notamment, ce sont les oiseaux, les chiroptères ou chauve-souris ou encore les insectes parasitoïdes qui sont des espèces qui sont carnivores de toutes les espèces d'insectes ravageurs.
3. Arbitrages entre services écosystémiques
On a un certain nombre de services écosystémiques qui sont associés de manière intime à la biodiversité et donc, la biodiversité s'avère indispensable au maintien de ces services écosystémiques qui sont nécessaires aux sociétés humaines. Une difficulté avec la notion de services écosystémiques est qu'il y a deux autres catégories qui sont déjà très bien connues socialement et qui sont préservées depuis longtemps. Il s’agit d'une part des services culturels, c'est-à-dire que les espaces verts, les paysages, les paysages touristiques qui ont des valeurs culturelles et donc économiques non négligeables. Ces paysages sont préservés à ce titre depuis un certain nombre d'années. Nous avons surtout les services d'approvisionnement, comme l'agriculture, la pêche, tout ce qui fournit finalement notre alimentation et notre eau potable.
Un des problèmes très importants que soulève la notion de services écosystémiques est l'arbitrage qu'il est nécessaire de faire entre ces différents services écosystémiques. C'est ce que présente la figure ci-dessous. Il existe une dialectique entre les services d'approvisionnement et les services de régulation. Le MEA constate que durant les dernières décennies, on a plutôt eu une amélioration des services d'approvisionnement : l'agriculture est de plus en plus performante et on produit de plus en plus de calories par humain. Mais par contre, lorsque l'on regarde les services de régulation, on constate une dégradation de manière très importante.
Le problème est que les services d'approvisionnement dépendent du bon fonctionnement des écosystèmes dont des services de régulation... A partir de là, on peut esquisser deux types de scénarios, voire même trois types de scénarios.
Un scénario serait la continuation. Mais cette continuation ne pourra pas se faire de manière éternelle. Il va y avoir un moment où si la dégradation des services de régulation est trop importante, on risque de déboucher sur un scénario catastrophe où les services d'approvisionnement ne seront plus assurés parce que finalement les fonctionnalités des écosystèmes auront disparu dans un certain nombre de cas. En Chine, on a quelques cas comme cela où, effectivement, les fonctionnalités des écosystèmes commencent à être sérieusement altérées.
Un autre scénario serait de modérer notre demande en services d'approvisionnements, de restaurer les services de régulation de manière à ce que l'on puisse avoir une amélioration générale sur l'ensemble des fonctionnalités des écosystèmes et donc des services de régulation et des services d'approvisionnement. Un certain nombre de scénarios qui ont été faits en Grande-Bretagne suggèrent que si on fait une évaluation économique, il serait avantageux à l'échelle de la Grande-Bretagne de modérer la production agricole et, à la place, de restaurer les écosystèmes. Les enjeux économiques derrière la restauration des écosystèmes, la promotion des espaces verts, et de tout un ensemble de fonctionnalités associées est finalement plus importante que la maximisation de la production agricole. Comment faire cela ? Il faut sans doute rémunérer les personnes qui dépendent des écosystèmes pour qu’elles restaurent les fonctionnalités des écosystèmes. C'est ce que l'on appelle les paiements pour services écosystémiques qui commencent à se mettre en place. Une expérience très spectaculaire est celle à laquelle s’est livrée la ville de Pékin. La ville de Pékin souffrait d'une eau qui devenait de qualité tout à fait insuffisante. Elle paye maintenant les agriculteurs du bassin versant de la ville de Pékin, quelques 1 million d'agriculteurs de manière à mieux préserver les fonctionnalités des écosystèmes et ceci au bénéfice à la fois des urbains donc des habitants de la ville de Pékin qui finalement bénéficient d'une eau de meilleure qualité et au bénéfice aussi des agriculteurs qui y puisent un surcroît de revenus tout en développant une activité qui finalement est socialement plus intéressante puisqu'ils font un compromis plus optimal entre la production agricole et puis les services de régulation.
4. Conclusion
Cette notion de service écosystémique est tout à fait centrale. Elle nous fournit une nouvelle entrée dans notre perception des écosystèmes et sur la manière de gérer de manière optimale les écosystèmes. A travers une meilleure préservation des services de régulation, on aura une meilleure préservation de la biodiversité parce que la biodiversité est associée de manière préférentielle aux écosystèmes qui sont riches en services de régulation.
Contributeurs
BAHUCHET Serge
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
MACHON Nathalie
CURY Philippe
BOEUF Gilles
Sorbonne Université
Ratnadass Alain
CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
COUVET Denis
Fontaine Colin
GOSSELIN Marion
HAINZELIN Etienne
CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Gouyon Pierre-Henri
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Maurel Marie-Christine
David Bruno
ancien Président , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Chavance Pierre
IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Mouillot David
Université de Montpellier
Darnaude Audrey
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Bonhommeau Sylvain
IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
Dagorn Laurent
IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Bertrand Sophie
IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Fromentin Jean-Marc
IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
Chaboud Christian
IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Galletti Florence
IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Rochard Eric
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Lobry Jérémy
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Datry Thibault
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Chauvin Christian
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Blanchart Eric
IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Swynghedauw Bernard
Sarrazin François
Robert Alexandre
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Casas Stellio
Dumez Richard
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Wahiche Jean-Dominique
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Roué Marie
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Demeulenaere Elise
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Artaud Hélène
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle