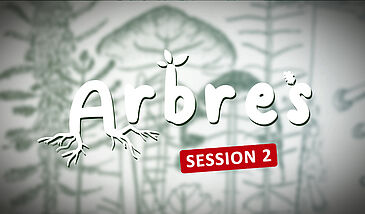En ligne depuis le 15/04/2025
4.5/5 (20)

Description
Ce parcours vous propose de découvrir les arbres, ce qu'ils sont, comment ils vivent, comment ils s'organisent et fonctionnent à différentes échelles d'espaces et de temps, et quels services ils nous rendent.
Objectifs d'apprentissage :
- Décrire les arbres et les identifier
- Expliquer comment les arbres perçoivent et interagissent avec leur environnement
- Nommer les mécanismes permettant aux arbres de s'adapter au changement climatique
- Identifier des pistes pour protéger ou déployer les arbres dans différents milieux (forêts, villes, champs)
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Sciences de la Terre
- Sciences de la vie
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
Objectifs de Développement Durable
- 13. Lutte contre le changement climatique
- 15. Vie terrestre
- 3. Bonne santé et bien-être
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Connaître et reconnaître les arbres

L’arbre dans son environnement

L'arbre et les changements globaux

Les arbres : questions irrésolues et place dans l’éthique
Ce document est la transcription révisée, chapitrée et illustrée d’une vidéo du MOOC UVED « Arbres ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.
Combien d’arbres connus et à découvrir ?
Jérôme Munzinger, IRD
1. Nombre d’espèces d’arbres connues
Combien d'espèces d'arbres sont connues sur terre ? Avant de parler de nombres, de donner des chiffres, il faut d'abord définir ce qu'est un arbre, et il existe une multitude de définitions de ce qu'est un arbre. Par exemple, si vous prenez le Larousse, un arbre est un végétal vivace, ligneux, rameux, atteignant au moins sept mètres de hauteur et ne portant de branches durables qu'à une certaine distance du sol. Pour la FAO, la hauteur va être de cinq mètres. Pour Cambridge, c'est une grande plante qui a un tronc en bois et des branches qui poussent à partir de sa partie supérieure. Une autre définition est celle du Groupe mondial de spécialistes des arbres de l'UICN, qui parle de plantes ligneuses ayant généralement une seule tige atteignant au moins deux mètres, et si elle a plusieurs tiges, ayant au moins une tige principale, verticale, d'au moins cinq centimètres de DBH.
À partir de cette définition, un consortium de 148 chercheurs à travers le monde ont essayé de calculer, de compter le nombre d'arbres présents sur la surface de la Terre, et ils ont obtenu un nombre global connu de 64 000 espèces réparties sur les cinq continents, avec, vous voyez, des valeurs d'un peu plus de 27 000 pour l'Amérique du Sud, un peu plus de 14 000 pour l'Eurasie, suivie de l'Afrique, un peu plus de 10 000, l'Amérique du Nord et l'Océanie. Si on fait la somme de tous ces chiffres, on dépasse les 64 000, puisqu'un certain nombre d'espèces d'arbres sont communes à différents continents. Et vous voyez aussi qu'on a la possibilité de regarder la concentration d'espèces et que le maximum de nombre d'espèces se retrouve dans la zone tropicale. Vous voyez ce rouge foncé qui montre jusqu'à plus de 20 000 espèces d'arbres concentrées sur certaines zones d'Amérique du Sud.
Dans ces travaux, les chercheurs ont estimé que le nombre probable d'espèces d'arbres serait en fait de 73 000, ce qui veut dire qu'entre le nombre connu de 64 000 et le nombre de 73 000, il y aurait au moins 9 000 espèces d'arbres inconnues pour la science, encore à découvrir. Il y a donc plein d'espèces d'arbres à découvrir sur Terre.
La question qui se pose, c'est : où peut-on trouver ces espèces d'arbres nouvelles qui ne sont pas encore connues ?
2. Où découvrir de nouvelles espèces ?
Vous avez sans doute en tête l'image d'un scientifique explorateur allant au sommet de montagnes comme celle-ci, vivant dans des conditions relativement sommaires dans la forêt, et, au hasard des rencontres, voir un arbre qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu jusqu'à présent, et qui s'avérera être une espèce nouvelle.
Cela peut être le cas, mais la réalité est tout autre. La réalité est que la plupart des espèces nouvelles sont trouvées beaucoup plus près de nous, en l'occurrence dans des collections que sont les herbiers.
Ce travail illustre le temps qu'il faut entre le moment où la plante est récoltée. Vous voyez, en abscisse, "0" signifie que les plantes viennent d'être récoltées cette année, "50", qu'elles ont été récoltées il y a 50 ans, et en ordonnée, le pourcentage de ces espèces restant à décrire. Tout en haut, on a l'équivalent de 100 % : toutes les plantes récoltées cette année sont à décrire. Ce graphique illustre que 50 % des plantes devant être décrites le seront dans les 25 ans en moyenne, alors qu'un grand nombre de ces plantes, les autres 50 %, vont mettre beaucoup plus de temps. Certaines vont nécessiter plus d'un siècle avant qu'un spécialiste se penche sur celles-ci, s'aperçoive que ce sont bien des espèces nouvelles, et les décrive. Ce travail illustre que la moitié des espèces nouvelles à décrire sur terre ont déjà été récoltées dans la nature, sont déjà dans des herbiers, en attente que quelqu'un travaille dessus.
3. Décrire les espèces
Maintenant que nous savons où découvrir les nouvelles espèces, reste à les décrire. Pourquoi décrire les espèces ? Nous avons besoin de nommer les espèces pour communiquer entre nous. On n'étudie, on ne protège, que ce que l'on connaît, ce qui est nommé. À titre d'exemple, si l'on parle du sureau noir, qui est comestible, ou du sureau hièble, qui est toxique, on a besoin de se transmettre les informations, on a besoin d'avoir des noms pour communiquer entre nous.
Qu'est-ce que l'espèce ? Une première définition, sans doute la plus objective, est la définition biologique de l'espèce, où, au sein d'une population d'individus, l'espèce correspond à l'ensemble de ces individus qui sont capables de se reproduire entre eux et de donner une descendance qui sera fertile, capable elle-même d'avoir une descendance fertile. Reste que cette définition biologique souffre d'exceptions, comme par exemple des cas documentés d'une population A qui est capable de se reproduire avec une population B, celle-ci, également, avec une population C, avec une population D... Reste que ce n'est plus possible entre la population A et la population D.
Et on voit ici que l'on touche aux limites de la classification, où l'homme essaye de mettre dans des boîtes, essaye de mettre des limites, dans des processus qui, parfois, sont continus. Ici, on voit qu'on est dans un phénomène de spéciation.
Reste que dans le cas de nos arbres, aborder le problème de la définition de l'espèce biologique est extrêmement compliqué, puisque vous imaginez bien que pour des petites annuelles que l'on pourrait mettre en culture et essayer de croiser différentes populations, il n'est pas envisageable de mettre en culture des arbres tropicaux qui vont mettre, pour certains, des dizaines d'années avant d'avoir des fleurs, et d'avoir d'autres populations, également, en culture, qui vont fleurir en même temps, et faire ces tests d'hybridation pour ensuite attendre de voir si les graines elles-mêmes vont donner des individus qui, peut-être dans des dizaines d'années, seront fertiles ou non.
4. Exemple
Ici, on a un ensemble d'individus, plutôt des spécimens d'herbiers, sur lesquels on va travailler, qui sont relativement proches, et l'on s'interroge sur le nombre d'espèces que l'on a au sein de cet ensemble.
On va regarder un certain nombre de caractères, qui peuvent être des caractères moléculaires, des caractères architecturaux, des caractères écologiques, des caractères anatomiques, des caractères sur l'architecture de la nervation, mais également des caractères comme, par exemple, l'ornementation des poils.
Cet ensemble de caractères va nous permettre de regrouper un certain nombre d'individus sur des caractères communs partagés, et à côté de ça, ces caractères qui vont les différencier d'autres groupes. Et dans notre exemple, on arrive à différencier, comme ça, trois ensembles qui sont bien soutenus, ce que l'on va appeler des espèces A, B et C, puisque les caractères sur lesquels on va travailler sont des caractères qui sont considérés comme étant au niveau de l'espèce. On va donc avoir ces trois espèces, A, B et C. On a donc fait ce que l'on appelle une taxonomie de l'ordre de l'espèce.
Reste qu'ensuite, la question se pose : comment doivent s'appeler ces trois entités ? Pour cela, on va aborder une autre discipline, que l'on appelle la nomenclature. Pour cela, on va aller rechercher dans des références, dans de la bibliographie, et trouver, par exemple, que cette espèce a une description qui correspond parfaitement à cet ensemble, et au sein de cette publication est désigné un spécimen d'herbier, ce que l'on appelle le type ou le porte-nom. Si on refait notre analyse avec ce spécimen d'herbier, celui-ci sera à l'intérieur de ce groupe, ce qui veut bien dire que ce que l'on a appelé l'espèce B peut en fait s'appeler Planchonella koumaciensis.
En poursuivant notre recherche bibliographique, on tombe sur une autre description, avec également un type, qui, celui-ci, rentre parfaitement au sein de ce premier groupe. La description colle parfaitement avec cet ensemble. On a donc affaire au Planchonella minutiflora en ce qui concerne l'espèce A.
Reste que malgré nos recherches en herbier, et parfois, le fait de trouver des spécimens supplémentaires que l'on n'avait pas identifiés jusqu'à présent, on se rend compte que l'on n'a aucune description qui colle bien avec cette espèce C, aucun spécimen type qui rentre dans cet ensemble. On a donc affaire à une espèce nouvelle qui va avoir besoin d'être décrite.
5. Décrire une nouvelle espèce
Pour cela, à partir de cet ensemble de spécimens, on va donc réaliser une description qui va intégrer une certaine variabilité de l'espèce. L'ensemble de ces échantillons va nous permettre d'avoir une idée de la variabilité de la taille des feuilles, de la longueur du pétiole, de la taille des fruits. On va donc réaliser une description, que l'on appelle la diagnose, en latin. On va lui choisir un nom. Au sein de cet échantillonnage, on va prendre un individu que l'on va appeler le type, le porte-nom, qui sera donc lié à ce nom d'espèce.
Cette description devra se faire en suivant des règles bien établies qui sont citées par le Code international de nomenclature botanique. Si l'on ne suit pas ces règles-là, le nom ne sera pas validé et sera rejeté par la communauté scientifique. Au moment de la publication, nous allons essayer de compléter notre description par une illustration scientifique qui permet de mettre en exergue un certain nombre de caractères qui sont pertinents. Et maintenant, nous avons la possibilité d'utiliser des photos de terrain, de publier un maximum de photos de terrain, de façon à illustrer la plante sur le terrain, la plante vivante.
Depuis quelques années, les taxonomistes proposent, au moment de leur description, une évaluation du statut de conservation, selon les critères UICN, afin de savoir si ces espèces doivent être inscrites sur la liste rouge des espèces menacées, de façon à ce que, dès leur description, on ait déjà cette information sur le besoin ou non de conservation.
Contributeurs
Munzinger Jérôme
chercheur
Boura Anaïs
maître de conférences , Sorbonne Université
Pilate Gilles
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Caraglio Yves
Ingénieur chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Atger Claire
chargée d'études à Pousse Conseil
Barbier Nicolas
chargé de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Trouy Marie-Christine
maître de conférences , Université de Lorraine
Gerber Sophie
chercheuse , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Lepaul-Picolet Shaan
Doctorante , Université de Bordeaux
Mariette Stéphanie
chargée de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Derroire Géraldine
chercheuse , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Isnard Sandrine
chargée de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Moulia Bruno
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Martin Francis
directeur de recherche émérite , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Selosse Marc-André
professeur , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Frey Pascal
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Blanc Lilian
chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Legay Myriam
directrice du campus AgroParisTech de Nancy
Muller Serge
Cosquer Alix
chercheuse , Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE)
Dumat Camille
professeure , ENSAT - Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
Le Cadre Édith
professeure , Institut agro Rennes Angers
Lenne Catherine
enseignante chercheuse , UCA - Université Clermont Auvergne
Dreyer Erwin
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Maury Stéphane
professeur , Université d'Orléans
Kremer Antoine
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Heuret Patrick
chargé de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Massonnet Catherine
Chargée de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Musch Brigitte
coordinatrice nationale des ressources génétiques forestières à l'ONF
Hallé Francis
Botaniste
Hiernaux Quentin
professeur à l'Université libre de Bruxelles