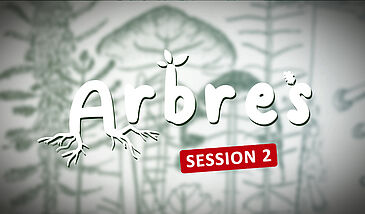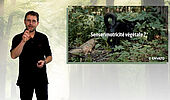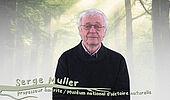En ligne depuis le 15/04/2025
4.5/5 (20)

Description
Ce parcours vous propose de découvrir les arbres, ce qu'ils sont, comment ils vivent, comment ils s'organisent et fonctionnent à différentes échelles d'espaces et de temps, et quels services ils nous rendent.
Objectifs d'apprentissage :
- Décrire les arbres et les identifier
- Expliquer comment les arbres perçoivent et interagissent avec leur environnement
- Nommer les mécanismes permettant aux arbres de s'adapter au changement climatique
- Identifier des pistes pour protéger ou déployer les arbres dans différents milieux (forêts, villes, champs)
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Sciences de la Terre
- Sciences de la vie
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
Objectifs de Développement Durable
- 13. Lutte contre le changement climatique
- 15. Vie terrestre
- 3. Bonne santé et bien-être
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Connaître et reconnaître les arbres

L’arbre dans son environnement

L'arbre et les changements globaux

Les arbres : questions irrésolues et place dans l’éthique
Ce document est la transcription révisée, chapitrée et illustrée d’une vidéo du MOOC UVED « Arbres ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.
La vie animée des arbres : sens, mouvements et exploration
Bruno Moulia, INRAE
Je vais vous parler de la vie animée des arbres : est-ce qu'ils ont des sens, quels sont leurs mouvements, comment ils explorent leur milieu.
1. La sensorimotricité
En sciences, on appelle ça la sensorimotricité, la capacité de percevoir et de bouger. On la connaît très bien chez les animaux. Si on regarde par exemple un chien qui explore une forêt, vous voyez très bien qu'il a des sens, la vision, l'odorat, le toucher, et même ce sixième sens qu'on connaît moins qui s'appelle la proprioception, notre capacité à percevoir notre forme et à contrôler notre mouvement et notre posture. On voit bien qu'il est doué de mouvements actifs, il réagit aux perceptions, il s'oriente aussi. En un mot, il est animé. C'est pour ça qu'on appelle les animaux des animaux. C'est grâce à cette sensorimotricité que les animaux explorent le monde et s'en font une perception. Jakob von Uexküll, au tournant du siècle, avait appelé ça l'"Umwelt", le monde activement perçu. Mais si on change le focus et qu'on regarde les plantes, les herbacées qui sont autour du chien, on ne voit pas de mouvements. Peut-on parler de sensorimotricité végétale ? C'est un oxymore ? C'est un anthropomorphisme ?
2. La sensibilité des plantes
Quand on regarde la définition des végétaux, on les définit comme des êtres vivants immobiles et fixés. La seule sensibilité, si on peut dire, qu'on leur prête, c'est celle de pâtir du stress et des outrages du temps. Justement, cette histoire-là est le point crucial : à quelle échelle de temps on les regarde ?
Ici, il y a eu un apport décisif du cinéma scientifique et plus récemment, de la capacité d'analyser quantitativement les mouvements au sein de ces images vidéo, ce qu'on appelle la cinématique. Je vais reprendre avec vous, je vais revisiter une expérience très classique.
On va prendre d'abord une herbacée, une arabette, et on va l'incliner dans le noir. On va la suivre pendant six heures en accélérant pour voir le mouvement. Le but est que vous regardiez bien son mouvement, avec attention. Vous voyez un très beau mouvement complexe qui lui permet finalement de se réorienter, de se réaligner sur la verticale et d'explorer ensuite la dimension verticale. Ça nous montre déjà que chez les plantes, à la différence de chez nous, la motricité est liée à la croissance. C'est en même temps qu'elles poussent qu'elles se déplacent.
Et donc, les plantes explorent le monde en poussant de manière orientée. C'est ce qu'on appelle le tropisme.
3. L’orientation des plantes
Alors, comment les plantes s'orientent ? La chose la plus connue est qu'elles s'orientent vers la lumière, qui est importante. Elles ont par exemple la capacité de percevoir, de s'orienter par rapport à la lumière bleue grâce à des phototropines, des pigments. C'est très utile, parce que dans un sous-bois, elles vont pouvoir trouver les trouées de ciel bleu et s'orienter vers elles.
Elles s’orientent vers la lumière bleue
Elles ont un deuxième type de capteurs qu'on a découvert plus récemment et qui est spécifique aux plantes, qui leur permet d'identifier si, à côté d'elles, il y a une voisine qui est aussi chlorophyllienne ou pas. Pour ça, elles ont un pigment, le phytochrome, qui va distinguer le rouge sombre, qui est réfléchi par les plantes et qui dit qu'il y a une plante, du rouge clair qui est absorbé et dit qu'il n'y a rien. Si on met deux plantes qui ont poussé à côté de réflecteurs qui miment le rouge ou le rouge sombre, quand la plante est à côté du rouge, elle pousse, et quand il y a du rouge sombre, elle s'éloigne pour ne pas rester proche de la voisine. Au total, vous voyez que c'est bien une forme de vision. Ce n'est pas juste une perception d'ambiance, il y a aussi une orientation qui se joue.
Elles perçoivent leurs voisines
Les plantes s'orientent aussi vis-à-vis de la gravité, comme nous. C'est connu depuis longtemps. Il y a des cellules spécifiques, les statocytes. Des tas de grains en bas, des grains denses, qui sont des amyloplastes, des grains d'amidon, et qui vont descendre avec la gravité et dire : "Où est le bas ?" Cette avalanche de grains va aller vers le bas et est facilitée par une petite agitation active liée à des moteurs moléculaires, l'actine et la myosine, et qui va permettre d'aller en bas et de mesurer l'angle au degré près, tout le long du corps de la plante.
Elles perçoivent la gravité
4. Et chez les arbres ?
Les arbres ont deux parties, une partie dans laquelle il y a de la croissance rapide, c'est la même que chez les herbacées, au bout de l'arbre. Si on prend un jeune peuplier, c'est la partie qui est au bout de la plante. Mais dans la partie basse, il y a déjà du bois. Le bois est rigide et ça ne devrait pas bouger.
Regardons bien ce qui se passe, c'est la même expérience qu’avec l’arabette. Ca dure dix jours, on va accélérer un peu plus. Dès les premières heures, la partie qui est en croissance rapide, la verte, va se réorienter comme tout à l'heure, mais regardez maintenant la base. Vous voyez un mouvement puissant qui permet à l'ensemble du tronc de se réorienter. Pour savoir comment elle peut faire ça, quel moteur permet ce mouvement, on peut faire une coupe dans le tronc et regarder les bois. Vous voyez ici avec cette coloration un bois spécifique qui se trouve sur le dessus de la plante, dans ces conditions-là. La plante a fait des couches de bois successives et ces couches se rétractent, ce qui lui permet de se courber dans une direction. Vous voyez que le bois, ce n'est pas qu'un squelette. C'est aussi un moteur. Le moteur des plantes est dans le bois. C'est la croissance du bois qui permet de bouger. Ce n'est pas que le peuplier.
Vous avez ici une photo d'un hêtre dans une pente, en Auvergne, où il y a des glissements. Ils arrivent très bien à se réorienter. Si on regarde une coupe, là, on n'a pas coloré, mais on voit la zone qui pousse plus rapidement, c'est le bois de tension du dessus qui aura permis de se réorienter. Ça veut dire que partout autour de nous, les arbres bougent sans cesse, ils sont sans arrêt en train de se reconfigurer et d'explorer.
Que se passe-t-il si on les désoriente ? Je vais vous décrire l'expérimentation de tout à l'heure. C'est la même expérimentation que sur le peuplier, mais on le fait pousser dans une sphère de lumière où la lumière vient de partout. Il ne peut pas s'orienter par rapport à ça. Il va s'orienter par rapport à la gravité. Quand il a commencé à se courber, on le met à tourner doucement autour de lui-même. Ceci empêche les petits grains d'aller vers le bas, il est incapable de sentir où est le bas et le haut par rapport à la gravité. Donc, on l'a désorienté. Si on focalise sur la zone dans laquelle il y a du bois, regardons bien le mouvement : elle se rectifie.
Nouvelle expérience avec le peuplier
Elle ne va pas vers le bas, car l'ensemble tourne. Quand on regarde comment il a fait, on peut regarder par une coupe et on voit qu'au début, il a mis du bois vers le haut, pour se rétracter dans ce sens, puis son bois de tension a changé de côté de manière à bien se rectifier. Ceci démontre que les plantes ont une capacité qu'on ne connaissait pas, la capacité de proprioception. Elles sentent leur forme, leur courbure, et ont un contrôle actif de la rectitude et de leurs mouvements. Sans ça, elles contrôleraient mal leurs mouvements.
5. Conclusion
Vous voyez qu'on peut bien parler de sensorimotricité tropique chez les végétaux, et ce n'est pas juste un réflexe. Vous voyez que ça combine continuellement plusieurs perceptions, lumière, gravité, forme propre, et que ça mobilise tous les organes de la plante, même le bois. Ça peut aussi mobiliser d'autres sens, par exemple le contact, le toucher, la perception des sons, une forme d'audition, s'orienter vers des sons, des perceptions aussi de substances chimiques en solution, une sorte de goût.
Vous voyez que finalement, les arbres perçoivent leur monde et le découvrent par des mouvements actifs, mais à leur rythme. On peut donc bien parler de sensorimotricité végétale et d'une exploration du monde perçu, donc, une "Umwelt" des végétaux, des arbres. Quand vous irez en forêt, essayez de vous mettre à la place des arbres.
Contributeurs
Munzinger Jérôme
chercheur
Boura Anaïs
maître de conférences , Sorbonne Université
Pilate Gilles
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Caraglio Yves
Ingénieur chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Atger Claire
chargée d'études à Pousse Conseil
Barbier Nicolas
chargé de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Trouy Marie-Christine
maître de conférences , Université de Lorraine
Gerber Sophie
chercheuse , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Lepaul-Picolet Shaan
Doctorante , Université de Bordeaux
Mariette Stéphanie
chargée de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Derroire Géraldine
chercheuse , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Isnard Sandrine
chargée de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Moulia Bruno
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Martin Francis
directeur de recherche émérite , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Selosse Marc-André
professeur , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Frey Pascal
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Blanc Lilian
chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Legay Myriam
directrice du campus AgroParisTech de Nancy
Muller Serge
Cosquer Alix
chercheuse , Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE)
Dumat Camille
professeure , ENSAT - Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
Le Cadre Édith
professeure , Institut agro Rennes Angers
Lenne Catherine
enseignante chercheuse , UCA - Université Clermont Auvergne
Dreyer Erwin
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Maury Stéphane
professeur , Université d'Orléans
Kremer Antoine
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Heuret Patrick
chargé de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Massonnet Catherine
Chargée de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Musch Brigitte
coordinatrice nationale des ressources génétiques forestières à l'ONF
Hallé Francis
Botaniste
Hiernaux Quentin
professeur à l'Université libre de Bruxelles