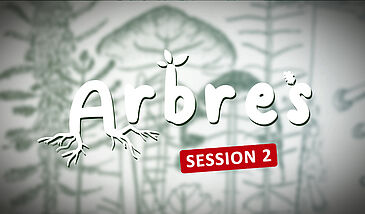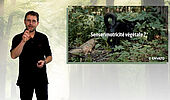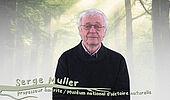En ligne depuis le 15/04/2025
4.5/5 (20)

Description
Ce parcours vous propose de découvrir les arbres, ce qu'ils sont, comment ils vivent, comment ils s'organisent et fonctionnent à différentes échelles d'espaces et de temps, et quels services ils nous rendent.
Objectifs d'apprentissage :
- Décrire les arbres et les identifier
- Expliquer comment les arbres perçoivent et interagissent avec leur environnement
- Nommer les mécanismes permettant aux arbres de s'adapter au changement climatique
- Identifier des pistes pour protéger ou déployer les arbres dans différents milieux (forêts, villes, champs)
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Sciences de la Terre
- Sciences de la vie
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
Objectifs de Développement Durable
- 13. Lutte contre le changement climatique
- 15. Vie terrestre
- 3. Bonne santé et bien-être
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Connaître et reconnaître les arbres

L’arbre dans son environnement

L'arbre et les changements globaux

Les arbres : questions irrésolues et place dans l’éthique
Les maladies des arbres
Pascal FREY, Directeur de recherche à l’INRAE
1. La santé des arbres
La santé des arbres peut être affectée par des causes abiotiques telles que les sécheresses, les canicules, le gel, les tempêtes, et par des causes biotiques, c'est-à-dire par des bio-agresseurs. Parmi les bio-agresseurs, on peut distinguer les ravageurs, c'est-à-dire des animaux tels que les insectes ou des rongeurs. On a aussi des agents pathogènes comme des microorganismes qui causent des maladies. Il est ici uniquement question des maladies des arbres causées par des agents pathogènes. Ces agents peuvent être des champignons (ex : oïdium du chêne), des oomycètes (ex : phytophthora de l'aulne), des bactéries (ex : galle du collet sur peuplier), des virus (ex : mosaïque du peuplier), et des nématodes (ex : nématode du pin).
2. Les organes des arbres concernés
Tous les organes d'un arbre peuvent être attaqués, des feuilles jusqu'aux racines. On a des parasites foliaires, comme par exemple la rouille du peuplier. La plupart des parasites foliaires, comme les rouilles ou les oïdiums, sont des parasites biotrophes obligatoires. Ils se nourrissent uniquement à l'intérieur des cellules vivantes de l'arbre, mais ne les tuent pas alors que la plupart des autres parasites sont des parasites nécrotrophes qui tuent les cellules et ensuite se nourrissent de la matière organique morte. Parmi les autres parasites, on a des parasites des branches tels que la chalarose du frêne, des parasites de l'écorce tels que la suie de l'érable, des parasites vasculaires, qui bouchent les vaisseaux de sève et conduisent à un flétrissement des arbres tels que la graphiose de l'orme. Au niveau des racines, on a des parasites des grosses racines, tels que les armillaires, et des parasites des racines fines, tels que les phytophtora.
3. Les maladies émergentes : cadre conceptuel
De nombreuses maladies des arbres sont qualifiées d'émergentes. Qu’est-ce que cela signifie ? Une maladie émergente est une maladie infectieuse dont l'incidence, la sévérité ou l'aire géographique a augmenté rapidement. Parmi les 11 principales maladies forestières en France, 6 peuvent être qualifiées d'émergentes. Pour expliquer ce mécanisme d'émergence, il existe le concept du triangle parasitaire qui est très connu en pathologie végétale. Pour avoir une maladie, il faut avoir à la fois une population hôte sensible, un environnement favorable et une population pathogène agressive.
Si l'adéquation entre ces 3 composantes augmente, on a l'émergence d'une maladie. Classiquement, on distingue 4 scénarios pour l'émergence d'une maladie. On peut avoir l'évolution de la population hôte. C'est le cas par exemple si on a introduit une nouvelle espèce d'arbre venant d'une autre aire géographique. On peut avoir l'évolution de l'environnement. C'est le cas, évidemment, avec le changement climatique. Il faut savoir que certaines maladies profitent de l'augmentation des températures pour se développer. On peut avoir l'évolution d'un parasite indigène. C'est-à-dire, le parasite est déjà présent dans notre zone géographique, mais il évolue au cours du temps par exemple du point de vue génétique ou par hybridation. Puis on peut avoir l'introduction d'un parasite exotique venant d'une autre aire géographique. C’est sur ce cas de figure que porte la suite de ce propos. On a montré que le nombre d'introductions augmentait régulièrement.
Sur ce graphique, vous avez le nombre cumulé de champignons pathogènes exotiques introduits en Europe entre 1800 et 2000. Comme vous pouvez voir sur la courbe, ce nombre augmente de façon exponentielle. On en est maintenant à environ 80 espèces de champignons pathogènes exotiques. À quoi sont dues ces introductions ? Elles sont dues à l'augmentation des échanges intercontinentaux de matériels et de personnes liés à la mondialisation.
4. L’exemple de la chalarose du frêne
Je vais vous présenter un exemple de maladie émergente liée à une introduction : la chalarose du frêne, bien connue maintenant en France. La chalarose du frêne est causée par le champignon ascomycète Hymenoscyphus fraxineus dont la forme asexuée s'appelle Chalara fraxinea, d'où le nom de "chalarose".
Au départ, le champignon infecte les feuilles et cause des petites nécroses foliaires, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Puis il colonise le pétiole et va entrer dans les tiges et causer des nécroses sur ces tiges. Si on fait une coupe sur cette tige, vous voyez que l'intérieur de la tige est nécrosé. Petit à petit, le houppier va se dégrader, avec de plus en plus de branches mortes. Du point de vue du cycle du champignon, lorsque les feuilles de frêne tombent au sol en automne, les folioles se dégradent très rapidement. Mais au printemps suivant, on va retrouver les pétioles, comme on voit ici. On va alors voir apparaître de tous petits champignons blancs, des apothécies, qui sont la forme de reproduction sexuée d'Hymenoscyphus fraxineus. Ces apothécies vont produire des spores sexuées, les ascospores, qui vont être dispersées par le vent et qui vont aller attaquer d'autres frênes dans la région. Ces ascospores sont également capables d'attaquer la base des arbres, le collet, et causer des nécroses au niveau de ce collet ce qui peut entraîner la mort des arbres.
La chalarose du frêne a émergé en Pologne et en Lituanie dans les années 1990, et ensuite s'est répandue sur toute l'Europe, vers le nord, vers l'est, le sud et l'ouest. À partir de là, il était évident qu'il s'agissait d'un parasite exotique, et de nombreux chercheurs en pathologie forestière de par le monde se sont posé la question de savoir d'où il venait. Ils ont regardé les frênes dans leur zone géographique pour voir si le champignon était présent. Effectivement, en 2012, une équipe japonaise a identifié Hymenoscyphus fraxineus sur un frêne asiatique, le frêne de Mandchourie. Mais cette maladie n'était pas du tout décrite car les symptômes étaient très discrets. On suppose que des frênes de Mandchourie ont été déplacés d'Asie vers l'Europe, notamment vers la Pologne et la Lituanie, à l'époque de l'URSS, sous forme d'arbres d'ornement, mais on ne connaissait pas la maladie dont ils étaient porteurs. À partir de là, il y a eu un saut d'hôte, c'est-à-dire une adaptation à un nouvel hôte local, c'est-à-dire, au frêne commun Fraxinus excelsior. En France, la maladie est arrivée en 2008 et vous pouvez voir, sur cette carte de la progression géographique de la maladie entre 2008 et 2021, que la maladie s'est répandue sur une grande partie du territoire national et qu'elle atteint maintenant le Finistère et les Pyrénées.
On a pu calculer que la progression de la maladie était d'environ 50 km par an, ce qui correspond à peu près à la dispersion des spores par le vent.
Un point important est qu'il existe de 1 à 5 % de frênes résistants ou tolérants à la chalarose. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, le frêne de gauche présente très peu de symptômes, alors que le frêne de droite présente des symptômes importants avec un éclaircissement du houppier. Ces frênes résistants continueront à faire des graines et créeront une nouvelle génération de frênes résistants.
5. Conclusion
On a des maladies des arbres de plus en plus nombreuses, souvent liées à l'introduction d'agents pathogènes exotiques. Ces maladies peuvent également se combiner aux effets du changement climatique, comme les sécheresses, ou aux insectes ravageurs. Il est donc important de prendre des mesures de contrôle à l'importation, aussi bien pour les filières forestières professionnelles que pour les particuliers. Il est aussi important d'avoir une très bonne connaissance des agents pathogènes sur tous les continents afin de pouvoir anticiper les risques d'émergence de ces maladies.
Contributeurs
Munzinger Jérôme
chercheur
Boura Anaïs
maître de conférences , Sorbonne Université
Pilate Gilles
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Caraglio Yves
Ingénieur chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Atger Claire
chargée d'études à Pousse Conseil
Barbier Nicolas
chargé de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Trouy Marie-Christine
maître de conférences , Université de Lorraine
Gerber Sophie
chercheuse , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Lepaul-Picolet Shaan
Doctorante , Université de Bordeaux
Mariette Stéphanie
chargée de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Derroire Géraldine
chercheuse , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Isnard Sandrine
chargée de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Moulia Bruno
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Martin Francis
directeur de recherche émérite , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Selosse Marc-André
professeur , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Frey Pascal
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Blanc Lilian
chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Legay Myriam
directrice du campus AgroParisTech de Nancy
Muller Serge
Cosquer Alix
chercheuse , Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE)
Dumat Camille
professeure , ENSAT - Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
Le Cadre Édith
professeure , Institut agro Rennes Angers
Lenne Catherine
enseignante chercheuse , UCA - Université Clermont Auvergne
Dreyer Erwin
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Maury Stéphane
professeur , Université d'Orléans
Kremer Antoine
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Heuret Patrick
chargé de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Massonnet Catherine
Chargée de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Musch Brigitte
coordinatrice nationale des ressources génétiques forestières à l'ONF
Hallé Francis
Botaniste
Hiernaux Quentin
professeur à l'Université libre de Bruxelles