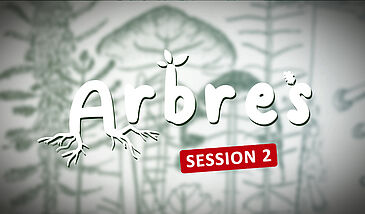En ligne depuis le 15/04/2025
4.5/5 (20)

Description
Ce parcours vous propose de découvrir les arbres, ce qu'ils sont, comment ils vivent, comment ils s'organisent et fonctionnent à différentes échelles d'espaces et de temps, et quels services ils nous rendent.
Objectifs d'apprentissage :
- Décrire les arbres et les identifier
- Expliquer comment les arbres perçoivent et interagissent avec leur environnement
- Nommer les mécanismes permettant aux arbres de s'adapter au changement climatique
- Identifier des pistes pour protéger ou déployer les arbres dans différents milieux (forêts, villes, champs)
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Sciences de la Terre
- Sciences de la vie
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
Objectifs de Développement Durable
- 13. Lutte contre le changement climatique
- 15. Vie terrestre
- 3. Bonne santé et bien-être
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Connaître et reconnaître les arbres

L’arbre dans son environnement

L'arbre et les changements globaux

Les arbres : questions irrésolues et place dans l’éthique
Les arbres : questions et menaces
Francis Hallé, Botaniste
Les animaux sont très bien connus parce que ça nous permet d'avoir accès à l'être humain. Depuis la plus haute Antiquité, les scientifiques se préoccupent des animaux. Les arbres sont très mal connus, parce que ça fait peu de temps qu'on les étudie. Même l'inventaire des arbres de la planète est très loin d'être terminé. On en est, je crois, à 80 000 espèces recensées, nommées, mais on en découvre 200 à 300 nouvelles par an. On est donc encore très loin d'avoir l'inventaire. Cela me terrifie de penser aux déforestations dans les tropiques humides, c'est-à-dire dans des milieux où il y a jusqu'à 20 ou 25 % des arbres qui n'ont pas de nom, qui ne sont pas connus, qui ne sont pas inventoriés.
1. Les questions non résolues
1.1. Définir l’arbre
On n'a toujours pas réussi à définir l'arbre. Moi-même, j'ai fait pas mal de définitions. À chaque fois, je tombe sur un exemple qui ne rentre pas du tout dans ma définition. La dernière fois, c'était en Afrique du Sud, dans la région de Prétoria. On m'a montré des arbres souterrains. On ne voit que les feuilles. Des arbres très gros, énormes, et très vieux. J'ai laissé tomber les définitions et maintenant, je ne veux plus m'occuper de ça.
1.2. L’arbre et la souffrance
Est-ce qu'un arbre blessé souffre ? C'est une question qui revient très fréquemment dans le public. On a des raisons de penser que oui, ils souffrent, parce que la blessure, une taille ou quelque chose comme ça, fait augmenter ses hormones de stress. C'est un peu comme nous, et ça va dans le sens de la souffrance. Mais il y a une autre raison qui va exactement à l'inverse. C'est que je ne vois pas à quoi ça servirait de souffrir alors que l'arbre ne peut pas bouger. Il ne peut donc pas s'écarter de la source de sa souffrance. Moi, oui, ça a un sens, un animal, ça a un sens. Mais un arbre, ça lui servirait à quoi ? Ce n'est pas une vraie réponse.
1.3. L’arbre et le vent
Les arbres utilisent-ils les mouvements du vent ? Ils n'arrêtent pas de bouger. Alors soit ça ne lui fait rien du tout, ni en bien ni en mal. C'est une position, mais ce n'est pas la seule. Ça peut lui faire du bien, il peut utiliser ces mouvements peut-être pour faire monter la sève plus vite. Ça peut lui faire du mal. C'est une question qui n'est pas résolue, et on attend que les laboratoires de biomécanique nous renseignent là-dessus.
1.4. Les excréments des arbres
Une question aussi qui préoccupe pas mal de gens est de savoir s'ils ont des excréments ou pas. La thermodynamique nous dit qu'il faut trouver leurs excréments. Ils en ont forcément. Peut-être que simplement, on ne sait pas les identifier. C'est un problème non résolu.
2. Les menaces
2.1. La déforestation
Il y a cette destruction effrénée qu'on constate dans le monde entier : des incendies, des abattages pour l'exploitation, des abattages juste pour faire de la terre agricole pour des champs de soja, comme au Brésil. La destruction est là, tout le temps. Et il ne faut pas croire que notre pays est à l'abri. Ça me dégoûte de penser que de France tout entière et même de beaucoup de pays d'Europe, on vient me demander comment faire pour protéger nos arbres. Le maire a décidé d'abattre des arbres. Je ne sais pas pourquoi ça le gêne. Ou il veut mettre une villa ou je ne sais quoi. Il a des quantités de raisons, qui ne sont, à mon avis, pas bonnes. L'arbre est vivant, respectons-le.
2.2. L’utilitarisme
L'utilitarisme est aussi une menace pour les arbres. Cela consiste à ne considérer dans les arbres que ce qu'ils peuvent nous rapporter. Ça sera sûrement très mauvais pour eux, et malheureusement, on est sur cette voie-là. La filière bois, la filière papier, parce que le papier a sa place là-dedans, ça fait énormément de dégâts.
2.3. L’anthropocentrisme
L'anthropocentrisme, c’est par exemple grimer les arbres en êtres humains. C'est une chose qui me déplaît. Ce n'est pas dramatique, mais il faudrait qu'on se débarrasse de ça. C'est terrible que l'être humain ne s'intéresse aux choses que quand ça commence à lui ressembler.
2.4. L’obscurantisme
Une chose qui m'intrigue, depuis que je travaille sur les arbres, est qu'on est environnés par l'obscurantisme. Je ne sais pas pourquoi les arbres, peut-être plutôt les forêts, mais ça retombe sur l'arbre, on a tendance à y voir des choses qui n'existent pas et qui souvent font peur. Les gens qui embrassent les arbres, c'est très bien, c'est très gentil, mais c'est de l'obscurantisme. Ceux qui essayent de soigner leur dos douloureux en le mettant contre un arbre et qui me disent : "L'arbre me donne son énergie", non, c'est ridicule, et c'est de l'obscurantisme à l'état brut.
3. Conclusion
Ça va progresser parce que, ça ne vous aura pas échappé, jamais nous n'avons eu autant, au niveau mondial, de productions sur l'arbre, que ce soient des films, que ce soient des dessins animés, des jeux vidéo, des livres scientifiques mais aussi des livres pour le grand public. Il y a un intérêt pour l'arbre qui est évident, et ça me réjouit profondément. Mais je voudrais dire à celles et ceux que les arbres intéressent qu’ils fassent attention à la progression très rapide de nos connaissances. S'ils n'essayent pas de se tenir au courant, ils vont être rapidement largués. Donc intéressez-vous aux arbres !
Contributeurs
Munzinger Jérôme
chercheur
Boura Anaïs
maître de conférences , Sorbonne Université
Pilate Gilles
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Caraglio Yves
Ingénieur chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Atger Claire
chargée d'études à Pousse Conseil
Barbier Nicolas
chargé de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Trouy Marie-Christine
maître de conférences , Université de Lorraine
Gerber Sophie
chercheuse , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Lepaul-Picolet Shaan
Doctorante , Université de Bordeaux
Mariette Stéphanie
chargée de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Derroire Géraldine
chercheuse , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Isnard Sandrine
chargée de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Moulia Bruno
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Martin Francis
directeur de recherche émérite , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Selosse Marc-André
professeur , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Frey Pascal
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Blanc Lilian
chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Legay Myriam
directrice du campus AgroParisTech de Nancy
Muller Serge
Cosquer Alix
chercheuse , Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE)
Dumat Camille
professeure , ENSAT - Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
Le Cadre Édith
professeure , Institut agro Rennes Angers
Lenne Catherine
enseignante chercheuse , UCA - Université Clermont Auvergne
Dreyer Erwin
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Maury Stéphane
professeur , Université d'Orléans
Kremer Antoine
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Heuret Patrick
chargé de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Massonnet Catherine
Chargée de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Musch Brigitte
coordinatrice nationale des ressources génétiques forestières à l'ONF
Hallé Francis
Botaniste
Hiernaux Quentin
professeur à l'Université libre de Bruxelles