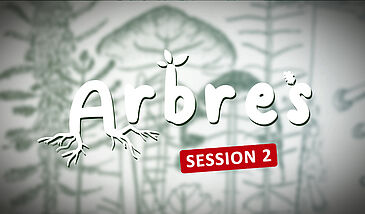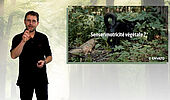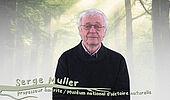En ligne depuis le 15/04/2025
4.5/5 (20)

Description
Ce parcours vous propose de découvrir les arbres, ce qu'ils sont, comment ils vivent, comment ils s'organisent et fonctionnent à différentes échelles d'espaces et de temps, et quels services ils nous rendent.
Objectifs d'apprentissage :
- Décrire les arbres et les identifier
- Expliquer comment les arbres perçoivent et interagissent avec leur environnement
- Nommer les mécanismes permettant aux arbres de s'adapter au changement climatique
- Identifier des pistes pour protéger ou déployer les arbres dans différents milieux (forêts, villes, champs)
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Sciences de la Terre
- Sciences de la vie
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
Objectifs de Développement Durable
- 13. Lutte contre le changement climatique
- 15. Vie terrestre
- 3. Bonne santé et bien-être
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Connaître et reconnaître les arbres

L’arbre dans son environnement

L'arbre et les changements globaux

Les arbres : questions irrésolues et place dans l’éthique
Ce document est la transcription révisée, chapitrée et illustrée d’une vidéo du MOOC UVED « Arbres ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.
Qu’est-ce qu’une forêt ?
Lilian Blanc, CIRAD
Définir une forêt semble simple : c’est un espace dominé par des arbres. Mais si l’on y regarde de plus près, c’est bien plus qu’un simple regroupement d’arbres. On peut donc aller plus loin en disant que c’est un écosystème complexe, vital pour la planète : elle génère de l’oxygène, capte le dioxyde de carbone et abrite une biodiversité foisonnante, allant des végétaux (et pas seulement les arbres !) aux animaux en passant par d’innombrables micro-organismes.
Mais posons la question autrement : À partir de quel moment un espace boisé peut-il être considéré comme une véritable forêt, et quand cesse-t-il de l’être ? La réponse devient alors beaucoup plus floue… Est-ce qu’une végétation avec des arbustes de deux mètres de hauteur est une forêt ? Est-ce qu’un espace avec une strate herbacée et des arbres est une forêt ?
1. La diversité des forêts
Définir une « forêt » peut donc s’avérer une tâche complexe car les forêts englobent des formations végétales très diverses. Ces formations vont de la taïga à la forêt dense humide. Classiquement, on distingue des quatre grandes catégories que l’on peut voir sur la carte : les forêts tropicales, subtropicales, tempérées et boréales. A l’intérieur de chacune de ces catégories, il existe aussi une grande diversité de forêts.
Prenons le cas des forêts tropicales. Les forêts tropicales denses humides ont des couverts forestiers très denses avec plusieurs strates et des arbres atteignant 50 mètres. On définit le couvert forestier comme la proportion de la surface du sol recouverte par la canopée des arbres lorsqu’on l’observe du dessus. On trouve ces forêts autour de l’Equateur, donc dans des régions avec un climat chaud et humide toute l’année et une pluviométrie abondante (supérieure à 2000 mm/ an). Ces forêts ont une biodiversité très élevée. On peut voir un exemple avec la forêt amazonienne vue de dessus où le couvert forestier recouvre 100% de la surface du sol.
Exemple des forêts denses humides
Toujours en zones tropicales mais beaucoup plus éloignées de l’Equateur, on peut avoir des forêts avec des faciès très différents comme les forêts sèches. Un exemple ici avec les forêts sèches du Zimbabwe. Il s’agit de forêts de Mopane, dominée par une espèce Colophospermum mopane (J. Kirk ex Benth.) de la famille des cesalpiniacées. Les arbres dépassent rarement 15 mètres de hauteur. Le couvert forestier varie mais n’atteint jamais 100%. C’est une forêt présente dans des régions de basse altitude, avec des précipitations faibles à modérées (de 200 à 1000 mm), des températures élevées, une saisonnalité très marquée où les arbres perdent leurs feuilles en saison sèche. Cette forêt de Mopane couvre 555 000 km²en Afrique Australe.
Exemple des forêts sèches
Dans la catégorie des forêt tropicales, on distingue aussi les forêts semi-décidues, avec des arbres pouvant attendre une 40ne de mètres dont une partie d’entre eux perdent leurs feuilles en saison sèche et les forêts tropicales de montagne, caractérisées par des arbres de plus petite taille (au maximum 20 mètres) aux troncs souvent noueux et tordus.
2. Vers une définition consensuelle de la forêt
Même s’il existe une grande diversité de forêts, il est important et nécessaire pour les forestiers et les institutions en charge de la gestion des forêts, d’avoir une définition consensuelle qui permet notamment de mesurer les surfaces couvertes par les forêts et leur évolution dans le temps.
Il existe environ 1 000 définitions nationales ou internationales regroupées en différentes catégories. Ces catégories se distinguent par des critères administratifs, écologiques ou par des critères liés à la couverture et à l’usage des terres. La plupart, environ trois quarts de ces définitions, concerne la couverture et l’utilisation des terres. Dans ce cas ces définitions reposent sur au moins 3 paramètres :
- La surface minimum couverte par une forêt ;
- La hauteur des arbres ;
- Et le pourcentage de couverture arborée ;
Critères généralement utilisés pour définir une forêt
La FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) a également sélectionné ces 3 critères. Selon cet organisme, une forêt est une surface d'au moins 0,5 hectare avec des arbres d'une hauteur supérieure à 5 mètres et une couverture arborée de plus de 10 %. A l’échelle globale cette définition permet de mesurer l’étendue des surfaces forestières Avec cette définition on estime que les forêts couvrent environ 4 milliards d’hectares à l’échelle planétaire soit 31% des surfaces émergées (surface terrestre libre de glace).
3. Les limites de la définition d’une forêt
Cette définition met l’accent uniquement sur la présence de l’arbre, sa hauteur et sa densité. C’est une définition qui se limite à la structure des arbres et des forêts. Les autres caractéristiques de la forêt ne sont pas prises en compte comme sa biodiversité par exemple. Ainsi une plantation forestière monospécifique (voire monoclonale c’est-à-dire avec des arbres génétiquement identiques) sera considérée comme une forêt. C’est une première limite.
Limite 1
Deux autres limites peuvent être mentionnées. Selon les valeurs seuils qui vont être utilisées par les différents pays, les estimations de surface forestière peuvent être très différentes. On peut illustrer ce point avec l’exemple suivant concernant le seuil de couverture arborée : Les forêts du Gabon, pays situé à l’Equateur sont des forêts tropicales denses humides avec des arbres pouvant atteindre 40 mètres et un pourcentage de couverture très élevé. Que le seuil soit à 10 ou à 30 %, comme on le voit sur l’exemple, l’estimation de la surface forestière sera très proche. En revanche, dans un pays possédant de vastes étendues de forêts sèches comme l’Ouganda, l’adoption d’un seuil à 30 % plutôt qu’à 10 % conduit à exclure plus de 10 millions d’hectares de la surface considérée comme forestière.
Limite 2
Enfin, cette définition ne tient pas compte de l’état des types forestiers : un peuplement d’arbres haut de 5 à 10 mètres de hauteur peut correspondre à une forêt sèche naturelle, donc sans perturbations dans le nord-est du Brésil (forêt de la « Caatinga ») ou à une forêt très dégradée (à cause du feu par exemple) de la forêt tropicale dense humide de l’Amazonie brésilienne.
4. Les enjeux de la définition d’une forêt
Les enjeux d’une définition plus précise des forêts et de leur état vont bien au-delà d’une simple estimation plus rigoureuse des surfaces forestières. Ils impliquent avant tout de lever les obstacles opérationnels à l’application des législations nationales et internationales visant à lutter contre la déforestation et la dégradation forestière. Une définition floue de la forêt et de son état entraîne inévitablement une évaluation biaisée de ces phénomènes.
Dans cette perspective, le Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE), qui entrera en vigueur en 2026, vise à interdire l’importation de produits issus de la déforestation dans sept filières agricoles. Cette initiative souligne combien la définition d’une forêt, loin d’être une évidence, constitue un enjeu complexe aux répercussions majeures.
Les enjeux d’une définition plus précise des forêts et de leur état vont bien au-delà d’une simple estimation plus rigoureuse des surfaces forestières. Ils impliquent avant tout de lever les obstacles opérationnels à l’application des législations nationales et internationales visant à lutter contre la déforestation et la dégradation forestière. Une définition floue de la forêt et de son état entraîne inévitablement une évaluation biaisée de ces phénomènes.
Dans cette perspective, le Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE), qui entrera en vigueur en 2026, vise à interdire l’importation de produits issus de la déforestation dans sept filières agricoles. Cette initiative souligne combien la définition d’une forêt, loin d’être une évidence, constitue un enjeu complexe aux répercussions majeures.
Contributeurs
Munzinger Jérôme
chercheur
Boura Anaïs
maître de conférences , Sorbonne Université
Pilate Gilles
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Caraglio Yves
Ingénieur chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Atger Claire
chargée d'études à Pousse Conseil
Barbier Nicolas
chargé de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Trouy Marie-Christine
maître de conférences , Université de Lorraine
Gerber Sophie
chercheuse , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Lepaul-Picolet Shaan
Doctorante , Université de Bordeaux
Mariette Stéphanie
chargée de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Derroire Géraldine
chercheuse , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Isnard Sandrine
chargée de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Moulia Bruno
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Martin Francis
directeur de recherche émérite , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Selosse Marc-André
professeur , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Frey Pascal
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Blanc Lilian
chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Legay Myriam
directrice du campus AgroParisTech de Nancy
Muller Serge
Cosquer Alix
chercheuse , Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE)
Dumat Camille
professeure , ENSAT - Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
Le Cadre Édith
professeure , Institut agro Rennes Angers
Lenne Catherine
enseignante chercheuse , UCA - Université Clermont Auvergne
Dreyer Erwin
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Maury Stéphane
professeur , Université d'Orléans
Kremer Antoine
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Heuret Patrick
chargé de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Massonnet Catherine
Chargée de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Musch Brigitte
coordinatrice nationale des ressources génétiques forestières à l'ONF
Hallé Francis
Botaniste
Hiernaux Quentin
professeur à l'Université libre de Bruxelles