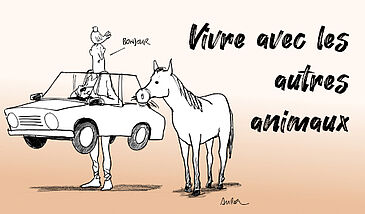En ligne depuis le 23/03/2020
3.4/5 (70)

Description
Les découvertes scientifiques de ces dernières décennies ont changé notre regard sur les autres animaux. Il en découle des questionnements sur nos relations avec eux, aujourd'hui et demain. Ce parcours vous apporte des repères pour vous permettre de vous situer sur ces questions de plus en plus discutées et débattues.
Mobilisant une grande diversité d'experts, issus d'horizons variés, il est organisé autour de trois axes :
- Les animaux : approches des sciences biologiques, humaines et sociales
- Des animaux et des humains : représentations d'hier et d'aujourd'hui
- Vivre demain avec les animaux
Deux niveaux de difficulté sont proposés selon les contenus de ce parcours : le niveau "Débutant" s'adresse aux apprenants de niveau Bac à Bac+3 (Licence), tandis que le niveau "Approfondi" est plutôt destiné aux apprenants de niveau Master et +.
Objectifs d'apprentissage :
- Savoir ce qu'est un animal.
- Situer l’humain par rapport aux autres animaux.
- Comprendre l'évolution de notre regard sur les autres animaux.
- Mieux appréhender la relation des humains aux autres animaux.
- Mieux comprendre ce dont les autres animaux sont capables : pensée, empathie, intelligence, communication,...
- Situer vos connaissances par rapport à un sujet de société complexe et controversé.
- Avoir un point de vue et des éléments de compréhension pour pouvoir mieux orienter vos réflexions et vos échanges.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Les animaux : approches des sciences biologiques, humaines et…

Des animaux et des humains : interactions d'hier et…

Demain, quelles relations avec les autres animaux ?
Ce document contient la transcription textuelle d’une vidéo du MOOC UVED «Vivre avec les autres animaux ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres aux interventions orales des auteurs.
Les sociétés animales : une introduction
Joël Meunier, chargé de recherche au CNRS
La vie de groupe est un phénomène très commun dans la nature. On le retrouve chez un grand nombre d'espèces d'invertébrés comme les crustacés ou les insectes, et un grand nombre d'espèces de vertébrés comme les oiseaux, les amphibiens, les poissons, et évidemment, les mammifères.
1. La vie de groupe
Les biologistes ont défini trois critères importants qui permettent de caractériser la vie de groupe.
Le premier critère est qu'il s'agit de plusieurs individus. On peut parler de groupe à partir de deux, trois individus, jusqu'à des milliers ou des centaines de milliers d'individus, comme on trouve chez les fourmis. Ces individus n'ont pas la nécessité d'appartenir à la même espèce.
Le deuxième critère est la distance permettant l'échange d'informations. Ces individus peuvent échanger, et doivent échanger des informations, que ce soit par le son, par l'odeur, ou par la vision. Lorsque les communications se font sous l'eau, comme chez les baleines, elles peuvent avoir lieu sur des centaines de kilomètres de distance.
Le troisième critère est que les individus doivent obéir à une loi d'attraction mutuelle. C'est-à-dire que les individus doivent être attirés les uns par les autres, et non pas se retrouver sur une place particulière, par exemple parce qu'il y a de la nourriture.
Une fois qu'on a ces trois critères, un élément important va être de pouvoir les utiliser pour définir les différentes formes de sociétés animales.
2. Les 5 ordres des sociétés animales
Le premier niveau de société est appelé la grégarité et se retrouve chez les espèces grégaires. L'exemple le plus commun est celui des blattes, qu'on trouve dans nos cuisines. Il est caractérisé par une vie de groupe très simple, dans laquelle les individus interagissent les uns avec les autres, mais n'expriment pas de très forts niveaux de coopération. Les unités de groupe, en tant que telles, peuvent être flexibles, c'est-à-dire que les individus peuvent appartenir à un groupe, puis à un autre.
Le deuxième niveau de socialité est appelé la subsocialité, ou simplement la vie de famille, qui consiste à avoir des unités dans lesquelles nous allons avoir un ou deux parents, qui s'occupent de leurs petits et, en général, qui leur apportent des soins.
Le troisième niveau de socialité est appelé la colonialité. La colonialité rajoute à la subsocialité que tous les individus et toutes les familles vivent dans le même environnement, sur le même lieu. On le retrouve beaucoup chez les espèces d'oiseaux qui vivent en bord de mer.
Le quatrième niveau de socialité est la communalité. Dans ce cas-là, tous les individus, toutes les familles, vont mettre en commun les petits. On va avoir des phénomènes de nurserie, dans lesquels certains adultes vont avoir la tâche de s'occuper des petits de tout le reste de la colonie.
Le cinquième niveau de socialité est présent chez les espèces dites eusociales. Il inclut par exemple les abeilles, les termites, les fourmis, et les guêpes. Ce niveau de socialité a deux caractéristiques. La première caractéristique est que certains individus vont monopoliser la reproduction. C'est le cas notamment des reines. La deuxième caractéristique est que dans ces sociétés, nous allons avoir de nombreuses générations qui vont se superposer. Pas uniquement une, lorsque c'est des adultes, ou deux, lorsque c'est les parents et les enfants, mais nous allons avoir des enfants de plusieurs générations qui se succèdent.
3. Bénéfices de la vie sociale
Toutes ces formes de vie sociale sont associées à des bénéfices. On a, par exemple, les soins aux jeunes, donc les soins parentaux, qui se retrouvent classiquement dans la subsocialité, mais qui peuvent se retrouver chez les autres formes, à l'exception de la grégarité. Il y a la défense de territoires, ces territoires pouvant être des ressources de la nourriture, ou des ressources consistant à une protection contre des prédateurs, ou contre des pathogènes. Un troisième exemple de bénéfices est la défense contre les prédateurs. Cette défense peut être relativement passive. C'est le cas des bancs de poissons où on va avoir un prédateur qui va arriver et, par un effet de dilution, le prédateur ne va plus savoir exactement quelle proie cibler. Du coup, les poissons vont avoir une meilleure chance de se défendre contre les prédateurs. On a aussi des modes de défenses qui sont beaucoup plus actives, comme c'est le cas chez les espèces eusociales. Si on prend l'exemple des guêpes, où certains individus de la colonie vont être capables de piquer les prédateurs, pour essayer de les faire partir.
4. Les risques de la vie sociale
Il faut bien garder en tête que ces bénéfices sont aussi à contrebalancer avec deux challenges majeurs, liés à l'évolution de la vie sociale. Le premier problème concerne les conflits sociaux. Ces conflits sont de nombreux ordres. On a d'abord un conflit entre les enfants, qui vont essayer chacun de monopoliser l'attention, et l'investissement des parents dans les soins. On va avoir un conflit entre les parents eux-mêmes, qui vont essayer d'optimiser leur investissement, et concrètement, d'essayer d'en faire un petit peu moins que l'autre parent, pour pouvoir économiser de l'énergie, et potentiellement, pouvoir se reproduire à côté. Puis on va avoir un conflit entre les parents et les enfants, les enfants étant, en général, sélectionnés pour demander plus de soins que ce que les parents ont intérêt à donner. Ces conflits, évidemment, ne sont pas uniquement dans le cadre de la vie de famille simple. Ils peuvent se retrouver chez toutes les différentes formes de vie sociale. Par exemple, on a des conflits dans les sociétés d'insectes eusociales, avec des conflits entre les reines, des colonies de fourmis par exemple, qui vont elles-mêmes essayer de monopoliser la reproduction, pour que chacune puisse se reproduire plus que les autres reines. Et puis, on va aussi avoir des conflits entre la reine, ou les reines, et les ouvrières ; là encore pour monopoliser la reproduction. Sachant que dans beaucoup d'espèces de colonies de fourmis, les ouvrières ont la capacité de produire des œufs, et donc la capacité, au même titre que la reine, de se reproduire au sein de ces colonies.
Le deuxième challenge majeur qui est lié à la vie sociale, c'est la transmission de maladies. Lorsqu'on vit en groupe, on a plus de chances d'être en contact avec un individu infecté, qui va lui-même avoir plus de chances de transmettre ces infections aux autres membres de la colonie. Chez les animaux, qu'ils soient sociaux ou pas sociaux, les individus ont toujours la possibilité de se défendre en utilisant leur propre système immunitaire. Évidemment, c'est le cas chez les espèces sociales. Mais les espèces sociales ont un avantage supplémentaire, qui consiste à une immunité sociale. Cette immunité sociale veut dire que certains individus, ou certains comportements, vont permettre de protéger l'ensemble du groupe contre l'infection par les pathogènes. Alors, des exemples classiques peuvent se retrouver chez les primates, où on va avoir un épouillage réciproque. Mais ce nettoyage réciproque se retrouve aussi, par exemple, dans les sociétés d'insectes, chez les fourmis. On va avoir aussi d'autres phénomènes un peu plus complexes, où on va voir des changements d'organisation de la structure de la colonie, des changements de réseaux d'interactions entre les individus, ou alors l'incorporation de molécules et de composés qui ont des propriétés antimicrobiennes à l'intérieur du nid. On a la propolis dans les ruches d'abeilles mais on a, par exemple chez les fourmis des bois, l'incorporation de résine avec des propriétés antimicrobiennes dans ces colonies-là.
5. Conclusion
Il y a une grande diversité dans les formes de vie sociale présentes dans la nature. Cette diversité se retrouve par une grande variation des bénéfices qui sont associés aux individus, et aux membres de ces groupes, mais aussi à des façons de résoudre les conflits sociaux et de limiter les risques de transmission de pathogènes entre les individus. Aujourd'hui, étudier cette diversité, les différents modes de fonctionnement, ainsi que la résolution des conflits et des challenges liés à la vie sociale est une des grandes questions de la biologie.
Contributeurs
BOEUF Gilles
Sorbonne Université
Dumez Richard
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Krief Sabrina
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Huchard Elise
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Saint-Jalme Michel
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Sueur Cédric
Université de Strasbourg (UNISTRA)
Lecointre Guillaume
professeur , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Brunois-Pasina Florence
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Roulot Justine
Ministère de la transition écologique
Tavernier-Dumax Nathalie
Université de Haute-Alsace (UHA)
Burgat Florence
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Lesur Joséphine
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Baratay Eric
Université Jean Moulin Lyon 3
Salines Georges
Dardenne Emilie
Université de Rennes 2
Béata Claude
Trinquier Jean
Ecole Normale Supérieure (ENS/PSL)
Césard Nicolas
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Dufour Valérie
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Beauchaud Marilyn
Université jean Monnet Saint-Etienne
Delahaye Pauline
Société française de zoosémiotique
Meunier Joël
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Laffitte Béatrice
Boivin Xavier
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Grandgeorge Marine
Université de Rennes
Dugnoille Julien
Université d'Exeter
Moutou François
Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Degueurce Christophe
EnvA - Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
Espinosa Romain
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Laprade Marie-Laure
Éducation Éthique Animale