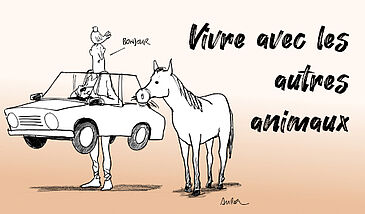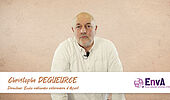En ligne depuis le 23/03/2020
3.4/5 (70)

Description
Les découvertes scientifiques de ces dernières décennies ont changé notre regard sur les autres animaux. Il en découle des questionnements sur nos relations avec eux, aujourd'hui et demain. Ce parcours vous apporte des repères pour vous permettre de vous situer sur ces questions de plus en plus discutées et débattues.
Mobilisant une grande diversité d'experts, issus d'horizons variés, il est organisé autour de trois axes :
- Les animaux : approches des sciences biologiques, humaines et sociales
- Des animaux et des humains : représentations d'hier et d'aujourd'hui
- Vivre demain avec les animaux
Deux niveaux de difficulté sont proposés selon les contenus de ce parcours : le niveau "Débutant" s'adresse aux apprenants de niveau Bac à Bac+3 (Licence), tandis que le niveau "Approfondi" est plutôt destiné aux apprenants de niveau Master et +.
Objectifs d'apprentissage :
- Savoir ce qu'est un animal.
- Situer l’humain par rapport aux autres animaux.
- Comprendre l'évolution de notre regard sur les autres animaux.
- Mieux appréhender la relation des humains aux autres animaux.
- Mieux comprendre ce dont les autres animaux sont capables : pensée, empathie, intelligence, communication,...
- Situer vos connaissances par rapport à un sujet de société complexe et controversé.
- Avoir un point de vue et des éléments de compréhension pour pouvoir mieux orienter vos réflexions et vos échanges.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Les animaux : approches des sciences biologiques, humaines et…

Des animaux et des humains : interactions d'hier et…

Demain, quelles relations avec les autres animaux ?
Ce document contient la transcription textuelle d’une vidéo du MOOC UVED «Vivre avec les autres animaux ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres aux interventions orales des auteurs.
Éducation à et conservation de la biodiversité : le rôle des parcs zoologiques
Michel Saint-Jalme, Maître de conférences au MNHN, directeur du Zoo du Jardin des Pantes
Le contexte général est le déclin de la biodiversité liée à la déforestation, à la fragmentation des habitats, à la surexploitation des ressources biologiques, à l’introduction d’espèces exotiques, à l’urbanisation, aux polluants environnementaux ou encore au réchauffement climatique.
1. Conservation in situ
Les solutions pour préserver cette biodiversité sont d’abord in situ : identifier les problèmes, légiférer, réglementer, protéger les habitats, les restaurer, à travers des réserves naturelles qui peuvent être, au niveau international, des réserves de biosphère, ou au niveau national, des parcs nationaux ou encore des réserves naturelles. Pour un certain nombre d’espèces, cependant, les menaces sont difficiles à contrôler, en particulier quand il s’agit de la disparition des habitats. Il est souvent impossible d’assurer la survie de ces espèces sans des mesures alternatives. C’est là qu’intervient ce qu’on appelle la conservation ex situ.
2. Conservation ex situ
La conservation ex situ est définie dans la Convention sur la diversité biologique comme "la préservation d’une composante de la diversité biologique en dehors de son habitat naturel". Cette conservation ex situ, en fonction du statut de conservation de l’espèce concernée, peut avoir des objectifs définis à court, moyen ou long terme. Il s’agit d’élevages conservatoires ou de propagation, de renforcements de population ou de réintroductions, de banques de gènes ou encore de recherches appliquées à cette conservation.
Pour un petit nombre d’espèces décimées par la chasse ou l’exploitation excessive, dès lors que les menaces sont contrôlées, on peut envisager des programmes de réintroduction. Des espèces emblématiques qui ont été réintroduites sont par exemple l'oryx d’Arabie, ou le tamarin-lion doré ou encore le cheval de Przewalski.
Cependant, lorsque les mesures in situ ont échoué et qu’aucune possibilité de réintroduction n’est envisageable, la seule chance de survie de ces espèces réside dans des plans d’élevage en captivité. C’est là qu’interviennent les parcs zoologiques qui se dénombrent à 1200 à travers le monde, et qui reçoivent 700 millions de visiteurs par an.
3. Les parcs zoologiques
Ces parcs zoologiques sont structurés en associations régionales. En Europe, cette association se nomme l’EAZA, European Association of Zoos and Aquaria. Elle a été fondée en 1988 et reconnue comme d’utilité pour la conservation de la biodiversité en 1993 par l’UICN, l’Union mondiale pour la nature. À travers the World Zoo Conservation Strategy, rédigé en 1993, on définit trois grandes missions pour les parcs zoologiques : l’éducation, qui est la mission prioritaire, la conservation, la recherche.
Ces trois missions sont également définies au niveau législatif, par tout d’abord la directive 22 de 1999, puis par l’arrêté du 27 mars 2004 qui fixe les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations et des établissements zoologiques.
4. Conservation
Les objectifs de ces programmes coopératifs d’élevage sont de maintenir, dans les populations captives, le maximum de diversité génétique existant dans les populations sauvages. On s’est donné pour objectif de préserver 90 % de la diversité génétique sur une période de 100 ans. Cela est possible avec des populations comprises entre 250 et 500 individus. Ces programmes fonctionnent grâce à un coordinateur dont la mission va être, en premier, d’établir le study-book, c’est-à-dire le livre généalogique, d’inventorier tous les spécimens en captivité, d’inventorier tous les ascendants jusqu’aux ancêtres sauvages qu’on appelle les fondateurs, et d’établir les liens de parenté entre l’ensemble de ces individus. Cela va permettre ensuite d’analyser la structure démographique et génétique de la population, de formuler les recommandations d’élevage et les directives d’entretien, de prescrire les appariements et les échanges entre les parcs zoologiques, et d’établir un plan de gestion à long terme, avec une taille cible de population qui sera définie en fonction de la diversité génétique souhaitée.
Imaginons une population sauvage dans laquelle on va extraire un certain nombre d’individus qu’on va appeler les fondateurs. Les généticiens nous recommandent d’en extraire 50 au hasard, sachant que statistiquement, ces individus vont représenter 99 % de la diversité génétique de la population d’origine. Ensuite, on va reproduire ces individus en faisant en sorte de maximaliser la représentation de chacun des fondateurs, jusqu’à atteindre une phase stabilisée comprise entre 250 et 500 individus qu’on va maintenir le plus longtemps possible, pour l’objectif final de 90 % minimum de cette variabilité génétique sur une période de 100 ans.
Un total de 402 espèces est concerné par ces programmes de conservation ex situ. Ces programmes sont réalisés grâce à 355 zoos en Europe issus de 44 pays. Ils concernent 60 % de mammifères et 31 % d’oiseaux.
5. Recherche
Une autre des missions principales associées à la conservation de la biodiversité est la recherche appliquée. Cette recherche appliquée à la conservation peut se décliner de différentes manières. J’ai choisi de parler de celles en relation avec le bien-être animal, le bien-être animal étant une des priorités aujourd’hui dans les parcs zoologiques européens. Ces études sont destinées à évaluer et améliorer le bien-être à travers différentes méthodes liées à l’enrichissement environnemental ou encore comportemental. Cet enrichissement peut être structurel, social, alimentaire, sensoriel, cognitif et appliqué grâce à des entraînements qui au départ étaient médicaux, mais maintenant destinés essentiellement à renforcer le lien entre l’homme et l’animal.
6. Education
La mission essentielle des parcs zoologiques est l’éducation à l’environnement, en particulier essayer de reconnecter le citadin à la nature, sachant que des études de 2016 ont montré qu’en ce début de 21e siècle, nous avions une certaine déconnexion à la nature, en particulier en ville. Pour répondre à ces questions du message éducatif transmis dans les parcs zoologiques, j’ai co-encadré une thèse d’Agathe Colléony en 2016, avec un certain nombre de questions comme : quelle nature perçoivent les visiteurs ? Les zoos reconnectent-ils les citadins à la nature ? Les zoos sensibilisent-ils à la conservation de la biodiversité ?
Nous avons obtenu un certain nombre de réponses. Par exemple, les visiteurs des zoos ont une préoccupation plus élevée pour la biodiversité que les visiteurs des parcs urbains. Néanmoins, une seule visite au zoo ne reconnecte pas à la nature, mais les visiteurs réguliers sont plus connectés par la biodiversité que les autres. La visite au zoo ne modifierait pas la connexion à la nature, car cette connexion serait issue d’un processus complexe dans lequel l’expérience de nature pendant l’enfance aurait un impact prépondérant. La visite au zoo serait un événement fondateur de l’enfance. Le zoo, pour le citadin, pourrait être un substitut à cette expérience de nature. Cela donnerait au zoo une responsabilité éducative très importante. La visite pourrait augmenter l’intérêt pour la biodiversité et les zoos auraient donc un fort potentiel pour l’éducation à l’environnement.
Contributeurs
BOEUF Gilles
Sorbonne Université
Dumez Richard
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Krief Sabrina
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Huchard Elise
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Saint-Jalme Michel
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Sueur Cédric
Université de Strasbourg (UNISTRA)
Lecointre Guillaume
professeur , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Brunois-Pasina Florence
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Roulot Justine
Ministère de la transition écologique
Tavernier-Dumax Nathalie
Université de Haute-Alsace (UHA)
Burgat Florence
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Lesur Joséphine
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Baratay Eric
Université Jean Moulin Lyon 3
Salines Georges
Dardenne Emilie
Université de Rennes 2
Béata Claude
Trinquier Jean
Ecole Normale Supérieure (ENS/PSL)
Césard Nicolas
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Dufour Valérie
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Beauchaud Marilyn
Université jean Monnet Saint-Etienne
Delahaye Pauline
Société française de zoosémiotique
Meunier Joël
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Laffitte Béatrice
Boivin Xavier
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Grandgeorge Marine
Université de Rennes
Dugnoille Julien
Université d'Exeter
Moutou François
Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Degueurce Christophe
EnvA - Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
Espinosa Romain
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Laprade Marie-Laure
Éducation Éthique Animale