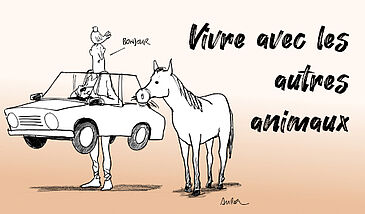En ligne depuis le 23/03/2020
3.4/5 (70)

Description
Les découvertes scientifiques de ces dernières décennies ont changé notre regard sur les autres animaux. Il en découle des questionnements sur nos relations avec eux, aujourd'hui et demain. Ce parcours vous apporte des repères pour vous permettre de vous situer sur ces questions de plus en plus discutées et débattues.
Mobilisant une grande diversité d'experts, issus d'horizons variés, il est organisé autour de trois axes :
- Les animaux : approches des sciences biologiques, humaines et sociales
- Des animaux et des humains : représentations d'hier et d'aujourd'hui
- Vivre demain avec les animaux
Deux niveaux de difficulté sont proposés selon les contenus de ce parcours : le niveau "Débutant" s'adresse aux apprenants de niveau Bac à Bac+3 (Licence), tandis que le niveau "Approfondi" est plutôt destiné aux apprenants de niveau Master et +.
Objectifs d'apprentissage :
- Savoir ce qu'est un animal.
- Situer l’humain par rapport aux autres animaux.
- Comprendre l'évolution de notre regard sur les autres animaux.
- Mieux appréhender la relation des humains aux autres animaux.
- Mieux comprendre ce dont les autres animaux sont capables : pensée, empathie, intelligence, communication,...
- Situer vos connaissances par rapport à un sujet de société complexe et controversé.
- Avoir un point de vue et des éléments de compréhension pour pouvoir mieux orienter vos réflexions et vos échanges.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Les animaux : approches des sciences biologiques, humaines et…

Des animaux et des humains : interactions d'hier et…

Demain, quelles relations avec les autres animaux ?
Ce document contient la transcription textuelle d’une vidéo du MOOC UVED «Vivre avec les autres animaux ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres aux interventions orales des auteurs.
Les "nuisibles" et les Hommes en ville
Georges Salines, Médecin en santé publique
Les villes ont été construites par les hommes pour les hommes, mais nous n’en sommes pas les seuls habitants. D’autres êtres vivants sont citadins ou le sont devenus. Lorsqu’ils nous embêtent, nous les qualifions de nuisibles. J’emploie ce terme au sens courant, et non en celui de la réglementation qui vise à autoriser la chasse ou le piégeage de certaines espèces d’animal, listées comme nuisibles dans des arrêtés préfectoraux. Qui sont ces nuisibles et qu’ont-ils fait pour mériter cette épithète péjorative ?
1. Les animaux qualifiés de « nuisibles » en ville
Certains animaux sont qualifiés ainsi parce qu’ils font des dégâts. Par exemple, les déjections des oiseaux, comme celles des pigeons, des étourneaux, des goélands salissent nos voitures, nos bancs publics, nos statues. Les insectes xylophages, comme les termites, abîment les bâtiments.
D’autres animaux sont en quelque sorte coupables d’un délit de sale gueule, comme cette superbe tégénaire, araignée domestique qui n’a jamais fait de mal à personne, sauf par la peur qu’elle suscite, à tort.
D’autres animaux sont capables de faire mal, voire même très mal, comme les frelons, qu’ils soient asiatiques ou européens. Ces insectes ne sont dangereux que si on s’y frotte de trop près. Il suffit de les ignorer pour qu’ils nous laissent tranquille.
Plus ennuyeux, ce sont les parasites qui se nourrissent de notre sang comme les punaises de lit qui sont en train de recoloniser nos villes dont elles avaient été chassées par le DDT. Elles ont au moins le mérite de ne pas nous transmettre de maladies infectieuses, semble-t-il.
Ce n’est hélas pas le cas d’autres insectes hématophages, comme celui-ci, le moustique-tigre, Aedes albopictus, qui a quitté les forêts du Sud-Est asiatique et qui envahit peu à peu toute la planète. Il est capable de transmettre des maladies graves, comme la dengue, la maladie de chikungunya ou le Zika.
Certains animaux peuvent nous rendre malades même sans nous piquer ou sans nous transmettre des bactéries ou des virus. C’est par exemple le cas des petits acariens qui vivent dans nos matelas, vis-à-vis desquels certaines personnes sont allergiques.
Enfin, tous les nuisibles ne sont pas des animaux. Les moisissures sont des fungi, comme les cèpes ou les amanites. Elles dégradent les surfaces intérieures des bâtiments trop humides et peuvent rendre malades leurs occupants via un mécanisme allergique ou toxique. Les plantes qui émettent des pollens anémophiles, c’est-à-dire qui confient leur pollen au vent et non aux insectes pollinisateurs, empêchent les personnes souffrant de rhume des foins de fréquenter les parcs et jardins à certaines périodes de l’année.
Ce rapide panorama, qui est loin d’être exhaustif, donne une idée de la variété des espèces dites nuisibles et de la diversité des griefs que nous leur adressons.
2. L’exemple du rat
Je voudrais maintenant que nous nous intéressions plus en détail au cas d’une espèce emblématique, les rats. Voici un rat d’égout parisien qui, comme vous le voyez, n’est pas dans un égout mais dans un jardin de la capitale où il se régale des graines de maïs qui ont été disposées là par un quidam qui voulait probablement plutôt nourrir les pigeons. C’est une situation très fréquente.
Pourquoi avons-nous peur des rats ? Si vous allez au Louvre, vous pourrez admirer ce tableau de Poussin (voir ci-dessous) qui est supposé représenter un épisode biblique. Mais en fait, Poussin s’inspire de ce qu’il savait des épidémies de peste qui sévissaient en France au début du 17e siècle. Si vous regardez très attentivement le tableau, au pied de l’escalier, vous verrez des cadavres de rats. On savait donc déjà à cette époque que les rats mourraient comme les hommes lors de ces épidémies. Lorsque les rats mouraient, leurs puces affamées allaient piquer les hommes et leur transmettaient le bacille de la peste. Ce mécanisme n’a été établi qu’à la toute fin du 19e siècle, mais ce souvenir historique marque encore la perception que nous avons de ces animaux. Pourtant, nous ne sommes plus au temps de Poussin, et encore moins au 14e siècle où la peste noire avait exterminé le quart de la population européenne. Le dernier cas parisien de peste s’est produit en 1920. Le dernier cas français remonte à 1945, il est survenu en Corse. Aujourd’hui, le bacille de la peste a disparu de notre territoire et s’il y revenait, il serait assez facile de le contrôler grâce aux antibiotiques. Oublions donc la peste.
Cette drôle de bactérie en forme de serpentin s’appelle Leptospira interrogans. Elle transmet une maladie de gravité variable, qui peut être sévère, voire mortelle, qui provoque plusieurs centaines d’hospitalisations dans notre pays chaque année. La transmission de la bactérie se fait à travers une petite blessure de la peau au contact d’eau souillée par l’urine d’un animal contaminé. C’est une maladie professionnelle, pour les égoutiers notamment, mais la transmission peut se faire également à l’occasion d’activités de loisirs, comme les mud races, ces courses à pied dans la boue dont la vogue récente a provoqué plusieurs cas dans notre pays.
Bien d’autres bactéries, virus ou parasites peuvent passer du rat à l’homme. Néanmoins, la responsabilité des rats, dans la transmission des maladies infectieuses, est probablement surestimée par le public qui, a contrario, sous-estime la dangerosité d’autres animaux qu’ils jugent plus sympathiques. Même la leptospirose peut être transmise par d’autres animaux que les rats, même si ceux-ci semblent bien être les principaux coupables en milieu urbain. Les rats font aussi des dégâts, en construisant leur terrier par exemple, ou en rongeant les câbles électriques.
3. Limiter la présence des rats
Au vu de l’ensemble des inconvénients liés à la présence des rats, il paraît plutôt raisonnable de vouloir s’en débarrasser. Cependant, les associations de défense des droits de l’animal critiquent vigoureusement les méthodes employées, comme les pièges mécaniques ou les appâts anticoagulants, qu’elles trouvent excessivement cruelles. Au demeurant, ces méthodes sont de moins en moins efficaces en raison de la réglementation qui les encadre, qui vise à protéger les espèces non-cibles, comme les oiseaux, les chats, les chiens et même les hommes, limitant ainsi considérablement l’arsenal laissé à la disposition des dératiseurs. Si on ne peut plus tuer les rats, peut-on espérer s’en débarrasser ? Les éliminer totalement de l’espace urbain semble impossible, mais on peut en limiter la présence en faisant un effort considérable de propreté, notamment dans les endroits où on ne souhaite pas les voir, comme les parcs et jardins. Cette position est contestée par certains amis des rats qui disent apprécier voir ces animaux en liberté, comme d’autres peuvent apprécier apercevoir un hérisson ou un écureuil. Ces fans des rats sont cependant minoritaires et les édiles municipaux sont plutôt soumis à la pression de la majorité de leurs électeurs qui leur demandent une vigoureuse politique contre les rats, devenus le symbole et le témoin d’une ville sale.
4. Conclusion
Au terme de cet exposé, je voudrais que nous nous interrogions sur la pertinence, ou plutôt sur l’obsolescence de ce terme de nuisible que je n’emploie jamais sans mettre de guillemets. Parmi les espèces qui nous causent des problèmes, qu’on appelle nuisibles, certains peuvent aussi nous rendre des services, y compris les rats, comme le soulignait le titre de cette récente émission de radio qui indiquait que les rats, en milieu urbain, contribuent à l’élimination de la matière organique. A contrario, même les meilleurs amis de l’homme peuvent nous causer des problèmes.
Un brave labrador peut lui aussi transmettre des maladies infectieuses, et surtout, il peut mordre. Les morsures de chien sont beaucoup plus fréquentes que les morsures de rats. Elles conduisent des milliers de personnes aux urgences dans notre pays chaque année, entraînent des centaines d’hospitalisations et même quelques décès, et notamment des décès d’enfants.
Le faucon pèlerin a longtemps été classé comme nuisible dans les arrêtés préfectoraux, car on l’accusait de faire concurrence aux chasseurs de lapins. Il a failli disparaître de notre pays dans les années 1960, mais aujourd’hui, son retour, y compris en ville, est salué comme une réussite.
Alors si nous arrêtions de classer des espèces selon notre point de vue anthropocentrique ? Nous avons parfaitement le droit de nous défendre contre les agressions, mais chaque espèce a sa place dans la biodiversité.
Contributeurs
BOEUF Gilles
Sorbonne Université
Dumez Richard
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Krief Sabrina
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Huchard Elise
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Saint-Jalme Michel
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Sueur Cédric
Université de Strasbourg (UNISTRA)
Lecointre Guillaume
professeur , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Brunois-Pasina Florence
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Roulot Justine
Ministère de la transition écologique
Tavernier-Dumax Nathalie
Université de Haute-Alsace (UHA)
Burgat Florence
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Lesur Joséphine
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Baratay Eric
Université Jean Moulin Lyon 3
Salines Georges
Dardenne Emilie
Université de Rennes 2
Béata Claude
Trinquier Jean
Ecole Normale Supérieure (ENS/PSL)
Césard Nicolas
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Dufour Valérie
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Beauchaud Marilyn
Université jean Monnet Saint-Etienne
Delahaye Pauline
Société française de zoosémiotique
Meunier Joël
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Laffitte Béatrice
Boivin Xavier
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Grandgeorge Marine
Université de Rennes
Dugnoille Julien
Université d'Exeter
Moutou François
Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Degueurce Christophe
EnvA - Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
Espinosa Romain
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Laprade Marie-Laure
Éducation Éthique Animale