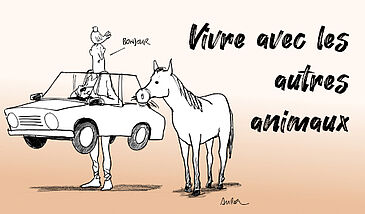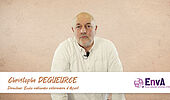En ligne depuis le 23/03/2020
3.4/5 (70)

Description
Les découvertes scientifiques de ces dernières décennies ont changé notre regard sur les autres animaux. Il en découle des questionnements sur nos relations avec eux, aujourd'hui et demain. Ce parcours vous apporte des repères pour vous permettre de vous situer sur ces questions de plus en plus discutées et débattues.
Mobilisant une grande diversité d'experts, issus d'horizons variés, il est organisé autour de trois axes :
- Les animaux : approches des sciences biologiques, humaines et sociales
- Des animaux et des humains : représentations d'hier et d'aujourd'hui
- Vivre demain avec les animaux
Deux niveaux de difficulté sont proposés selon les contenus de ce parcours : le niveau "Débutant" s'adresse aux apprenants de niveau Bac à Bac+3 (Licence), tandis que le niveau "Approfondi" est plutôt destiné aux apprenants de niveau Master et +.
Objectifs d'apprentissage :
- Savoir ce qu'est un animal.
- Situer l’humain par rapport aux autres animaux.
- Comprendre l'évolution de notre regard sur les autres animaux.
- Mieux appréhender la relation des humains aux autres animaux.
- Mieux comprendre ce dont les autres animaux sont capables : pensée, empathie, intelligence, communication,...
- Situer vos connaissances par rapport à un sujet de société complexe et controversé.
- Avoir un point de vue et des éléments de compréhension pour pouvoir mieux orienter vos réflexions et vos échanges.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Les animaux : approches des sciences biologiques, humaines et…

Des animaux et des humains : interactions d'hier et…

Demain, quelles relations avec les autres animaux ?
Ce document contient la transcription textuelle d’une vidéo du MOOC UVED «Vivre avec les autres animaux ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres aux interventions orales des auteurs.
One Health, une nouveauté ?
Christophe Degueurce, Directeur de l’École nationale vétérinaire d'Alfort
Aujourd'hui, on parle beaucoup de santé globale. On dit en anglais "one health", une seule santé : santé humaine, santé animale, santé environnementale, ce qui comprend les végétaux. La question est de savoir si c'est vraiment nouveau : existe-t-il un vrai concept "one health", novateur, ou cette idée prend-elle ses racines plus profondément ? On va essayer de répondre à cette question de l'origine, et ensuite voir pourquoi, finalement, on en est arrivé à remobiliser un concept ancien.
1. Origine de One Health
La première certitude qu'on peut avoir est que One Health est presque aussi vieux que l'humanité. Les cultures humaines ont l'habitude de penser du point de vue de l'analogie : elles mettent en relation les choses entre elles, des choses très différentes. Un exemple type, c'est le rouge et le cœur, le feu et la colère. L'humanité a pris l'habitude, historiquement, de raisonner par analogie, et même de placer de la logique dedans, d'enchaîner des faits. Un exemple extrêmement marqué est l'histoire de la médecine vétérinaire.
Pour évoquer ce concept "one health" et les idées anciennes, il faut revenir aux fondamentaux, mobiliser les noms des praticiens, des grands théoriciens de l'Antiquité, par exemple Hippocrate, Aristote, ou encore Galien. Ces gens-là pensaient le monde complètement différemment, et ils ont eu une influence majeure sur notre société. À la Renaissance, au siècle de l'humanisme, ils ont été les mentors, les maîtres à penser, des révolutions scientifiques et culturelles qui ont marqué cette époque. Comment voyaient-ils les corps ? Pour eux, chaque corps était composé d'éléments : ce sont, disaient-ils, des atomes d'essence, des particules d'environnement, de l'air, de l'eau, du feu, de la terre.
Ces éléments qui constituaient les corps, quels qu'ils soient, vivants et non vivants, avaient des qualités : ils étaient chauds ou froids, ils étaient secs ou humides. Ces qualités, lorsqu'on les assemblait, formaient des composés que l'on appelait des humeurs. Par exemple, le feu était chaud et sec. Quand on assemblait ces éléments, on formait quatre humeurs.
Ces humeurs sont restées dans notre parole quotidienne. Par exemple, on connaissait le sang, on connaissait la bile, qu'on appelait la colère, et vous connaissez ce terme : il est de tempérament bilieux, de tempérament colérique. Ou alors on pouvait être atrabilaire, ou mélancolique, c'est des synonymes. On pouvait être pituiteux, ou flegmatique, donc vous voyez que ces termes de flegme, de mélancolie, de colère, de feu, de sanguin, sont restés dans nos expressions classiques. Tempérament bilieux, mélancolique... On en parle aujourd'hui encore, c'est une réminiscence de la plus haute Antiquité.
Les anciens, à la Renaissance, mais durant l'Antiquité également, pensaient l'homme en fonction de cette prédisposition. Un homme flegmatique avait une face blanche, des cheveux décolorés, un corps adipeux, mou. Évidemment, cet homme, qui tenait du flegme, c'est-à-dire du froid et de l'humide, était marqué du point de vue de la pathologie par une tendance à avoir des œdèmes et des tumeurs. Chez les animaux, c'était pareil. Le cheval pouvait être flegmatique : il était gris laiteux, comme l'homme était blond et pâle de peau. Il était gras et sans entrain, c'était un cheval qu'on ne voulait pas acquérir. En somme, les hommes et les animaux étaient de même nature, avec une différence quand même. Au XVIe siècle, qui était un siècle croyant, un siècle chrétien, l'homme était fait à l'image de Dieu, donc il était forcément d'un accomplissement supérieur aux animaux. Je reprends ici cette phrase d'Ambroise Paré : "L'homme tout seul a en soi tout ce qui peut être excellent entre tous les autres animaux", les autres animaux, donc l'homme est dans les animaux, "et plus parfait que nul d'eux, puisqu'il a été fait à l'image de Dieu son créateur".
On peut se poser la question de savoir si les plantes également étaient douées de ces qualités et étaient faites des mêmes composés que les animaux ? La réponse est oui. On avait des plantes flegmatiques, toutes les plantes qui contenaient de l'eau comme les pêches, les champignons comestibles, qui rendaient beaucoup d'eau, les melons, le concombre... Tout ça relevait du flegme.
Il est évident qu'un homme flegmatique ne devait surtout pas consommer des aliments qui allaient renforcer cette complexion. On peut, juste pour frapper les esprits, opposer ça par exemple au tempérament de feu, typiquement à l'ail et au poivre, qui brûlent.
L'homme, les animaux non humains, les plantes, étaient vus selon une seule vision : ils étaient faits de particules d'environnement. Et il y avait donc une interdépendance de tous les corps vivants avec l'environnement. En gros, on disait cette phrase, qui était très classique : le macrocosme, c'est-à-dire l'univers, interagit avec le microcosme, c'est-à-dire l'individu. Ce que je veux vous dire, c'était que tout était lié, et que ces choses avaient des résonnances dans la vie quotidienne des gens.
Par exemple, le grand architecte-ingénieur Vitruve, qui a publié "De architectura" juste au tournant de notre ère, utilisait les animaux pour les placer sur des pâtures. S'ils ne tombaient pas malades, alors le site était propice à la construction d'une ville, ou d'un camp militaire, et donc on utilisait cette idée que tout était dans tout.
Finalement, ce qui a marqué une rupture forte, c'est le développement des sciences, des approches scientifiques. La découverte de l'anatomie, pourtant, s'est faite en grande partie chez les animaux, pour Vésale. La découverte de la physiologie, avec Albrecht von Haller, avec tous les grands physiologistes du XVIIIe puis du XIXe siècles, la physiologie expérimentale de Claude Bernard, de François Magendie, les travaux de Pasteur, chimiste, associé à Émile Roux, médecin, et à Edmond Nocard, vétérinaire, témoignent de cette coalescence des savoirs et de l'idée qu'on se faisait du monde vivant.
2. Pourquoi One Health est-il de retour ?
J'ai voulu vous dire que ce concept "one health" était tout sauf nouveau. Mais pourquoi en est-on arrivé à s'interroger, à le pousser du point de vue de la communication et de la politique ? Il y a plusieurs hypothèses, mais la plus vraisemblable est qu'autrefois, au siècle d'Érasme, un homme pouvait emporter à peu près toutes les connaissances de son temps : il pouvait être naturaliste, philologue, philosophe, théologien. Aujourd'hui ce n'est plus possible. L'hyperspécialité, liée à la profondeur des connaissances, a fabriqué des fonctionnements en silo : tel spécialiste approfondit énormément telle notion. Finalement, l'enjeu n’est pas tant de faire parler ces spécialistes entre eux, ça c'est une tendance naturelle, mais de faire parler les spécialités entre elles. Le concept "one health", c'est simplement dire « tout est dans tout », comme on le sait depuis la plus haute Antiquité, et il faut que les gens se parlent.
Contributeurs
BOEUF Gilles
Sorbonne Université
Dumez Richard
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Krief Sabrina
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Huchard Elise
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Saint-Jalme Michel
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Sueur Cédric
Université de Strasbourg (UNISTRA)
Lecointre Guillaume
professeur , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Brunois-Pasina Florence
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Roulot Justine
Ministère de la transition écologique
Tavernier-Dumax Nathalie
Université de Haute-Alsace (UHA)
Burgat Florence
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Lesur Joséphine
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Baratay Eric
Université Jean Moulin Lyon 3
Salines Georges
Dardenne Emilie
Université de Rennes 2
Béata Claude
Trinquier Jean
Ecole Normale Supérieure (ENS/PSL)
Césard Nicolas
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Dufour Valérie
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Beauchaud Marilyn
Université jean Monnet Saint-Etienne
Delahaye Pauline
Société française de zoosémiotique
Meunier Joël
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Laffitte Béatrice
Boivin Xavier
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Grandgeorge Marine
Université de Rennes
Dugnoille Julien
Université d'Exeter
Moutou François
Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Degueurce Christophe
EnvA - Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
Espinosa Romain
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Laprade Marie-Laure
Éducation Éthique Animale