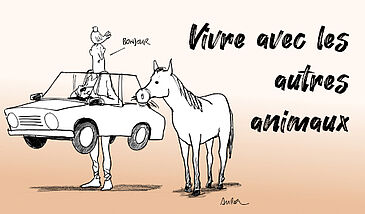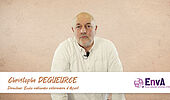En ligne depuis le 23/03/2020
3.4/5 (70)

Description
Les découvertes scientifiques de ces dernières décennies ont changé notre regard sur les autres animaux. Il en découle des questionnements sur nos relations avec eux, aujourd'hui et demain. Ce parcours vous apporte des repères pour vous permettre de vous situer sur ces questions de plus en plus discutées et débattues.
Mobilisant une grande diversité d'experts, issus d'horizons variés, il est organisé autour de trois axes :
- Les animaux : approches des sciences biologiques, humaines et sociales
- Des animaux et des humains : représentations d'hier et d'aujourd'hui
- Vivre demain avec les animaux
Deux niveaux de difficulté sont proposés selon les contenus de ce parcours : le niveau "Débutant" s'adresse aux apprenants de niveau Bac à Bac+3 (Licence), tandis que le niveau "Approfondi" est plutôt destiné aux apprenants de niveau Master et +.
Objectifs d'apprentissage :
- Savoir ce qu'est un animal.
- Situer l’humain par rapport aux autres animaux.
- Comprendre l'évolution de notre regard sur les autres animaux.
- Mieux appréhender la relation des humains aux autres animaux.
- Mieux comprendre ce dont les autres animaux sont capables : pensée, empathie, intelligence, communication,...
- Situer vos connaissances par rapport à un sujet de société complexe et controversé.
- Avoir un point de vue et des éléments de compréhension pour pouvoir mieux orienter vos réflexions et vos échanges.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Les animaux : approches des sciences biologiques, humaines et…

Des animaux et des humains : interactions d'hier et…

Demain, quelles relations avec les autres animaux ?
Ce document contient la transcription textuelle d’une vidéo du MOOC UVED «Vivre avec les autres animaux ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres aux interventions orales des auteurs.
Les relations humains-prédateurs en France
Justine Roulot, ancienne conseillère biodiversité au sein du cabinet du ministre de la transition écologique et solidaire
On a trois grands prédateurs en France : le loup, le lynx et l’ours. Il s’agit de trois espèces que l’humain a tenté d’éradiquer, voire a éradiqué pendant quelques siècles pour certaines d’entre elles. Ce sont aujourd’hui des espèces protégées parce qu’elles sont soit en danger, soit en très mauvais état de conservation. On observe un retour progressif de celles-ci depuis à peu près vingt à quarante ans. Ce retour a été plus ou moins aidé par les réintroductions qui ont pu être réalisées, notamment pour l’ours et le lynx. Le loup est revenu naturellement d’Italie. Aujourd’hui, 500 individus sont concentrés dans le quart sud-est de la France. Pour l’ours, une quarantaine d’individus se trouvent uniquement dans le massif des Pyrénées. Pour le lynx, une centaine d’individus est présente à la fois dans le Jura, mais aussi dans les Vosges et les Alpes.
1. Le problème
La coexistence entre ces prédateurs et les humains a toujours été très difficile, notamment à cause des attaques de ces animaux sur les troupeaux de moutons. Le cas du loup est ici examiné parce qu’il concentre la majorité des difficultés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a depuis quelques années en moyenne 10 000 brebis tuées par an par la population loup. Pour l’ours ou le lynx, on n’est pas du tout sur le même ordre de grandeur, on est entre 100 et 300 animaux tués. Cette cohabitation est difficile.
Tout d’abord, elle l’est parce qu’il y a une déshabituation, en quelque sorte, des éleveurs, des bergers et des acteurs du territoire dans leur ensemble, à vivre avec ces animaux depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Quelle est la conséquence ? Premièrement, les troupeaux sont plus vulnérables parce qu’ils ne sont pas protégés ou peu protégés. On a une domestication du mouton, au fil des siècles, qui l’a rendu de moins en moins capable de se défendre, si on compare à son ancêtre, le mouflon. On a une méconnaissance du comportement de ces animaux dans le système agropastoral, ce qui provoque une difficulté à faire face à cette prédation. Tout ça entraîne un bouleversement des modes de production difficiles à gérer pour les éleveurs, qui entraînent des conflits très forts au niveau local.
On a aussi des attaques, pour le loup, qui peuvent se concentrer dans certains territoires, et des phénomènes qu’on appelle "Overkilling", quand le loup attaque un troupeau et tue des dizaines de bêtes, alors qu’il n’en a pas besoin pour s’en nourrir. Ce sont des phénomènes qui existent, difficiles à comprendre et à appréhender pour les acteurs locaux, qui créent parfois une détresse psychologique qu’il ne faut absolument pas minimiser.
Au-delà de ces aspects conflictuels et cette dimension sociologique forte, il y a une méfiance envers l’État et les acteurs publics. Des stratégies de désinformation, avec beaucoup de fausses idées, circulent sur le comportement de ces grands prédateurs. Il y a parfois aussi une instrumentalisation politique de cet enjeu que représente la cohabitation.
2. Les solutions
Tout cela n’est pas sans réponse et sans solution. Une panoplie de solutions existe et on peut encore en développer.
La première, la plus pérenne et que l’on sait être la plus efficace, c’est la généralisation de la protection des troupeaux dans tous les territoires. Celle-ci est efficace au maximum quand elle combine trois facteurs : 1) le gardiennage, c’est-à-dire la présence du berger autour du troupeau, 2) la présence de chiens de protection pour défendre les animaux, 3) le parcage des brebis de nuit. C’est très important parce que cette généralisation de la protection est clé pour anticiper l’arrivée de ces prédateurs dans des nouveaux territoires et faire que les exploitations soient protégées.
Il y a aussi des solutions pour compenser la perte économique liée à la perte d’animaux, avec une indemnisation mise en place par l’État.
Pour le loup, dans un cadre dérogatoire, dans des situations bien précises, quand la protection ne suffit pas, quand il y a des attaques répétées auxquelles on a du mal à trouver une réponse, il y a la possibilité de prélever certains animaux grâce à la mise en place d’un plafond annuel sur le territoire. Il s’agit de tirs ciblés sur les animaux qui attaquent. C’est important parce que ça peut permettre de baisser la pression de prédation localement et finalement d’apaiser les tensions sociales dans certains territoires. Ces prélèvements doivent se faire sans remettre en cause la viabilité de l’espèce sur le territoire, en assurant un seuil maximum qui s’appuie sur les recommandations des scientifiques. Les tirs doivent être privilégiés sur des animaux qui posent problème. Il n’y a pas vraiment d’intérêt à tuer des loups au hasard, qui peuvent être des loups qui n’attaquent pas, voire qui provoquent une désorganisation sociale des meutes, qui peuvent provoquer des mouvements d’individus et de populations, et au final, aggraver le nombre d’attaques plutôt que de réduire. C’est aussi un point très important.
Tout cela s’accompagne d’un besoin de connaissance du système. Beaucoup de fausses idées circulent. C’est important d’objectiver les choses et de s’appuyer sur une base scientifique solide et des connaissances de terrain. Pour cela, il faut développer ce qu’on appelle les études de cas et étudier les interactions qui se passent réellement sur le terrain entre les prédateurs, les troupeaux et les chiens de protection.
Enfin, il y a la dimension sociale. Pour réduire les conflits et restaurer le dialogue quand il est rompu, c’est important d’être dans une transparence complète entre tous les acteurs, de partager toute l’information disponible et de mettre en place des médiations territoriales qui permettent de trouver des solutions locales adaptées aux problématiques en question.
La prédation sur les troupeaux par ces grands mammifères, c’est un problème qui en cache un autre. Ces animaux sont parfois considérés comme des boucs émissaires, alors qu’il y a d’autres problèmes auxquels fait face la filière, notamment des problèmes économiques en lien avec le marché mondial. L’agneau néo-zélandais qui vient de l’autre bout du monde est vendu beaucoup moins cher que l’agneau français : c’est un problème de compétitivité pour la filière française.
3. Les leviers
Le premier levier est le développement de politiques économiques fortes qui puissent soutenir le pastoralisme ovin en France et faire qu’il perdure dans nos montagnes. Cela passe par un vrai plan de soutien à mettre en place par le ministère de l’Agriculture avec l’ensemble des acteurs concernés.
Le second levier porte sur le rôle des consommateurs. Par leur portefeuille, les consommateurs jouent un rôle. En achetant de l’agneau français, en acceptant de payer un peu plus cher, ils peuvent soutenir des pratiques d’élevage qui permettent d’assurer l’avenir du pastoralisme dans nos territoires, mais aussi de préserver les alpages et la vie sauvage qu’ils abritent. C’est vraiment un point clé. C’est un petit message adressé aux consommateurs qui peuvent éventuellement nous regarder.
4. Conclusion
Ces espèces jouent un rôle fondamental pour le fonctionnement des écosystèmes et pour leur résilience. C’est important que collectivement, on comprenne que l’humain ne peut pas s’extraire du vivant. On ne peut pas avoir des positions extrêmes avec d’une part, certains qui disent qu’il n’y a pas d’impact sur le pastoralisme, et d’autre part, d’autres acteurs qui disent : "On ne veut pas vivre avec le loup. On ne veut pas vivre avec l’ours. On ne veut pas vivre avec le lynx. La montagne est à nous." Il y a besoin d’une prise de conscience collective, que ce territoire est commun et doit être partagé. C’est vraiment un prérequis indispensable pour trouver des solutions qui permettent une cohabitation efficace sur le long terme.
Contributeurs
BOEUF Gilles
Sorbonne Université
Dumez Richard
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Krief Sabrina
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Huchard Elise
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Saint-Jalme Michel
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Sueur Cédric
Université de Strasbourg (UNISTRA)
Lecointre Guillaume
professeur , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Brunois-Pasina Florence
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Roulot Justine
Ministère de la transition écologique
Tavernier-Dumax Nathalie
Université de Haute-Alsace (UHA)
Burgat Florence
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Lesur Joséphine
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Baratay Eric
Université Jean Moulin Lyon 3
Salines Georges
Dardenne Emilie
Université de Rennes 2
Béata Claude
Trinquier Jean
Ecole Normale Supérieure (ENS/PSL)
Césard Nicolas
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Dufour Valérie
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Beauchaud Marilyn
Université jean Monnet Saint-Etienne
Delahaye Pauline
Société française de zoosémiotique
Meunier Joël
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Laffitte Béatrice
Boivin Xavier
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Grandgeorge Marine
Université de Rennes
Dugnoille Julien
Université d'Exeter
Moutou François
Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Degueurce Christophe
EnvA - Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
Espinosa Romain
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Laprade Marie-Laure
Éducation Éthique Animale