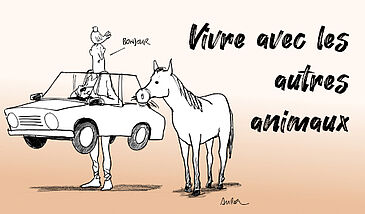En ligne depuis le 23/03/2020
3.4/5 (70)

Description
Les découvertes scientifiques de ces dernières décennies ont changé notre regard sur les autres animaux. Il en découle des questionnements sur nos relations avec eux, aujourd'hui et demain. Ce parcours vous apporte des repères pour vous permettre de vous situer sur ces questions de plus en plus discutées et débattues.
Mobilisant une grande diversité d'experts, issus d'horizons variés, il est organisé autour de trois axes :
- Les animaux : approches des sciences biologiques, humaines et sociales
- Des animaux et des humains : représentations d'hier et d'aujourd'hui
- Vivre demain avec les animaux
Deux niveaux de difficulté sont proposés selon les contenus de ce parcours : le niveau "Débutant" s'adresse aux apprenants de niveau Bac à Bac+3 (Licence), tandis que le niveau "Approfondi" est plutôt destiné aux apprenants de niveau Master et +.
Objectifs d'apprentissage :
- Savoir ce qu'est un animal.
- Situer l’humain par rapport aux autres animaux.
- Comprendre l'évolution de notre regard sur les autres animaux.
- Mieux appréhender la relation des humains aux autres animaux.
- Mieux comprendre ce dont les autres animaux sont capables : pensée, empathie, intelligence, communication,...
- Situer vos connaissances par rapport à un sujet de société complexe et controversé.
- Avoir un point de vue et des éléments de compréhension pour pouvoir mieux orienter vos réflexions et vos échanges.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Les animaux : approches des sciences biologiques, humaines et…

Des animaux et des humains : interactions d'hier et…

Demain, quelles relations avec les autres animaux ?
Ce document contient la transcription textuelle d’une vidéo du MOOC UVED «Vivre avec les autres animaux ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres aux interventions orales des auteurs.
Relation homme-insecte : les abeilles en Asie
Nicolas Césard, maître de conférences au MNHN
En Asie, comme ailleurs dans le monde, la cire et surtout le miel constituent des produits recherchés tant pour leur usage domestique que pour les gains que leurs ventes rapportent. Certaines espèces mellifères sont élevées dans des ruches, mais beaucoup sont exploitées dans leur milieu, là où les hommes les trouvent.
1. Objet de l'étude
En Indonésie, les chasseurs de miel prennent des risques importants, en allant collecter dans les grands arbres les rayons d'Apis dorsata, l'abeille géante. Mais dans certaines régions, une technique pour attirer les abeilles sur un support artificiel s'est également développée. Ma recherche s'intéresse aux savoirs locaux associés à cette espèce, l'abeille géante, et le passage de la collecte des colonies d'abeilles dans les arbres à des savoir-faire et à des formes de gestion proches, sous certaines conditions, de l'apiculture telle qu'on la connaît pour l'abeille européenne.
2. Apicultures
Les apicultures, comme les abeilles, ne se ressemblent pas. La volonté d'exploiter les abeilles pour leur miel est ancienne, mais chaque espèce mellifère est différente, et il faut composer avec la biologie de chacune. D'autre part, chaque culture appréhende de façon différente les abeilles, en fonction de la place de ses insectes dans les représentations du vivant. L'histoire de ces apicultures est jalonnée d'innovations techniques, comme on peut voir à l'image ci-dessus, innovations fondées bien souvent sur les observations empiriques. Ces traditions apicoles vont s'appuyer sur des connaissances précises des abeilles. À l'aide de matériaux locaux, elles conçoivent différemment l'habitat des insectes. L'abeille géante asiatique, en particulier, ne peut pas vivre dans une boîte en bois ou en écorce, une ruche, comme l'abeille à miel européenne ou africaine.
3. Cueillette
La cueillette des colonies d'abeilles sauvages est une des activités les plus anciennes de l'homme, car le miel et le couvain - les larves des abeilles - constituent des aliments énergétiques essentiels. Cette collecte ou api-collecte, comme on la nomme, concerne toutes les espèces mellifères et elle est encore très largement pratiquée dans le monde par des populations rurales et forestières.
En Asie du Sud et du Sud-Est, les colonies de l'abeille géante construisent leur rayon à l'air libre, sous les branches des grands arbres ou à flanc de falaise, des endroits difficilement accessibles aux prédateurs.
Ces collectes ne devraient pas être très différentes de celles pratiquées par les hommes vivant sur l'île de Bornéo, il y a 12 000 ans, comme l'attestent les peintures rupestres de rayons d'abeilles dans les grottes de Liang Karim à l'est de l'île.
4. Technique
Les collecteurs utilisent différentes techniques pour grimper aux arbres et accéder aux rayons. Ces savoir-faire traditionnels varient selon les sites et les régions. Certains arbres sont régulièrement collectés et leurs propriétaires y ont installé des pieux de bois ou des clous de fer pour en faciliter l'ascension. À Palawan, aux Philippines, comme à Bornéo, les chasseurs de miel atteignent les premières branches en passant par un arbre voisin plus accessible, avant de bâtir un passage en hauteur. Les essaims revenant chaque année au même endroit, la plupart des arbres sont entretenus et protégés, et leur accès est régulé par le droit coutumier. Certains arbres sont hérités, d'autres sont librement accessibles et collectés par les premiers arrivés. Les récoltes sont souvent très organisées, avec une répartition précise des tâches entre grimpeurs d'un côté et collecteurs en contrebas.
5. Mythes
La représentation liée aux abeilles, aux herbes et aux activités qui entourent la collecte, reflète l'importance donnée au miel forestier par chaque culture et l'ancienneté des usages. Cire et miel servaient de monnaie d'échange avec les groupes voisins et les commerçants. Le miel est encore utilisé comme boisson fermentée dans certains rituels et dans les fêtes collectives. Plusieurs mythes associent les abeilles, le miel, les abeilles au miel et à une belle jeune fille ou jeune femme et à ses charmes, et d'autres vont évoquer les mauvais tours de l'esprit de l'arbre, gardien des essaims. Les chants utilisés lors des récoltes en Malaisie et à Sumatra invoquent la protection des ancêtres, mais visent surtout à apaiser les esprits au cours de la récolte.
6. Evolution
Le nid de l'abeille géante est formé d'un seul rayon vertical et plus d'une cinquantaine de colonies peuvent être observées sur un seul arbre. L'espèce est connue pour son caractère défensif et sa facilité à essaimer, c'est-à-dire à quitter brusquement son rayon lorsqu'elle se sent en danger. Les essaims arrivent pour les floraisons et repartent quand les fleurs viennent à manquer, avant de revenir quelques mois après au même emplacement. L'installation des essaims sous les branches a inspiré à certains collecteurs la technique dite du chevron, qu'on appelle rafter en anglais, qui consiste à disposer au sol et à hauteur d'homme un support légèrement incliné, un tronc ou une planche, selon les régions, sous lesquelles les abeilles vont fonder leur colonie. L'installation va faciliter la venue des essaims migrateurs. Contrairement à la collecte dans les grands arbres, les colonies d'abeilles sont facilement accessibles. La technique du chevron représente un cas unique de semi-domestication. Les hommes assemblent un tronc et préparent un emplacement que les abeilles choisissent ou pas.
Certes dangereuse pour les hommes, l'apicollecte dans les arbres ou sur les falaises est souvent destructrice pour les colonies et les abeilles qui finissent brûlées par les torches et désorientées par l'obscurité. Jusque dans les années 60, il était fréquent que le rayon soit intégralement coupé pour en extraire la cire qui était ensuite vendue et exportée. Le couvain et le miel étaient prélevés mais pour être consommés en famille. Pratiquée de préférence de jour et dans le respect de certaines règles, la technique du chevron permet une meilleure gestion des nids pour un retour des essaims la saison suivante et une exploitation plus durable du miel, devenu aujourd'hui un produit très recherché, contrairement à la cire. Pour assurer des récoltes régulières, les scientifiques et les associations locales travaillent de pair et préconisent de contrôler l'enfumage et de ne pas prendre les larves. En Indonésie, les techniques d'extraction propres et les filières commerciales sont mises en place pour valoriser et développer la vente du miel forestier.
7. Conclusion
Beaucoup de questions restent en suspens. Les abeilles reviennent-elles s'installer sur le même site ou sur les mêmes sites ? Sous quelles conditions ? Présentée comme une pratique durable, "l'apiculture" de l'abeille géante dépend de facteurs multiples que seule une approche interdisciplinaire combinant ethnologie, biologie, génétique est à même d'évaluer. L'avenir du miel forestier ne dépend pas uniquement de l'apiculture, mais de la présence des forêts comme sites de nidification et de ressources, comme le pollen et le nectar pour les abeilles. En Indonésie, de nombreuses personnes et communautés traditionnelles locales vivent des produits forestiers, comme le miel. Or, sans forêt tropicale, il y a moins de pollinisateurs et, accessoirement, moins de miel.
Contributeurs
BOEUF Gilles
Sorbonne Université
Dumez Richard
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Krief Sabrina
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Huchard Elise
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Saint-Jalme Michel
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Sueur Cédric
Université de Strasbourg (UNISTRA)
Lecointre Guillaume
professeur , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Brunois-Pasina Florence
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Roulot Justine
Ministère de la transition écologique
Tavernier-Dumax Nathalie
Université de Haute-Alsace (UHA)
Burgat Florence
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Lesur Joséphine
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Baratay Eric
Université Jean Moulin Lyon 3
Salines Georges
Dardenne Emilie
Université de Rennes 2
Béata Claude
Trinquier Jean
Ecole Normale Supérieure (ENS/PSL)
Césard Nicolas
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Dufour Valérie
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Beauchaud Marilyn
Université jean Monnet Saint-Etienne
Delahaye Pauline
Société française de zoosémiotique
Meunier Joël
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Laffitte Béatrice
Boivin Xavier
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Grandgeorge Marine
Université de Rennes
Dugnoille Julien
Université d'Exeter
Moutou François
Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Degueurce Christophe
EnvA - Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
Espinosa Romain
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Laprade Marie-Laure
Éducation Éthique Animale