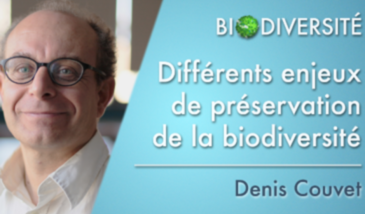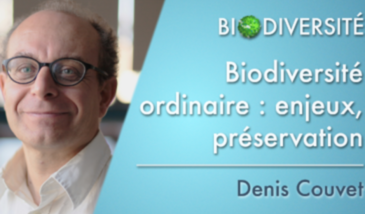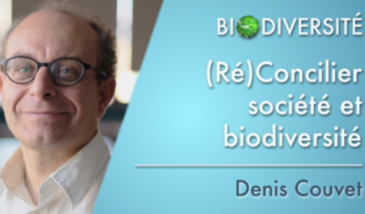En ligne depuis le 09/10/2014
3/5 (2)

Description
Denis Couvet propose plusieurs stratégies de gestion de la biodiversité, en réponse aux pressions directes qu'elle subit (destruction, surexploitation, écotoxicité, espèces invasives, changement climatique). Il évoque ainsi la compensation, la régulation, les sciences participatives, ou encore les Nature based Solutions. Afin de déployer cette variété de réponses, il préconise de mobiliser une large palette de politiques, aussi bien prescriptives qu'incitatives.
Objectifs d'apprentissage :
- Connaître plusieurs stratégies de gestion de la biodiversité
- Comprendre en quoi il est nécessaire de mobiliser une palette de politiques pour déployer toutes ces stratégies
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Mentions Licence
- Sciences de la vie
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
Objectifs de Développement Durable
- 15. Vie terrestre
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
- Enjeux Climat/Biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Contributeurs
COUVET Denis
Ce document est la transcription révisée et chapitrée d’une vidéo du MOOC UVED « Biodiversité ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.
Stratégies de gestion de la biodiversité face aux pressions directes
Denis Couvet, Professeur du MNHN
Les pressions « directes » qui opèrent sur la biodiversité sont multiples. Elles ont été assez bien identifiées depuis un certain nombre d'années.
1. La transformation des habitats
La première menace directe est ce qu'on appelle la transformation des habitats. Des habitats naturels riches en biodiversité sont transformés en des habitats qui sont plus ou moins artificialisés et qui sont généralement moins riches en biodiversité. Cela concerne par exemple la déforestation, qui transforme des forêts en écosystèmes agricoles. Face à cette menace, que faut-il faire ? Il faut trouver tout un ensemble de mesures luttant contre la déforestation. Une des mesures récentes qui se met en place notamment en France est ce qu'on appelle la compensation écologique. Face à toute infrastructure humaine qui se met en place, que ce soit une industrie, une autoroute, il va à chaque fois falloir soit éviter, soit réduire l’impact, soit éventuellement le compenser, en restaurant par exemple d'autres écosystèmes.
2. La surexploitation des écosystèmes
Une autre pression directe importante sur la biodiversité est la surexploitation. La surexploitation des océans, comme celle de toutes les espèces qui sont présentes dans les forêts tropicales, correspond à ce que l'on appelle souvent le problème de l'accès libre. Il n'y a pas de restrictions d'accès à ces ressources et il n'y a pas de mécanisme social vertueux de manière à éviter la surexploitation. Une des solutions importantes pour éviter cette pression directe va être de réguler l'accès collectif à ces ressources qui sont communes.
3. L’écotoxicité
Un autre type de pression directe important est ce qu'on appelle l’écotoxicité. Un certain nombre de polluants, notamment les pesticides, ont des effets sur la biodiversité. Un des grands problèmes avec cette écotoxicité est que si elle peut être aiguë, peut aussi être diffuse et de long terme. Elle a un effet seulement au bout d'un certain temps, de quelques mois ou de quelques années par exemple. Son effet peut se manifester non pas sur la survie mais sur des aspects comme la fertilité. Par ailleurs, cet effet toxique peut se faire en combinaison avec d'autres éléments toxiques. Là, les scientifiques ont un problème de méthodologie parce que ce genre d'effet est quasiment impossible à tester en laboratoire. A partir de là, il s'agit de regarder ce qui se passe dans la nature et d'avoir des dispositifs d'observation qui soient suffisamment puissants de manière à pouvoir évaluer cette écotoxicité.
Dans ce domaine, ce qui se développe actuellement et qui est très utile pour évaluer cette écotoxicité, ce sont les sciences participatives. Il s’agit de tout un ensemble d'observateurs qui se déploient sur l'ensemble du territoire national et qui vont pouvoir suivre la biodiversité sur l'ensemble des espaces. Lorsqu'on a l'état de la biodiversité sur l'ensemble de ces espaces, on va pouvoir commencer à regarder quel est l'effet exact des polluants – parmi d’autres facteurs qui affectent la biodiversité. Si on a suffisamment de points d'observation, on peut commencer à faire la part des choses et passer de ce que l'on pourrait appeler une corrélation hasardeuse à une causalité, où on établit que c'est bien l'effet du pesticide. Ainsi, une étude publiée dans Nature a montré l'effet d'un néonicotinoïde sur les populations d'oiseaux à l’échelle des Pays-Bas. Les populations néerlandaises d'oiseaux sont affectées par ce néonicotinoïde qui est utilisé depuis une dizaine d'années. L’écotoxicité est sans doute un facteur qui est très important, qui affecte les populations d'insectes et indirectement leurs prédateurs, notamment les populations d'oiseaux.
4. Les invasions biologiques
Un autre type de menace vient des invasions biologiques. Il s’agit d’espèces qui envahissent les milieux et qui supplantent tout un ensemble d'espèces indigènes. Le problème qui se pose pour les invasions biologiques est à nouveau le problème de la causalité : est-ce que l'espèce invasive est vraiment l'espèce qui est la cause du déclin des espèces indigènes ou bien est-ce que l'espèce invasive est simplement le porteur de la mauvaise nouvelle, à savoir que les écosystèmes sont très perturbés ? Lorsque l'écosystème est très perturbé, les espèces indigènes sont amenées à disparaître et à être remplacées par d'autres espèces opportunistes. On constate dans un certain nombre de cas que le problème n'est pas l'espèce invasive mais que c’est la perturbation de l'habitat. Cela est beaucoup plus difficile à gérer. On s'aperçoit aussi que l'éradication de l'espèce invasive n'est pas forcément que bénéfique et qu’elle peut même avoir un effet contre-productif parce qu’à travers l'éradication de l'espèce invasive, on va encore plus perturber l'habitat et favoriser encore plus l'arrivée d'espèces invasives et le déclin des espèces autochtones.
5. Le changement climatique
Une autre menace est le changement climatique. On considère que les menaces qui pèsent sur les espèces ont augmenté à peu près de 40 % suite au changement climatique. Mais la prise en compte du changement climatique dépasse largement la préservation de la biodiversité donc nous n'irons pas plus loin dans ce domaine-là.
6. Les stratégies
Comment fait-on pour contrecarrer, de manière générale, l’ensemble de ces pressions directes ? Il y a ce qu'on appelle maintenant les Nature Based Solutions, c'est-à-dire des solutions basées sur la nature. L’idée est de gérer les écosystèmes en s'appuyant beaucoup plus sur la biodiversité et notamment sur les services écosystémiques. Au-delà se pose la question de savoir quels sont les instruments et les outils sociaux que l'on doit utiliser pour contrecarrer ces pressions directes. Dans ce domaine-là, nous avons un certain nombre de controverses. Le message que véhiculent les scientifiques est de regarder cela d'une manière relativement neutre et de considérer qu'il existe des mesures qui sont complémentaires. Certaines sont prescriptives, c’est-à-dire qu’elles obligent l'ensemble des acteurs à faire des choses. Ce sont les lois, les normes, ou les règlements. Il existe par ailleurs des mesures incitatives. C’est par exemple les paiements pour services écosystémiques qui vont par exemple rémunérer les agriculteurs non pas pour qu'ils produisent plus de produits agricoles - par exemple de la viande rouge - mais pour qu'ils s'intéressent beaucoup plus au maintien de la fonctionnalité des écosystèmes. Le message que véhiculent les scientifiques est qu’il y a une complémentarité entre les mesures prescriptives et les mesures incitatives. Lorsqu'on met en place de tels outils, une problématique importante est de savoir s'il s'agit plutôt de l'État - voire d’un hypothétique gouvernement mondial - qui décide de ces mesures qui doivent s'imposer aux acteurs locaux ou bien s’il doit s’agir des acteurs locaux qui s'organisent par eux-mêmes. Là aussi, le message que délivre les scientifiques est de bien considérer qu'il y a une complémentarité, entre d'une part avoir une organisation à l'échelle nationale voire globale et d’autre part inciter les acteurs locaux à s'organiser.
7. Conclusion
Les pays développés commencent à développer un certain nombre de mesures vertueuses de manière à mieux gérer leurs écosystèmes. Mais un effet pervers de ces mesures est qu’au fur et à mesure qu'ils préservent mieux leurs écosystèmes, la consommation des pays du Nord se reporte vers les écosystèmes qui ne sont pas protégés dans les pays du Sud. On va donc mieux préserver la biodiversité dans les pays du Nord mais éventuellement aux dépens de la biodiversité dans les pays du Sud. Globalement, cela ne conduit pas à un bilan complètement positif. On voit qu'on ne peut pas simplement raisonner à l'échelle nationale. Il faut adopter un raisonnement global qui prenne en compte l'ensemble des problèmes de population ainsi que l'ensemble des problèmes politiques et économiques à l'échelle de la planète.