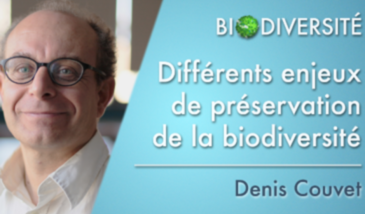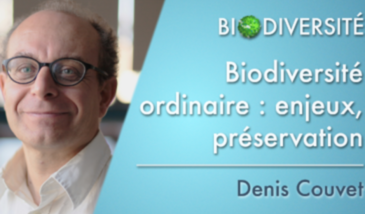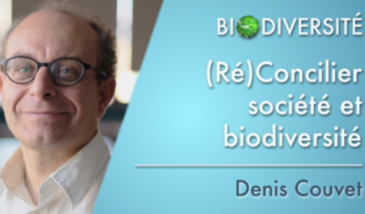En ligne depuis le 28/11/2014
0/5 (0)

Description
Dans cette intervention, Stellio Casas présente ce qu'est la biosurveillance. Cet outil de gestion de la biodiversité peut être décliné aux différents niveaux biologiques du vivant, ce qui conduit à l'identification de bioaccumulateurs, de biomarqueurs, de bioindicateurs et d'indices de biodiversité.
Objectifs d'apprentissage :
- Comprendre ce qu'est la biosurveillance
- Appréhender la déclinaison de cet outil de gestion de la biodiversité aux différents niveaux biologiques du vivant
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+3
- Bac+4
Types
- Grain audiovisuel
Contributeurs
Casas Stellio
Ce document est la transcription révisée et chapitrée d’une vidéo du MOOC UVED « Biodiversité ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.
La biosurveillance
Stellio CASAS, Veolia Recherche & Innovation
Dans sa diversité et sa complexité, la biodiversité participe au bon fonctionnement des écosystèmes qui fournissent des services irremplaçables à l’humanité. Ainsi, les espèces animales et végétales font partie de divers écosystèmes et sont à ce titre des maillons indispensables de communautés d'êtres vivants. Elles entretiennent des relations multiples entre elles ce qui les rend souvent interdépendantes. Les activités humaines peuvent exercer des pressions sur cet équilibre fragile. La maîtrise de ces pressions est d'un intérêt primordial. A ce titre, la Directive cadre sur l'eau, le dispositif d'évaluation des incidences Natura 2000 ou encore la transposition de la Directive cadre sur l'eau au milieu marin participent à cet effort.
1. La biosurveillance : émergence et principe général
Les impacts de ces cumuls de pression ne peuvent pas être seulement étudiés que sur la seule base de connaissances de la physique et de la chimie des milieux. Ainsi, le reflet de l'état de santé de l'environnement doit être étudié par les propriétés biologiques des communautés qui y résident. C’est dans les années 80 qu’a émergé une nouvelle méthodologie de gestion de la biodiversité que l'on nomme la biosurveillance. Il s'agit d'évaluer à différents niveaux biologiques la réponse des espèces vivantes présentes dans ce milieu. Ainsi, le suivi de l'état de l'environnement va se faire par l'utilisation des espèces biologiques que l’on nommera des bioindicateurs.
L'amélioration des connaissances en écotoxicologie qui, comme le définissait Ramade en 1977, consiste « en l'étude des modalités de contamination de l'environnement par des substances naturelles et ou anthropiques et de leurs modes d'action et d'effets sur les êtres vivants », va participer à cet effort et voir par la contribution de nombreuses équipes scientifiques la multiplication d'outils biologiques à des fins de biosurveillance. L'idée principale repose sur le fait d'utiliser la réponse biologique d’un être vivant face à l'altération de son milieu.
2. Les niveaux d’observation de la réponse biologique
Il s'agit d'un changement mesurable et/ou observable qui va nous révéler une exposition présente et/ou passée ou encore un effet associé à cette présence. Tous les niveaux biologiques peuvent nous fournir des informations intéressantes pour réaliser un diagnostic environnemental.
La première réponse biologique va être issue de l'exposition de l'être vivant à cette perturbation. Cela peut être une augmentation de la température ou la présence d'un polluant. S'il s'agit de la présence d'un polluant, la première réponse biologique va être l'assimilation de ce polluant par l'organisme. On parle alors de bioaccumulateurs. C'est le cas par exemple de la moule qui en filtrant l'eau va assimiler dans ses tissus les polluants présents dans le milieu. Elle est d'ailleurs largement utilisée de façon internationale et en France par l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer qui va la déployer dans ses réseaux de surveillance pour évaluer la qualité chimique des milieux côtiers.
Une fois cette présence chimique assimilée par l'organisme, elle peut perturber l'équilibre biochimique, cellulaire ou moléculaire de l'organisme. On parle alors de biomarqueurs d'exposition et/ou d'effets selon le seuil atteint. Ces biomarqueurs ont été largement développés ces dernières années car ils permettent de réaliser un diagnostic précoce. C'est le cas par exemple de l'acétylcholinestérase qui est une enzyme dont la production va évoluer en fonction du stress subi par l'être vivant.
Si la perturbation est importante, il va être alors intéressant d'étudier le cycle biologique des organismes que l'on nommera génériquement des bioindicateurs. Il s'agit alors d'évaluer la modification du comportement, de la reproduction, de la croissance ou de la survie d'un organisme identifié.
Au niveau supérieur, il est également possible d'étudier les populations et les communautés. On parle d’indices de biodiversité. L'idée va être, sur un site, de recenser les espèces présentes, leur diversité, leur masse biologique. Ces indices de biodiversité sont largement recommandés par les directives européennes.
Enfin, le dernier niveau hiérarchique biologique qui peut être étudié est celui des écosystèmes. Cette démarche est notamment déployée et recommandée par le Millennium Ecosystem Assessment.
3. Un exemple de R&D sur la biosurveillance
Au sein des centres de recherche de Veolia sont menées ce type d'études sur les outils biologiques afin de les développer, de les tester et de sélectionner les plus pertinents. Cette étape va ainsi permettre de les intégrer à des fins de gestion environnementale. Le fruit de de ces recherches va ensuite permettre de concevoir des solutions innovantes auprès de différents utilisateurs tels que les industriels, les collectivités publiques ou les agences de l'eau qui vont à leur tour intégrer ces outils biologiques dans leur plan de surveillance et de gestion de la biodiversité.