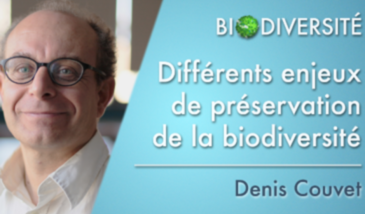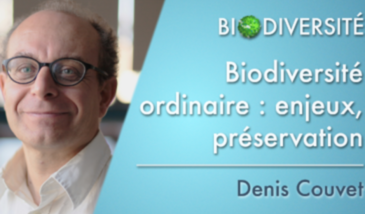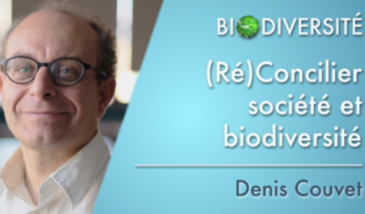En ligne depuis le 14/10/2014
0/5 (0)

Description
Sur la base d'un rappel des grands facteurs qui soutiennent l'évolution biologique, Alexandre Robert présente quelques orientations majeures et futures des stratégies de conservation de la biodiversité : conservation des capacités génétiques d'adaptation des espèces, modélisation des distributions futures d'espèces et de communautés ou encore possibilité d'assister les migrations de certaines espèces.
Objectif d'apprentissage :
- Connaître quelques orientations majeures et futures des stratégies de conservation de la biodiversité
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+3
- Bac+4
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
- Enjeux Climat/Biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Contributeurs
Robert Alexandre
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Ce document contient la transcription textuelle d’une vidéo du MOOC UVED « Biodiversité ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres aux interventions orales des auteurs.
Biodiversité du futur : gérer l’évolution biologique
Alexandre Robert
Maître de Conférences, Muséum national d’Histoire naturelle
L'évolution est gouvernée par la combinaison de quatre forces : la mutation, la migration, la sélection, et la dérive.
1. Impacts des activités humaines
Les changements environnementaux créés par les activités humaines ont des conséquences importantes sur au moins les trois dernières.
La migration correspond au flux de gènes entre les populations d'une même espèce ou, plus généralement, entre les communautés biologiques. On sait que ces flux de gènes vont être influencés négativement par la fragmentation des habitats, ou bien au contraire être amplifiés par la neutralisation de barrières géographiques naturelles ou les introductions d'origine humaine.
La sélection favorise certains variants génétiques. Les régimes de sélection vont être changés par les modifications environnementales associées aux changements climatiques, aux invasions, à la pollution, et à l'exploitation. On sait par exemple que de nombreux cas d'exploitation de pêche sont sélectifs vis-à-vis de traits comme la taille corporelle. Ils peuvent conduire à l'évolution rapide de ces traits à l'échelle de quelques dizaines d'années seulement.
La dérive génétique correspond aux fluctuations aléatoires dans la fréquence des variants génétiques et se traduit à terme par la perte de certains variants. Cette perte est d'autant plus rapide que les populations sont petites. La perte de variations génétiques va donc être amplifiée par la réduction de la quantité d'habitats disponibles et par les fluctuations de taille des populations. Sur le long terme, cela conduit à de plus faibles tailles et donc à une perte rapide de variations génétiques. À une échelle plus large, cette perte de variations génétiques au sein des espèces s’accompagne d’extinctions d'espèces à un rythme très rapide que beaucoup d'auteurs considèrent comme supérieur de plusieurs ordres de grandeur au rythme « normal » d'extinction. On a donc une perte de variations génétiques au sein des espèces et entre les espèces. Certains auteurs prédisent la disparition de secteurs entiers de biomes qui, par le passé, ont été des centres de diversification biologique comme les récifs coralliens ou les forêts tropicales.
2. Sciences de la conservation
Face à cette situation, un premier niveau de réponse consiste à tenter de préserver le patrimoine évolutif existant. La valeur que nous donnons au patrimoine évolutif est liée à la notion d'irréversibilité. On considère qu'à l'échelle de quelques dizaines, centaines ou milliers d'années la perte de ce patrimoine est irréversible. On va donc définir ce qu'on appelle des unités d'évolution dans l'arbre du vivant. Le but est de définir des groupes d'organismes au sein et entre les espèces dont la perte serait particulièrement irréversible. Pour cela, on va se baser sur ce qu'on appelle la divergence neutre, c'est-à-dire sur le temps depuis lequel les différents groupes ont divergé et en supposant que les groupes qui ont divergé depuis plus longtemps sont moins redondants génétiquement et donc que leur perte serait davantage irréversible.
On peut également se baser sur ce qu'on appelle la variation adaptative, c'est-à-dire sur des fonctions écologiques que l'on souhaite conserver. On sait aujourd'hui que toute cette diversité phylogénétique détermine largement la productivité, la stabilité des systèmes biologiques et leur capacité à répondre aux changements environnementaux.
Si l’on souhaite préserver des unités d'évolution, ce n'est pas seulement pour conserver un patrimoine statique. C'est avant tout et surtout pour conserver des processus évolutifs. Le but des sciences de la conservation n'est pas de conserver une biodiversité figée telle qu'elle est maintenant ou telle qu'elle était dans le passé. Il est plutôt d'assurer une continuité dans les processus évolutifs qui, en permanence, créent de nouveaux variants tout en en éliminant d'autres.
L’un des buts de ce qu'on appelle la génétique de la conversation est de gérer cette évolution rapide. Ce peut être fait, par exemple, en définissant des tailles minimales de population pour minimiser la perte de variations génétiques, en maintenant des flux de gènes entre les réserves biologiques et entre les populations captives dans le milieu ordinaire, en établissant des corridors écologiques. L’idée est d'éviter l'hybridation entre des populations qui se sont séparées depuis trop longtemps, et de maintenir l'adaptation des populations à leurs conditions locales tout en réduisant les conséquences adaptatives de l'exploitation ou de la captivité.
3. Penser le futur
Une des clés de la réussite de ces opérations est d’être capable d'anticiper les changements environnementaux et les réponses de la biodiversité à ces changements. On cherche aujourd'hui à conserver la biodiversité dans un monde entièrement modifié par l'Homme, que certains nomment l’anthropocène. On ne peut pas la préserver telle qu'elle était avant. Cet état des lieux est particulièrement influencé par l'étude du changement climatique puisque les changements physico-chimiques associés au climat ne peuvent être évités, même en créant des réserves strictes et de grande taille. Par ailleurs, le changement climatique va créer des écosystèmes nouveaux qui n'ont pas d'équivalent dans le passé.
Pour se tourner vers le futur, on dispose aujourd'hui de modèles statistiques. Ils permettent, en connaissant la distribution actuelle des espèces dans l'espace, d'associer la présence ou l'absence d'une espèce à des variables environnementales, comme par exemple les variables climatiques. Si on projette ces variables dans le futur, on sera capable de projeter la future distribution de l'espèce dans l'espace. Ces projections s'appuient bien sûr sur des scénarios climatiques qui eux-mêmes s'appuient sur des scénarios quant à notre propre démographie ou notre utilisation des énergies fossiles.
Ce qui peut manquer dans cette approche, c'est de comprendre comment les espèces vont s'adapter à ces changements climatiques, et comment cette adaptation va influer sur leur future distribution. Le cadre théorique de l'adaptation au changement climatique est en train de se développer avec des modèles mathématiques mais aussi avec des approches plus empiriques. Dans ces dernières, on regarde les vitesses d'évolution des niches écologiques dans le passé pour étalonner la vitesse de l'adaptation aux changements climatiques.
On a beaucoup utilisé ce type d'approche à l'échelle des populations des espèces. Mais on sait maintenant qu'il faut l'utiliser également à l'échelle des communautés d'espèces pour comprendre notamment comment ces espèces ont évolué ensemble et comment cette coévolution influence l'adaptation des communautés aux changements climatiques.
Comment cette théorie et ces outils de diagnostic peuvent ensuite être transformés en gestion concrète ? L'un des outils qui est actuellement développé par les conversationnistes est le flux de gènes assisté. Il consiste à transférer de façon intentionnelle des organismes ou des gamètes dans l'aire de répartition de l'espèce. Mais il ne s’agit non pas de l'aire de répartition actuelle, mais plutôt de l'aire de répartition projetée par les modèles statistiques.
4. Conclusion
La question de la gestion de l'évolution de la biodiversité ne concerne pas que les biologistes. Beaucoup d'auteurs pensent aujourd'hui que plusieurs centaines de millions à plusieurs milliards d'espèces ont existé au total sur la Terre. L'immense majorité d'entre-elles ont disparu, et l'extinction fait partie du processus évolutif normal. Aussi, les extinctions de masse qui ont jalonné l'histoire du vivant ont contribué à façonner la biodiversité actuelle.
Si nous sommes aujourd'hui ou demain responsables d'une nouvelle crise d'extinction, l'évolution suivra son cours malgré tout. Mais on est forcé de se demander quel cours et quelle évolution. Il y a derrière ça des choix moraux et des choix de société concernant les trajectoires évolutives. Minimiser nos pressions sur l'environnement, minimiser la perte de diversité génétique, favoriser l'adaptation aux changements : tous ces choix dépendent de nos motivations ultimes pour conserver la biodiversité ou bénéficier de services écosystémiques. Ces deux grands types de motivation, qui ne sont pas incompatibles, déterminent nos actions sur la biodiversité et son évolution. Ils façonnent donc en partie la biodiversité future.