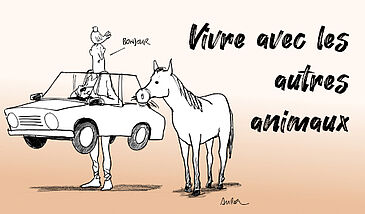En ligne depuis le 23/03/2020
3.4/5 (70)

Description
Les découvertes scientifiques de ces dernières décennies ont changé notre regard sur les autres animaux. Il en découle des questionnements sur nos relations avec eux, aujourd'hui et demain. Ce parcours vous apporte des repères pour vous permettre de vous situer sur ces questions de plus en plus discutées et débattues.
Mobilisant une grande diversité d'experts, issus d'horizons variés, il est organisé autour de trois axes :
- Les animaux : approches des sciences biologiques, humaines et sociales
- Des animaux et des humains : représentations d'hier et d'aujourd'hui
- Vivre demain avec les animaux
Deux niveaux de difficulté sont proposés selon les contenus de ce parcours : le niveau "Débutant" s'adresse aux apprenants de niveau Bac à Bac+3 (Licence), tandis que le niveau "Approfondi" est plutôt destiné aux apprenants de niveau Master et +.
Objectifs d'apprentissage :
- Savoir ce qu'est un animal.
- Situer l’humain par rapport aux autres animaux.
- Comprendre l'évolution de notre regard sur les autres animaux.
- Mieux appréhender la relation des humains aux autres animaux.
- Mieux comprendre ce dont les autres animaux sont capables : pensée, empathie, intelligence, communication,...
- Situer vos connaissances par rapport à un sujet de société complexe et controversé.
- Avoir un point de vue et des éléments de compréhension pour pouvoir mieux orienter vos réflexions et vos échanges.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Les animaux : approches des sciences biologiques, humaines et…

Des animaux et des humains : interactions d'hier et…

Demain, quelles relations avec les autres animaux ?
Ce document contient la transcription textuelle d’une vidéo du MOOC UVED «Vivre avec les autres animaux ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres aux interventions orales des auteurs.
Préserver la biodiversité demain
Sabrina Krief, Professeure au Muséum national d'Histoire naturelle
1. Remise en contexte historique
La conservation de la biodiversité est un enjeu majeur de notre société. Ce n’est pas quelque chose de récent puisque dès 1992, le sommet de la Terre a mis en évidence qu’il fallait protéger la biodiversité et la restaurer à différentes échelles, à la fois au niveau génétique, des espèces et des écosystèmes, et tout particulièrement s’assurer de la fonctionnalité de ces écosystèmes et de ses interactions. Ce sommet de la Terre faisait suite à différentes actions qui avaient déjà été prises précédemment, en particulier la création des parcs nationaux, le premier a été créé en 1890 à Yellowstone, la création de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, ou encore la grosse convention, appelée CITES, qui régule le commerce des espèces de faune et de flore menacées, et d’autres actions telles que celle de l’UNESCO qui émet des labels pour des sites « Patrimoine mondial » d’intérêt pour l’humanité. Dans les années 60, ce concept de préservation de la faune et de la flore a été tout particulièrement incarné par le concept de wilderness, de naturalité, qui voulait exclure l’humain de ces espaces de nature, considérant qu’il ne devait être qu’un visiteur pour ne pas détruire et abîmer les espaces de faune et de flore protégés.
2. Le constat actuel
Malgré ces efforts, le constat actuel est dramatique. L’IPBES, la plateforme pour la biodiversité et les services écosystémiques, a produit en 2019 un rapport qui fait froid dans le dos. Elle cumule les données de 15 000 publications, rapportées par 145 experts de 50 pays et met en évidence que la nature décline globalement à un rythme sans précédent, mais elle nous offre un certain espoir en nous disant qu’il n’est pas trop tard pour agir si on met en œuvre des actions, du local au global. Un million d’espèces végétales et animales sont menacées de disparaître dans un futur proche. L’une des principales menaces se trouve être l’agriculture. Avec l’expansion démographique, trois quarts de la surface de la Terre sont altérés par les activités humaines, avec plus d’un tiers de cette surface terrestre dédiée à l’agriculture ou à l’élevage. Il met aussi en évidence le lien entre érosion de la biodiversité et dérèglement climatique puisqu’un quart des émissions de gaz à effet de serre est causé par la production agricole. Cette expansion agricole se fait souvent aux dépens d’un écosystème majeur, celui de la forêt, et tout particulièrement la forêt tropicale, qui est une ressource incroyable de biodiversité. À cela s’ajoute la pollution, tout particulièrement la pollution plastique, laquelle a été multipliée par dix depuis 1980.
3. L’exemple des chimpanzés
Pour illustrer cet exemple, je vais vous parler de celui des chimpanzés, nos plus proches parents, dont il ne reste aujourd’hui que 200 000 individus sur la planète en milieu naturel. C’est une espèce que j’étudie dans le parc national de Kibale en Ouganda, à la frontière avec la République Démocratique du Congo.
Les chimpanzés vivent uniquement en forêt tropicale. Cette forêt tropicale est un espace de biodiversité avec plus de 800 espèces qui peuvent se trouver sur 50 hectares de forêt. Dans le parc où je travaille, la périphérie a été petit à petit remplacée par la monoculture du thé, souvent associée à la monoculture d’eucalyptus, pour faire sécher ce thé. On se retrouve avec non seulement une espèce végétale dominante, mais également une perte de biodiversité importante : il n’y a plus ni insectes, ni oiseaux, ni grands mammifères qui peuvent utiliser ces espaces de monoculture.
Les chimpanzés que j’étudie appartiennent à une communauté d’une centaine d’individus, parmi lesquels 20 % sont mutilés par les pièges posés par les villageois afin de se procurer du petit gibier. Ils ne sont pas destinés aux chimpanzés. Les chimpanzés en sont les victimes indirectes, mais ils perdent des pieds, des mains et des phalanges. D’autre part, ce parc national est traversé par une route bitumée. Pour rejoindre les deux parties de leur territoire, ces chimpanzés doivent traverser cette route qui a été très récemment élargie. Malgré ces panneaux où l’incitation à protéger la faune sauvage est mise en évidence, la faune est une victime très fréquente de cette route avec un trafic très important.
À la périphérie du parc, nous avons des monocultures de thé qui, pour être les plus productives possible, reçoivent très régulièrement des aspersions d’intrants chimiques, tout particulièrement de glyphosate. Sur les lopins de terre qui restent, les villageois qui veulent cultiver ont besoin d’arroser, alors que nous sommes dans une zone où les précipitations sont très importantes, et également d'utiliser des pesticides, des insecticides et des intrants chimiques pour améliorer la production de leurs terres. Ce type de comportement se reflète également sur les chimpanzés. Leur visage porte les stigmates puisque 30 % d’entre eux ont des malformations faciales, congénitales, avec des absences de narines. Certaines femelles sont stériles et n’ont plus de cycle sexuel, probablement à cause de ces pesticides que l’on retrouve dans les rivières, jusqu’à 4 kilomètres de la zone de dispersion. On peut mettre en évidence, par l’analyse de ces eaux, une quinzaine de pesticides différents avec des doses importantes de glyphosate. Qui plus est, les chimpanzés consomment les plantations faites à la périphérie par les villageois. Ainsi, les chimpanzés mangent du maïs enrobé d’imidaclopride, le fameux néonicotinoïde tueur d’abeille.
Pour noircir encore le paysage, le long de cette route qui traverse le parc, nous avons pu collecter 250 kilos de bouteilles plastiques en à peine quatre mois, mettant en évidence l’extension de cette pollution plastique, même au cœur de la forêt tropicale africaine. Les changements de culture semblent être un facteur qui aggrave encore ce problème. Car si les Ougandais ne consomment pas de viande de chimpanzés, les cultures et les sociétés de thé emploient des ouvriers qui viennent parfois du Congo ou du Rwanda, et qui ont pour habitude de consommer de la viande de chimpanzés. Ceci aggrave encore les menaces qui pèsent sur les chimpanzés.
Cet exemple illustre les causes principales de dégradation de la biodiversité à la fois par l’artificialisation des sols, la pollution, le trafic et les pratiques illégales. Cette situation apparaît caractéristique puisque ce parc national a été créé et a pris forme en excluant les populations locales qui vivaient auparavant dans cette forêt, qui aujourd’hui n’ont que des inconvénients à vivre à la périphérie de ce parc, puisque les animaux, chimpanzés, mais aussi babouins et éléphants viennent piller leurs cultures. Ils n’ont aucun moyen pour s’en défendre.
4. Protéger la biodiversité demain
On peut essayer de protéger des espèces parapluie et clé de voûte de ces écosystèmes. En protégeant les chimpanzés pendant leur durée de vie, 60 à 70 ans, on protège des centaines d’autres espèces, végétales et animales. On doit aussi s’assurer que ces écosystèmes sont fonctionnels. C’est l’hétérogénéité et la complexité de ces écosystèmes qu’il faut protéger. Il faut également favoriser les flux génétiques, en créant des corridors entre les habitats naturels, fragmentés, qui subsistent. Il faut s’attacher à protéger des individus, ces individus étant porteurs de diversité comportementale et culturelle. Si on retourne sur le cas des chimpanzés, ces chimpanzés ont des cultures différentes entre groupes voisins. On ne peut protéger une espèce, sans prendre en compte le fait que des groupes voisins sont très différents. On ne pourra jamais compenser la perte associée à la perte d’un groupe social en protégeant la même espèce à des milliers de kilomètres de cette zone.
Un point très important que l’IPBES met en avant est de remettre au cœur de la conservation les communautés locales qui représentent jusqu’à un milliard de personnes, soit 20 % de la population mondiale. Pour cela, essayer de lier patrimoine culturel, spirituel et naturel est une voie dans laquelle on peut s’engager. Par exemple, en Ouganda, certaines communautés locales ont comme espèce totémique de leur clan le chimpanzé. Pouvoir protéger leur culture et cette espèce permettrait de lier biologie et culturel. Au final, il faut souligner le rôle très important de la recherche, mais aussi connecter la société civile aux ONG, aux politiques et aux industriels.
Dans le cadre de notre projet, nous avons pour objectif, à cinq ans, de tenter de mettre en place un nouveau modèle dans lequel la gestion du parc serait associée entre autorités de gestion du parc traditionnel et communautés locales, où l’agroforesterie remplacerait les monocultures avec une production biologique et équitable, de thé, de café et d’autres produits de première nécessité pour les populations locales, permettant ainsi de générer des revenus plus importants pour les villageois et de passer du conflit à la coexistence avec les espèces animales. Nous avons aussi un rôle très important en tant que consommateurs en choisissant les produits que nous achetons. Si nous choisissons du thé et du café biologique et équitable, nous agissons à des milliers de kilomètres pour améliorer la situation des communautés locales. Tout cela ne peut fonctionner que si on limite le gaspillage, on recycle, on trie et qu’on appuie nos décisions sur le fait de considérer certaines espèces comme étant patrimoniales pour l’humanité ou d’accorder, à certaines espèces animales, une personnalité non humaine.
5. Conclusion
Cet exemple montre qu’il y a urgence à préserver la flore et la faune sauvage. Surtout, il montrer qu’il faut essayer d’allier les savoirs scientifiques, la demande citoyenne et l’action politique avec, comme seule et unique obligation, celle de respecter le vivant, qu’il soit proche et familier, exotique et sauvage.
Contributeurs
BOEUF Gilles
Sorbonne Université
Dumez Richard
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Krief Sabrina
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Huchard Elise
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Saint-Jalme Michel
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Sueur Cédric
Université de Strasbourg (UNISTRA)
Lecointre Guillaume
professeur , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Brunois-Pasina Florence
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Roulot Justine
Ministère de la transition écologique
Tavernier-Dumax Nathalie
Université de Haute-Alsace (UHA)
Burgat Florence
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Lesur Joséphine
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Baratay Eric
Université Jean Moulin Lyon 3
Salines Georges
Dardenne Emilie
Université de Rennes 2
Béata Claude
Trinquier Jean
Ecole Normale Supérieure (ENS/PSL)
Césard Nicolas
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Dufour Valérie
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Beauchaud Marilyn
Université jean Monnet Saint-Etienne
Delahaye Pauline
Société française de zoosémiotique
Meunier Joël
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Laffitte Béatrice
Boivin Xavier
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Grandgeorge Marine
Université de Rennes
Dugnoille Julien
Université d'Exeter
Moutou François
Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Degueurce Christophe
EnvA - Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
Espinosa Romain
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Laprade Marie-Laure
Éducation Éthique Animale