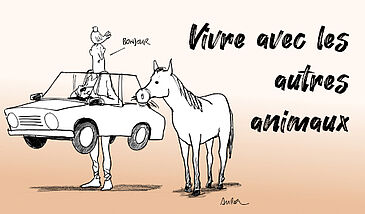En ligne depuis le 23/03/2020
3.4/5 (70)

Description
Les découvertes scientifiques de ces dernières décennies ont changé notre regard sur les autres animaux. Il en découle des questionnements sur nos relations avec eux, aujourd'hui et demain. Ce parcours vous apporte des repères pour vous permettre de vous situer sur ces questions de plus en plus discutées et débattues.
Mobilisant une grande diversité d'experts, issus d'horizons variés, il est organisé autour de trois axes :
- Les animaux : approches des sciences biologiques, humaines et sociales
- Des animaux et des humains : représentations d'hier et d'aujourd'hui
- Vivre demain avec les animaux
Deux niveaux de difficulté sont proposés selon les contenus de ce parcours : le niveau "Débutant" s'adresse aux apprenants de niveau Bac à Bac+3 (Licence), tandis que le niveau "Approfondi" est plutôt destiné aux apprenants de niveau Master et +.
Objectifs d'apprentissage :
- Savoir ce qu'est un animal.
- Situer l’humain par rapport aux autres animaux.
- Comprendre l'évolution de notre regard sur les autres animaux.
- Mieux appréhender la relation des humains aux autres animaux.
- Mieux comprendre ce dont les autres animaux sont capables : pensée, empathie, intelligence, communication,...
- Situer vos connaissances par rapport à un sujet de société complexe et controversé.
- Avoir un point de vue et des éléments de compréhension pour pouvoir mieux orienter vos réflexions et vos échanges.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Les animaux : approches des sciences biologiques, humaines et…

Des animaux et des humains : interactions d'hier et…

Demain, quelles relations avec les autres animaux ?
Ce document contient la transcription textuelle d’une vidéo du MOOC UVED «Vivre avec les autres animaux ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres aux interventions orales des auteurs.
Introduction à l'éthique animale
Cédric Sueur, Maître de conférences à l'Université de Strasbourg
1. Cadre théorique
L'éthique animale est l'étude de la responsabilité morale des hommes à l'égard des animaux pris individuellement. Elle cherche à comprendre si les animaux ont des droits, si les hommes ont des devoirs envers les animaux, si ces derniers méritent tous notre considération, et sinon lesquels, et quel impact ceci va avoir sur la société en termes d'alimentation, de recherche scientifique ou par exemple, de vêtements.
Ce n'est donc pas une charte, ou un ensemble d'idées, mais bien un ensemble de questions qui peuvent évoluer, justement, au fur et à mesure du temps. Il n’est donc pas intéressant, ou vrai, de dire que ceci est éthique. Ceci n'est pas éthique, puisque ce qui est vrai, aujourd'hui, ne l'est pas forcément demain. Il y a donc deux règles à retenir : la première, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue et la seconde c'est que la majorité a raison et qu'il faut s'y conformer.
Il faut distinguer l'éthique animale de la bioéthique et de l'éthique environnementale. La bioéthique est tout ce qui va toucher la recherche médicale. On va parler de lien entre la bioéthique et l'éthique animale à travers l'expérimentation animale, les xénogreffes, ou encore la recherche sur les embryons. L'éthique environnementale va plus toucher notre environnement et l'ensemble de ses paramètres, et de ce fait, il peut aussi y avoir un lien entre éthique animale et éthique environnementale, de manière indirecte. Par exemple, pour l'élevage industriel, si on se poser la question "a-t-on le droit de tuer ou de manger des animaux", ça va être de l'éthique animale. Mais s’il s’agit de s’interroger sur les problématiques au niveau environnemental, comme le déboisement, ou le réchauffement climatique, ou la pollution des eaux, ça va être de l’éthique environnementale.
2. Cohérence des pratiques et des valeurs
Beaucoup de chercheurs en éthique animale pensent que les personnes qui se disent "défendre l'animal" le font parfois de manière incohérente. Peter Singer, qui est un grand philosophe travaillant sur l'éthique animale, va rapporter une anecdote où il dit qu'une femme lui dit combien elle aime les animaux, elle tient un refuge pour chats et pour chiens, tout en mangeant un sandwich au jambon. Il y a donc, ici, une incohérence. Cette incohérence peut aussi se voir, du fait que, nous, Français par exemple, allons critiquer les Chinois qui mangent du chien, mais nous mangeons du cochon, espèce qui n'est pas moins sensible et pas moins intelligente que le chien. Il y a donc ce qu'on appelle, une schizophrénie morale, ou une dissonance cognitive, qui a été qualifiée de spécisme.
3. Le spécisme
Le spécisme est un néologisme qui a été inventé en 1970, par Richard Ryder, en faisant référence directement au racisme, la discrimination en fonction de la race et au sexisme, la discrimination en fonction du genre. Au niveau du spécisme, on peut voir la différence que l'on va faire justement entre nous, hommes, envers les animaux, ou faire entre une espèce animale avec une autre espèce animale. Ce critère de spécisme peut se baser justement sur la familiarité qu'on va avoir avec les animaux, leur taille, notre culture ou d'autres arguments.
Pourquoi l'homme, dans ce spécisme, fait justement une différence, entre lui et les animaux ? Les chercheurs en éthique animale rapportent à travers différents articles que l'homme se sentirait justement supérieur par rapport aux animaux. Ce serait une supériorité qui serait culturelle et religieuse. Argument que l'on retrouve, par exemple, dans la Bible, avec Dieu qui dit : "Je bénis l'homme et la femme, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-là, dominez tous les animaux sur terre, les oiseaux dans le ciel, les poissons dans l'eau, etc." Malebranche va pousser l'argument de Descartes, de l'animal-machine, jusqu'à dire justement qu'aucun animal ne souffre et que tout est mécanique. Darwin dit que l'homme, dans son arrogance, se sent justement l'œuvre d'un dieu, mais qu'il serait plus un animal ou une espèce qui descend des animaux. Cette supériorité, 150 ans après les arguments de Darwin se retrouvent encore, aujourd'hui, dans nos discours, où l'on entend souvent que l'homme est au sommet de l'évolution, l'homme est au sommet de la chaîne alimentaire.
Un autre argument face à ce spécisme serait justement d'origine biologique. En effet, a-t-on déjà vu les individus d'une espèce A se sentir inférieurs ou privilégiés des individus d'une espèce B ? D'un point de vue évolutif de la sélection naturelle, cet argument ne tient pas. On n'a jamais vu dans la nature des animaux privilégier ou s'intéresser plus à des individus d'une autre espèce par rapport à la leur. De ce fait, la supériorité qui existe chez l'homme serait également une supériorité qui existerait chez n'importe quelle espèce animale.
4. L’utilitarisme
Peter Singer est un grand philosophe au niveau de l'éthique animale et a émis une théorie qui est la théorie de l'utilitarisme. Il dit que tous les animaux sont égaux. Ce n'est pas une égalité de fait, mais une égalité de droit. Les hommes ne sont pas tous égaux entre eux, pourtant, ils ont tous les mêmes droits. Pour Peter Singer, l'égalité de considération des intérêts n'est pas la même chose que l'égalité des traitements ou l'égalité des vies. Nous avons tous des intérêts différents, tel animal a un intérêt différent qu'un autre animal, et de ce fait, il faut respecter ses intérêts. Par exemple, tous les animaux n'ont aucun intérêt à souffrir. De ce fait, si on prend une souris, si on se base par rapport à l'homme, étant donné qu'on ne veut pas faire souffrir l'homme, on ne devrait pas faire souffrir cette souris qu'on va utiliser dans les expériences animales. Par contre, cette souris n'a pas conscience de sa vie, elle n'a pas conscience de sa mort, elle n'a pas conscience d'elle-même par rapport à un homme qui, lui, a conscience de sa vie, a conscience de sa mort et a conscience de lui-même. De ce fait, on pourrait utiliser la souris dans les expérimentations animales, alors qu'on ne pourrait pas utiliser l'homme. Peter Singer utilise justement l'exemple de cas marginaux pour illustrer ceci. Vous êtes sur un bateau avec un bébé et un chien. Le bateau, le radeau doit chavirer ou couler. La question est : "Qui allez-vous sauver : le bébé ou le chien ?". Vous ne connaissez rien sur le devenir de l'enfant ni sur le devenir du chien. Par contre, vous savez que le bébé est handicapé mentalement et que le chien est super intelligent. Basé sur cet argument, vous devriez sauver le chien. Peter Singer utilise cet argument pour dire que, justement, étant donné que l'on ne fait pas des expériences sur des handicapés humains, comateux ou inconscients, on ne devrait pas non plus faire des expériences sur des chiens qui sont, eux, conscients.
Cohen lui assume le spécisme. Il donne un argument et un exemple assez précis. Il dit : "Croyez-vous que le bébé zèbre a le droit de ne pas être égorgé et que la lionne a le droit de tuer ce bébé zèbre pour nourrir ses petits ?" Dans cet exemple, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de moralité. Étant donné que les animaux sont amoraux, ils ne devraient pas avoir de droits. Seuls les humains qui sont moraux, qui ont une moralité, peuvent bénéficier de droits.
5. Abolitionnisme versus welfarisme
En éthique animale, on va aussi étudier ou réfléchir sur l'abolitionnisme qui a été émis par Gary Francione et Tom Regan. Leur argument est que l'on ne doit pas élargir les cages, mais faire en sorte qu'elles soient vides. Gary Francione dit que le réformisme que l'on fait, les lois que l’on applique sur les animaux, étant donné qu’on les laisse dans les biens, ne seront jamais assez suffisantes pour le bien-être et la protection des animaux. Il faut donc les sortir de ces biens et les mettre en tant ou les définir en tant que personne non humaine. Tom Regan, lui, parle de sujets d'une vie et il donne une valeur inhérente à tous les êtres vivants animaux. C'est une théorie égalitariste, mais le problème de cette théorie égalitariste, c'est que les plantes, aussi, ont une valeur inhérente à leur vie, les plantes aussi veulent vivre et de ce fait, cette théorie est bancale.
En éthique animale, on différencie aussi les abolitionnistes des welfaristes. Les abolitionnistes veulent la fin de toute exploitation animale, alors que les welfaristes souhaitent améliorer la condition animale. Les abolitionnistes et les welfaristes ne vont pas avoir les mêmes objectifs, mais peuvent avoir, parfois, les mêmes moyens. On va différencier, par exemple, les abolitionnistes welfaristes qui veulent à la fin la cessation de toute exploitation animale, mais qui vont utiliser des procédés à court ou à moyen terme pour arriver à la fin de cette exploitation. D'un autre côté, il existe aussi des abolitionnistes anti welfaristes, qui considèrent que le changement de loi n'est pas suffisant pour les animaux, pour leur bien-être, et ils veulent de ce fait la fin immédiate de toute exploitation animale.
Contributeurs
BOEUF Gilles
Sorbonne Université
Dumez Richard
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Krief Sabrina
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Huchard Elise
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Saint-Jalme Michel
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Sueur Cédric
Université de Strasbourg (UNISTRA)
Lecointre Guillaume
professeur , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Brunois-Pasina Florence
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Roulot Justine
Ministère de la transition écologique
Tavernier-Dumax Nathalie
Université de Haute-Alsace (UHA)
Burgat Florence
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Lesur Joséphine
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Baratay Eric
Université Jean Moulin Lyon 3
Salines Georges
Dardenne Emilie
Université de Rennes 2
Béata Claude
Trinquier Jean
Ecole Normale Supérieure (ENS/PSL)
Césard Nicolas
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Dufour Valérie
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Beauchaud Marilyn
Université jean Monnet Saint-Etienne
Delahaye Pauline
Société française de zoosémiotique
Meunier Joël
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Laffitte Béatrice
Boivin Xavier
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Grandgeorge Marine
Université de Rennes
Dugnoille Julien
Université d'Exeter
Moutou François
Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Degueurce Christophe
EnvA - Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
Espinosa Romain
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Laprade Marie-Laure
Éducation Éthique Animale