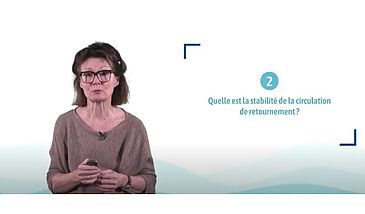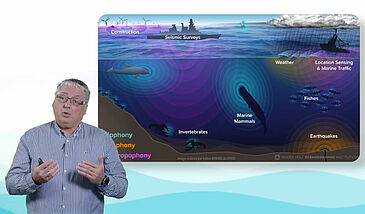En ligne depuis le 19/02/2025
0/5 (0)

Description
Bruno David, ancien Président du Muséum national d'Histoire naturelle, discute dans cette vidéo de l'état de nos connaissances par rapport à l'océan. Il évoque les bouleversements actuels et passés, et en appelle à la précaution compte tenu de la difficulté à prédire les évolutions futures des écosystèmes marins.
Objectifs d'apprentissage :
- Situer l'état des connaissances scientifiques par rapport à l'océan
- Donner des exemples de crises traversées par l'océan dans son histoire
- Expliquer pourquoi il est difficile de prédire l'évolution de l'océan
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Sciences de la vie et de la Terre
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+1
- Bac+2
Objectifs de Développement Durable
- 14. Vie aquatique
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
David Bruno
ancien Président , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Ce document est la transcription révisée, chapitrée et illustrée, d’une vidéo du MOOC UVED « L’Océan au cœur de l’Humanité ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.
L'océan : un terrain connu ?
Bruno David, Ancien Président du Muséum national d'Histoire naturelle
1. Ce que l’on connaît de l'océan
On en connaît à la fois beaucoup et peu. On en connaît beaucoup, parce que ça fait de nombreuses années que des chercheurs s'intéressent à ce qu'est l'océan et essayent de comprendre ce qu'est l'océan à travers son fonctionnement physico-chimique ou à travers la vie qu'il héberge.
Mais on se rend compte qu'on en connaît finalement assez peu, parce que c'est un monde qui ne nous est pas familier. Ce n'est pas si simple que ça d'aller voir ce qui se passe dans l'océan.
Les recherches qu'on a pu faire dernièrement nous ont aidés à prendre une mesure de notre ignorance, en quelque sorte. Avant, on ne savait pas qu'on ne savait pas. Maintenant, on sait à peu près qu'on ne sait pas.
2. L’exemple de l’expédition Tara
Un exemple emblématique a été ce qu'a fait la goélette Tara il y a une dizaine d'années. Elle a fait un tour du monde, navigué un petit peu partout, et a récupéré des "seaux d'eau", avec des systèmes de bouteilles qui permettent de récupérer de l'eau à différentes profondeurs.
Ils ont regardé ce qu'il y avait dans cette eau à différentes profondeurs, et ils se sont rendu compte qu'il y avait des milliers, des dizaines de milliers de micro-organismes qu'on ne connaissait pas et qui étaient dans tous ces endroits de l'océan mondial.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne sait pas très bien comment fonctionne l'océan, puisque tous ces organismes nous avaient échappé. Ils sont tout petits, certes, mais ils sont déjà assez compliqués. C'est ce qu'on appelle des eucaryotes unicellulaires. Ils ont des cellules qui ont un noyau, avec un certain nombre d'organites autour du noyau qui font qu'il y a une complexité, une physiologie, un fonctionnement de cette cellule qui est déjà assez complexe. Mais ils sont unicellulaires et sont donc tout petits et microscopiques. Ils en ont identifié 150 000 différentes espèces. C'est gigantesque par rapport à ce qu'on connaissait de l'océan.
C'est vraiment illustratif de ce qu'on ne connaît pas encore de l'océan et c'est pour ça qu'il faut continuer les recherches dans le domaine de l'océan.
3. Un océan sous pression
En observant l'océan, on se rend compte qu'il est sous pression. Il y a un certain nombre de pressions qui s'exercent sur l'océan, qu'on connaît bien, et qui s'exercent aussi sur la vie qui est dans l'océan. Les scientifiques voient ça et ils arrivent à apprécier aussi un peu l'ampleur de ce que ça représente.
Un exemple est celui de ce qu'on appelle l'acidification de l'océan. Il est le fait son pH baisse de plus en plus, et que ça a des impacts, notamment sur le développement larvaire d'un certain nombre d'organismes, qui risquent d'être moins abondants, voire, pour certaines espèces, de s'éteindre. Les scientifiques voient un petit peu ce qui se passe au-delà de la surface.
Le grand public, lui, voit la surface de l'océan, et il ne se rend pas forcément compte de ce qui arrive à l'océan. Ils se rend compte que quand il y a des grosses tempêtes, et il y en a de plus en plus, le littoral est sous tension, et il se dit : "La maison que j'ai sur le bassin d'Arcachon, combien de temps elle va tenir ?" Le grand public se rend compte qu'il peut y avoir de la surpêche, et qu'il y a eu par exemple le problème du thon rouge en Méditerranée. On a mis un moratoire en place, ils sont revenus, très bien. Il se rend compte qu'au-delà de cette surpêche, il y a des continents de plastique dont il a entendu parler. Mais au-delà de ça, il ne voit pas à quel point des grands cycles biogéochimiques peuvent être perturbés. Il ne voit pas à quel point il peut y avoir des impacts dans les grands fonds océaniques, au-delà de 2 000, 3 000, 4 000 mètres de profondeur.
Ça, les scientifiques commencent à le percevoir, et ils savent qu'il va y avoir des problèmes, à terme. Après, il faut que tout le monde en prenne conscience, ce qui n'est pas évident quand on est un animal terrestre qui a l'habitude de gambader sur les continents et de ne pas mettre son nez dans l'eau.
4. L’océan passé et l’océan futur
Est-ce qu'on a des références, dans le passé géologique de la Terre, qui pourraient nous aider à comprendre ce qui pourrait advenir de l'océan dans les décennies, voire les siècles qui viennent ?
On est face à un problème avec l'océan, qui est qu'il y a une inertie dans le système océanique, c'est-à-dire qu'il ne réagit pas aussi vite que réagissent les écosystèmes continentaux. Il y a une inertie temporelle ; la masse d'eau est considérable. Elle se réchauffe à un rythme totalement différent de celui de l'atmosphère, par exemple, et donc l'impact du réchauffement sur la masse d'eau océanique va se faire sentir d'ici quelques siècles, sans doute. On a donc du mal à se projeter.
Mais on a quand même des références anciennes. Une référence est par exemple le "Paleocene-Eocene Thermal Maximum", PETM, qui s'est passée il y a 55 millions d'années : un réchauffement assez brutal à l'échelle géologique, mais vraiment brutal pour l'échelle géologique. A ce moment-là, on était dans une période chaude, et c'est devenu une période trop chaude, avec des secteurs de l'océan qui étaient vraiment extrêmement chauds. On avait des températures moyennes, dans certains secteurs, qui étaient au-delà de 30 degrés. Là, on a vu l'influence de ce réchauffement sur la microfaune, notamment. On a vu qu'il y avait toute une série d'espèces qui s'étaient éteintes, des espèces qui avaient migré... Il y a eu des transformations majeures dans le fonctionnement de l'océan, jusqu'à ce qu'il revienne à la normale, quelques milliers d'années plus tard.
On a des exemples plus anciens. À la limite entre l'ère primaire, le paléozoïque, et l'ère secondaire, le mésozoïque, il y a une crise majeure qui va faire disparaître un grand nombre d'espèces marines, plus de 90 % d’entre elles : des grosses espèces marines, pas des micro-organismes et des virus. Elles vont disparaître, et on va basculer dans d'autres écosystèmes. L’un de ces écosystèmes de la fin de l'ère primaire était composé de grandes prairies sous-marines, sans doute extrêmement colorées si on fait référence aux animaux qui existent toujours actuellement, mais qui sont devenus très rares. C'était des animaux qui avaient une sorte de système racinaire, qui avaient une tige et une corolle au bout de la tige, et qui vivaient un petit peu plantés comme des fleurs. Il y avait une densité de ces animaux assez incroyable qui fait que ça ressemblait à des prairies. Ces organismes, qui sont des cousins des oursins et des étoiles de mer, qui tapissaient le fond de l'océan sur des surfaces gigantesques, ont disparu au moment de la crise. Il n'y en a plus maintenant que dans les grands fonds, et pour certains d'entre eux, seulement.
Donc on voit bien qu'au moment d'une crise comme celle qu'on est en train d'amorcer, il y a des gagnants, il y a des perdants, et que les écosystèmes qui vont se régénérer après la crise, parce qu'ils vont se régénérer après la crise, même si ça prend, en gros, un million d'années. Il faut être patients. Et quand ils se régénèrent, il y a des gagnants qui sortent, et les perdants qui ne sont plus là. Ces impacts sont considérables.
Scientifiquement, on essaye de les percevoir, d'essayer de se projeter dans le futur, mais c'est très difficile, justement à cause de cette inertie de l'océan. On ne sait pas exactement quel impact ça va avoir. Si on parle de l'acidification, c'est-à-dire de la diminution du pH, ça a des impacts sur les larves. Est-ce que certaines espèces vont être résistantes par rapport à ça ou pas ? Est-ce que l'espèce A, qui est résistante mais qui dépend de l'espèce B pour se nourrir, qui, elle, n'est pas résistante, va survivre ? Et réciproquement ? On voit bien qu'on peut avoir des effets en cascade dans le fonctionnement des écosystèmes, et cela va perturber complètement l'écosystème, qui va franchir un seuil et se mettre à fonctionner différemment. C'est une crise, une bascule dans un autre état. Et ce nouvel état, sera-t-il propice au développement des activités humaines ? On ne sait pas.
5. Et maintenant ?
Le constat est qu'on sait un certain nombre de choses. On sait que nos activités humaines, anthropiques au sens large, ont une incidence sur le fonctionnement de l'océan. Même si on ne perçoit pas dans le détail ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer, on sait que ça a une incidence. Et on sait que cette incidence va s'inscrire sur un temps long, avec une déstabilisation qui sera assez longue, ce qu'on peut considérer comme rassurant, mais un retour à l'équilibre qui sera également très long, ce qui n'est pas très rassurant si on a envie de revenir à un équilibre antérieur. Il y a donc une grosse prise de risque.
Ces activités, c’est ce qu'il y a de pernicieux, on n'en voit pas les effets immédiats, et donc on a l'impression que tout va bien. À part les continents de plastique que j'évoquais précédemment, on a l'impression que tout va bien. Or ça ne va sans doute pas si bien que ça...
Il y a simplement une clause de précaution qu'on devrait appliquer. On devrait réduire un certain nombre de nos pressions anthropiques, et on sait assez bien lesquelles. On pourrait réduire la pollution de l'océan. On pourrait réduire les activités de surexploitation de l'océan, à travers la surpêche et les choses comme ça. On sait très bien ce qu'on pourrait faire. Je n'ai pas l'impression qu'on le fasse. Et c'est même pire que ça : j'ai l'impression qu'on est même tentés d'aller chercher encore plus de ressources dans l'océan. On peut évoquer les ressources minières, par exemple, des grands fonds marins, où on se dit : "Finalement, on n'a pas suffisamment de ressources de métaux et de minéraux sur les continents. On va aller chercher dans les grands fonds. On a une technologie qui nous permet d'y aller."
Je pense, pour ma part, que ça serait la pire des erreurs, parce que ça serait une fuite en avant, de manière assez inconséquente, sans savoir et sans vraiment prendre la mesure de l'impact de telles activités sur le fonctionnement même de l'océan.