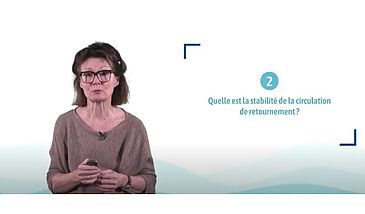En ligne depuis le 19/02/2025
5/5 (1)

Description
Frédéric Olivier, professeur du Muséum national d'Histoire naturelle, discute dans cette vidéo des impacts des bruits d'origine humaine sur le cycle de développement des invertébrés marins. Il présente les dispositifs expérimentaux qui permettent d'apprécier cela et montre les principaux résultats de ces travaux de recherche.
Objectifs d'apprentissage :
- Définir la variété des bruits présents en milieu marin
- Présenter un dispositif expérimental permettant d'étudier les impacts du bruit sur les organismes marins
- Expliquer les réponses possibles des invertébrés marins aux bruits d’origine humaine
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Sciences de la vie
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+3
- Bac+4
Objectifs de Développement Durable
- 14. Vie aquatique
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Olivier Frédéric
professeur , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Ce document est la transcription révisée, chapitrée et illustrée, d’une vidéo du MOOC UVED « L’Océan au cœur de l’Humanité ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.
Les bruits sous-marins : quels impacts sur les invertébrés ?
Frédéric Olivier, Professeur du Muséum national d'Histoire naturelle
Cette présentation porte sur un polluant émergent : ce sont les sons qui sont émis sous l'eau par les activités humaines. Je vais vous parler de leurs impacts sur l'écologie d'un grand groupe de mollusques : les bivalves marins. Ces mollusques sont d'un intérêt aquacole et halieutique et ils ont aussi un rôle fonctionnel, notamment dans la limitation des "blooms" d'algues toxiques.
1. Les sons dans l’océan
Cousteau avait tort, l'océan est bruyant, et quand nous mettons un hydrophone dans cet océan, nous sommes capables d'enregistrer une multitude de sons qui proviennent de différentes origines.
Nous avons premièrement des sons qui sont associés à l'environnement physique : la pluie, les vagues... On peut même avoir des séismes, qui vont caractériser ce qu'on appelle la géophonie.
Après, les sons peuvent être produits par des organismes marins. On connaît bien les mammifères marins (les baleines, les dauphins, etc.), mais nous avons démontré ces dernières années que les invertébrés, notamment les crustacés, sont capables d'émettre des sons très caractéristiques, comme les homards et les langoustes, qui se propagent sur des longues distances. Cela caractérise la biophonie.
Mais nous ne sommes pas dans un environnement vierge. Il y a beaucoup d'humains, et ces humains, par le trafic maritime, par l'installation de parcs éoliens dans l'eau, vont générer des sons anthropiques, ce que l'on qualifie d'anthropophonie. Sur ce graphe, vous avez en abscisse l'échelle de fréquence qui va de 1 Hz jusqu'à 100 kHz, et puis, en ordonnée, l'échelle qui est en décibels. Cette échelle est logarithmique, ce qui veut dire que si vous augmentez de 3 dB, vous allez avoir un doublement du son.
Nous pouvons atteindre, dans le milieu naturel, des niveaux très élevés lors d'explosions sous-marines, avec des niveaux supérieurs à 290 dB. Lors de la phase d'installation d'un parc éolien, vous avez du battage de pieu qui peut atteindre 200 à 270 dB selon la forme et la taille du marteau, et puis le forage à 190 dB. Pour le trafic maritime, nous sommes à des niveaux qui sont inférieurs. On parle de 175 dB pour un porte-conteneurs assez conséquent.
On se pose la question de l'impact de ces sons anthropiques sur des bivalves marins. Un bivalve marin peut coloniser des zones rocheuses, comme les moules bleues qui sont un modèle que nous étudions beaucoup, mais aussi des zones sableuses. Je vais vous parler d'une espèce assez emblématique qui est la coquille Saint-Jacques, Pecten maximus.
2. L’audition des bivalves marins
Ces organismes vont disposer d'un organe sensoriel abdominal qui intègre toute une couche de cils sensoriels qui sont sensibles à cette vitesse particulaire, ou, pour d'autres mollusques, des statocystes. Un statocyste, c'est une cellule au sein de laquelle vous pouvez avoir une particule ou plusieurs, des "statoconia", qui sont, en fait, en carbonate de calcium. Quand vous avez le déplacement d'une onde sonore, vous avez une agitation de ces particules qui vont toucher des cils sensoriels et générer un influx nerveux.
Un bivalve entend surtout des basses fréquences, inférieures à 1 000 Hz. Ca tombe vraiment pile dans la même gamme de référence que les sons qui sont émis par les activités humaines.
En France, vous avez deux grandes sources d'anthropophonie : le trafic maritime, dont je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui, et puis tout ce qui est EMR, les énergies marines renouvelables, via l'installation de parcs éoliens sur toutes les côtes françaises. Je vous parlerai de la phase d'installation, qui inclut deux opérations : le forage et puis le battage de pieu.
3. Impacts sur le cycle des mollusques
Ces mollusques, dans nos zones tempérées, possèdent un cycle de vie benthopélagique, c'est-à-dire qu'il y a une fécondation dans l'eau, une émission de larves qui vont durer pendant deux à trois semaines jusqu'à une larve que l'on qualifie de compétente : elle est apte à se fixer et à se métamorphoser, elle possède un pied et elle est équipée aussi de statocystes. Cette larve, une fois fixée et métamorphosée, va donner un juvénile et un adulte.
J'ai besoin de vous présenter une théorie qui est la théorie de la larve désespérée. Elle stipule que des larves, plus elles vont rester dans la colonne d'eau, plus elles vont consommer leurs réserves, et moins elles seront aptes à sélectionner un habitat favorable par rapport à un habitat qui est défavorable, pour arriver à ce stade de larve désespérée qui est un stade où la larve peut se fixer sur un habitat et mourir par la suite. Il y a donc des signaux négatifs qui vont retarder cette métamorphose, d'autres qui vont l'accélérer.
Pour estimer l'impact de nos sons anthropiques sur nos larves, nous avons développé un système qui s'appelle le système Larvosonic, qui est un mésocosme dans lequel on va recréer des conditions d'émissions sonores HD avec l'imitation de tout ce qui est phénomènes de résonance et de réverbération des ondes au niveau de ce bac. Les larves sont dans des systèmes de cylindres dans lesquels vous allez avoir des algues sur lesquelles elles vont pouvoir se nourrir. Nous pouvons donc tester différents types de bruits : des bruits impulsifs comme le battage de pieu et des bruits continus comme le forage. Vous voyez les bandes de fréquence qui y sont associées à la droite de cet écran.
Nous avons démontré, après des expérimentations assez courtes, que le forage avait un effet négatif et retardait la métamorphose, alors que le battage avait tendance à l'accélérer. On peut se dire que le battage de pieu est positif, puisque ça diminue la dispersion larvaire et la prédation qu'il peut y avoir de nos larves dans la colonne d'eau. Mais par contre, si ce battage était émis sur des zones qui sont défavorables à la vie future de la larve, il y aurait un problème avec une surmortalité de ces larves qui se sont trompées de signal.
Nous avons voulu aussi travailler, c'est venu de la part de questions de pêcheurs en baie de Saint-Brieuc, sur l'impact de ces sons sur la reproduction des coquilles Saint-Jacques. Nous avons donc exposé des adultes de coquilles Saint-Jacques, nous les avons fait pondre pour avoir des larves, et nous avons remarqué qu'il n'y avait pas de mortalité excessive de ces larves ni des adultes pendant la phase d'exposition, mais, par contre, que quand les parents étaient exposés au battage de pieu, leur progéniture était beaucoup plus performante. Il y a donc des phénomènes compensatoires que ces adultes sont capables de faire. Les croissances larvaires sont meilleures, la métamorphose est accélérée. Nous qualifions cet effet d'effet maternel, anticipatoire, et qui traduit bien que le son anthropique est un stress pour notre organisme, mais qu'il peut mettre en place ces mécanismes compensatoires.
4. Conclusion
Les conclusions de ce travail est que nous avons, en tant qu'écologistes marins, oublié que le son pouvait être un facteur très important. C'est un peu logique dans l'évolution de ces organismes, puisque le son peut être entendu alors qu'on a des conditions de nuit ou de turbidité majeures dans la colonne d'eau notamment.
Nous avons un réel déficit de connaissances sur ces impacts acoustiques d’origine anthropiques. Nous avons besoin de définir des seuils de tolérance qui vont être intéressants pour la gestion de ces bruits, que ce soit pour du trafic maritime ou des parcs éoliens.
C'est aussi un moteur d'évolution de la dynamique des communautés, puisque si vous partez d'un assemblage avec X espèces, il y a des espèces qui ne sont pas sensibles à ces sons anthropiques, d'autres peuvent être inhibées, d'autres vont être facilitées... Au bout de multiples cycles de reproduction, vous allez avoir un assemblage qui va complètement changer.
Vous voyez que nous avons vraiment un défi à relever pour les prochaines décennies pour répondre à ces questions de seuil, répondre à ces questions d'impact et développer des recherches en éco-acoustique.