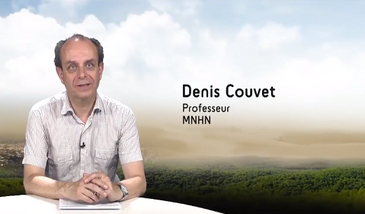En ligne depuis le 02/11/2017
4.5/5 (11)

Description
Frédérique Chlous, professeure au Muséum national d'Histoire naturelle, discute dans cette vidéo (9'34) des procédures participatives qui encadrent les questions de biodiversité. Elle met en évidence les enjeux de cette mise en discussion, les méthodes qui permettent d'y arriver et, pour conclure, évoque les clés du succès de ce type de démarches.
Objectif d’apprentissage :
- Comprendre les enjeux, les méthodes et les clés du succès des procédures participatives en matière de protection de l’environnement.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Mentions Licence
- Droit
- Science politique
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
- Transition juste & équitable
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Chlous Frédérique
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Ce document contient la transcription textuelle d’une vidéo du MOOC UVED «Biodiversité et changements globaux ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres aux interventions orales des auteurs.
La mise en discussion des enjeux de la biodiversité
Frédérique Chlous
Professeur, MNHN
La question de la participation des citoyens ou des acteurs concernés se pose, aujourd'hui, dans la gestion d’un environnement soumis à de multiples pressions et aux changements globaux.
1. La Loi
Cette mise en discussion est contrainte par la loi. En France, la multiplication des procédures participatives concerne plus particulièrement trois grands domaines : l'éthique et le technologique, les OGM, les déchets nucléaires, l'aménagement du territoire, la gestion de l'environnement. Aucun des échelons du politique, de la commune à la région ou à l'état, n'échappe à l'accroissement de ces procédures participatives. Ces discussions sont mises en œuvre au sein de différents échelons ou au sein de territoire constitué, des zones Natura 2000, des parcs nationaux ou naturels, des réserves naturelles. Plusieurs textes de loi invoquent, spécifiquement, la participation des citoyens.
Pour n'en citer que quelques-uns, il y a la loi Bouchardeau qui introduit l'obligation d'informer et le droit à la parole, ou encore la loi Barnier relative au renforcement de la protection de l'environnement. Ces premières lois se situent exclusivement au niveau des principes. D'autres lois ont donné corps à cette participation, comme la loi Voynet pour l'aménagement du territoire et le développement durable ou, à l'échelle européenne, la convention d'Aahrus qui s'intéresse à la gestion environnementale et consacre un droit à l'information, à l'accès à la justice, et surtout à la participation du public concerné, à l'élaboration de la réglementation dans le domaine environnemental. Ainsi, en 2006, la loi sur les parcs nationaux, datant de 1960, a été revue. Celle concernant les parcs naturels marins organise la création des parcs avec au préalable une discussion des instances concernées et un conseil de gestion laissant une large place aux acteurs du territoire dans leur diversité.
Parmi les différents champs du politique, le domaine de l'environnement est particulièrement intéressant, car les problèmes soulevés sont complexes, conflictuels, et controversés. La résolution des questions soulevées nécessite la mobilisation de nombreux acteurs, interagissant à diverses échelles. La loi en porte désormais l'obligation. De même, la gestion environnementale transgresse les territoires administratifs habituels pour se doter de périmètre adéquat, parc marin, zone Natura 2000, réserve naturelle, les aires protégées. Il s'agit alors de co-construire un territoire au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire de créer du lien social entre les différents acteurs et de poser les bases d'une communauté. Aujourd'hui, aux valeurs protectionnistes qui présument la culpabilité de l'homme, les espaces naturels sont davantage considérés comme des espaces sociaux, qui sont le résultat d'un travail multiséculaire. Il s'agit désormais de concevoir une gestion permettant de concilier des usages qui peuvent évoluer et la préservation des milieux. Il y a alors deux conséquences essentielles. N'importe quel intervenant est potentiellement un « producteur » de nature : l'agriculteur, le forestier, l'urbaniste, le pêcheur. La protection ne peut se faire sans lui. Les résultats de la discussion doivent ainsi permettre une organisation favorisant la gestion d'un territoire, la réalisation de documents d'orientation, l'énumération d'objectifs. Mais au-delà de la conception d'un projet pour un territoire, il s'agit aussi de reconnaître, au sens plein du terme, la diversité des groupes sociaux dans ses pratiques et systèmes de valeurs.
2. Mise en œuvre
La diversité des procédures participatives est grande. Des innovations interviennent régulièrement à l'échelle nationale, par exemple avec les conférences de citoyens ou à des échelles plus locales. La forme peut être institutionnalisée, c'est-à-dire précisée à travers des décrets et être garantie, par exemple par un commissaire enquêteur. Nous pouvons citer le référendum, l'enquête publique, la commission nationale du débat public. Les formes non institutionnalisées peuvent être élaborées au gré des initiateurs, en fonction des acteurs présents et des questions posées. Elles peuvent être formalisées, c'est-à-dire reproductibles, ou construites selon l'inspiration des animateurs. Elles peuvent revêtir des formes artistiques, théâtre, atelier photographique, miser sur les ressources de l'informatique, modélisation, jeu de rôles. On peut aussi utiliser des médias, par exemple le e-débat, ou encore s'appuyer sur des réflexions engagées par la sociologie et la psychosociologie, comme les conférences de citoyens ou les sondages délibératifs.
Les objectifs ne sont pas toujours clairement définis ni bien compris par les différents acteurs, ce qui peut leur poser un véritable problème de positionnement et d'engagement. Il paraît pourtant important de préciser s'il s'agit de procédure consultative, ou de participation à la construction d'un projet, ou de procédure décisionnelle où les citoyens partagent le pouvoir avec les élus, par exemple dans les budgets participatifs.
3. Analyse
Devant cette multiplication des dispositifs et des formes qu'ils prennent, il est important de se poser un certain nombre de questions sur le processus et sur ses effets. Lorsque l'on interroge la qualité du processus, sont ainsi pris en compte concernant les participants : leur diversité, leur représentativité, leurs compétences, ainsi que l'équité d'accès à ces dispositifs. Concernant le processus, il s'agit principalement du niveau de transparence et de traçabilité des débats, l'accessibilité aux informations, ou l'équité des prises de parole.
Les effets sont, quant à eux, moins étudiés, mais on peut considérer la création de nouvelles compétences, ou encore d'une posture de citoyenneté active, le traitement des problèmes posés avec la construction de nouvelles connaissances ou de nouvelles règles, mais les effets peuvent également concerner la reconnaissance des acteurs, le sentiment d'appartenance à un territoire, de nouvelles proximités ou la création de réseaux. Pour autant, il ne faut pas négliger ce que l'on peut nommer comme un effets indésirables : le renforcement du pouvoir de certains acteurs contribuant à faire apparaître de nouveaux notables de la participation, l'incapacité à mobiliser un public, ou l'instrumentalisation de la participation.
4. Conclusion
Il y a, dans les faits, une réelle mise en discussion mais celle-ci doit rester sous vigilance. La diversité et l'augmentation des démarches participatives obligent à analyser ce qui s'y passe, tant dans la place des acteurs, que dans les résultats. Il faut, bien évidemment, dépasser un point de vue qui serait uniquement normatif. Une bonne et nécessaire mise en discussion, ou uniquement critique, cela ne sert à rien. L'analyse doit être faite, y compris comme le note Hirschman dans ses effets pervers, l'inanité ou la mise en péril.