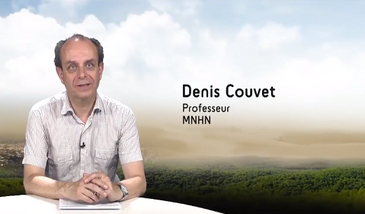En ligne depuis le 02/11/2017
0/5 (0)

Description
Catherine Aubertin revient dans cette vidéo sur l'émergence de la notion d'adaptation dans les conventions internationales sur la biodiversité et sur le changement climatique. Elle démontre la valeur politique de cette notion, qui s'oppose à celle d'atténuation, et revient pour conclure sur l'approche des "contributions nationales volontaires", pour répondre à ces enjeux globaux.
Objectifs d’apprentissage :
- Situer l’émergence de la notion d'adaptation dans les conventions internationales sur la biodiversité et le climat.
- Comprendre la valeur politique de cette notion.
- Comprendre l’intérêt et les limites de l’approche des "contributions nationales volontaires".
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+3
- Bac+4
Objectifs de Développement Durable
- 15. Vie terrestre
Thèmes
- Atténuation, Adaptation & Résilience
- Ecosystèmes et biodiversité
- Enjeux Climat/Biodiversité
- Les adaptations
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Aubertin Catherine
IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Ce document contient la transcription textuelle d’une vidéo du MOOC UVED «Biodiversité et changements globaux ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres aux interventions orales des auteurs.
Adaptation aux changements globaux et conventions internationales
Catherine Aubertin, Directrice de recherche, IRD
Les conventions internationales d’environnement signées à Rio, lors du Sommet de la Terre en 1992, témoignent de la façon dont les états définissent le problème, comptent le mesurer et y apporter des solutions. Les conventions internationales visent une régulation pour lutter contre l’érosion de la biodiversité et le changement climatique. Elles ont un rôle déterminant dans la diffusion des normes et des représentations, ainsi que dans les équilibres géopolitiques.
1. Le concept d’adaptation
L’apparition du concept d’adaptation dans les conventions internationales marque un tournant dans la prise en compte des transformations que subissent nos sociétés et les écosystèmes. C’est paradoxalement dans la convention climat que l’on va trouver les discussions autour de la notion d’adaptation et non, comme on aurait pu s’y attendre, dans la convention sur la diversité biologique.
Ce constat d’adaptation est un objet de négociations éminemment politique pour plusieurs raisons. Il s’oppose à la notion de développement durable qui devait réconcilier l’économique, le social et l’environnement. Avec la notion d’adaptation, il faut répondre à une menace extérieure, c’est-à-dire que l’Homme n’est plus vraiment maître de son destin. Le concept d’adaptation s’oppose aussi à l’atténuation. L’atténuation est la volonté de réduire les causes du réchauffement climatique, c’est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre. À partir du moment où l’on parlait d’adaptation beaucoup se sont insurgés en disant : « non, s’adapter c’est démissionner, se résigner, renoncer à contrôler les émissions de gaz à effet de serre et donc renoncer à modifier nos modes de production et de consommation ». Enfin l’adaptation a été un élément mobilisé par les pays du Sud pour revendiquer politiquement et financièrement des avantages dans les négociations. Sont ainsi venues à l’ordre du jour les questions de dette écologique, de justice climatique, mais aussi les questions comme nous le verrons de protection de la biodiversité et de reconnaissance des savoirs locaux.
2. La question du changement climatique
Comment a été construite la question du changement climatique ? On part d’une corrélation extrêmement forte entre la concentration des émissions de CO2 et le réchauffement de la température. Le scénario à l’horizon 2100 nous amènera à une température supérieure à quatre degrés cinq. Les objectifs de la convention climat parlent de ces concentrations de gaz à effet de serre. L’atténuation est l’objectif ultime : l’article deux est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre. L’adaptation quant à elle ne vient vraiment que comme une conséquence des résultats de cette lutte pour obtenir l’atténuation : les écosystèmes doivent s’adapter naturellement au changement climatique.
Pour résumer, on voit un problème de pollution de gaz à effet de serre mesuré dans une unité unique de tonnes de CO2, avec un plafond de gaz à effet de serre à partager entre pays développés. Tout ça est rendu possible grâce à un système de marché du droit du carbone, un marché de droits d’émissions entre les pays riches. A Copenhague, ce modèle va exploser pour plusieurs raisons. D’abord on s’aperçoit que les émissions de gaz à effet de serre continuent à croître et que donc les écosystèmes auront vraiment du mal à s’adapter. Puis il y a surtout une raison politique : les pays en développement remettent en cause cet objectif d’atténuation parce que cet objectif, pour eux, pour leur économie, est considéré comme un frein au développement. Ils n’ont plus accès à l’utilisation de leurs ressources naturelles énergétiques ou forestières par exemple. Par ailleurs, ces pays en développement sont les premières victimes du changement climatique : ils vont subir les inondations, les sécheresses, alors qu’historiquement ils ne sont pas responsables de l’accumulation des gaz à effet de serre. Le thème de l’équité va donc être lié à celui de l’adaptation, et ces nouveaux thèmes vont renouveler les contours de l’aide au développement. À Copenhague également, les pays en développement ne vont plus accepter que ce soit le secrétariat de la convention climat qui leur dicte leur politique énergétique. Ils vont alors proposer des contributions nationales volontaires, INDC en anglais, dans lesquelles chaque pays en fonction de ses caractéristiques géographiques, économiques, politiques, va proposer ses stratégies d’atténuation et d’adaptation. Cela va aboutir lors de l’accord de Paris, en décembre 2015, a présenté dans l’article sept les politiques d’atténuation sur les mêmes plans que les politiques d’adaptation. A ce moment on va percevoir le retour de la question de la biodiversité.
3. Retour de la question de la biodiversité
La biodiversité va apparaître comme l’une des variables centrales ou stratégiques des politiques d’adaptation, car elle intervient dans les politiques agricoles, dans les politiques de santé, dans les politiques de lutte contre les inégalités, et de pauvreté. On va alors avoir des objectifs importants autour de l’agriculture climato-intelligente, intégrant les questions de sécurité alimentaire, d’adaptation et d’atténuation, puis les forêts les sols vont être désignés comme puits de carbone potentiel, ça va être l’initiative 4 pour 1000. Les solutions fondées sur la nature, par exemple, c’est-à-dire ces solutions qui s’appuient sur les écosystèmes et leurs capacités régulatrices et productives vont s’imposer ; et également les approches territoriales par exemple avec les associations des grandes villes qui vont aussi avoir accès à la scène des négociations. On redécouvre ainsi la dimension locale de la question climatique, un problème global ne pouvant entraîner uniquement une solution globale orchestrée par l’ONU, mais bien une multitude de solutions qui vont être portées par la société civile. À cette échelle locale et sociale s’impose alors la prise en compte des connaissances traditionnelles.
4. Conclusion
La biodiversité dans ses composantes écologiques et sociales revient alors sur le devant de la scène. Ces contributions nationales vers quoi nous mènent-elles ? Le premier problème sera : à quel seuil, à quel niveau de réchauffement nous mènent-elles ? Si on en fait la somme évidemment on peut prévoir que le réchauffement va dépasser largement les trois degrés. L’autre question importante est le financement de ces politiques, c’est-à-dire aussi bien les politiques d’adaptation que d’atténuation. Cette problématique bien sûr reste ouverte.