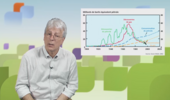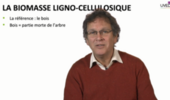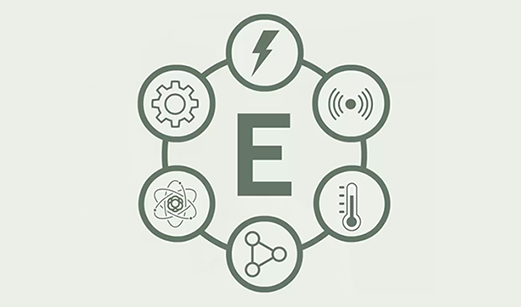En ligne depuis le 19/06/2020
4.1/5 (9)

Description
L'objectif de ce parcours est de découvrir les grandes problématiques actuelles en matière d'environnement. Ces problématiques renvoient d'une part aux limites planétaires et à la capacité des écosystèmes à supporter les pressions qui ont pour principale origine les activités humaines. Le changement climatique et l'érosion de la biodiversité sont au cœur de ces questions. Elles renvoient d'autre part à la finitude des ressources naturelles, comme par exemple les ressources minérales et énergétiques. La question posée est alors celle de l'épuisement de ces ressources, qui requiert à la fois de les gérer au mieux et de les substituer par d'autres ressources, plus renouvelables.
Ce parcours entend apporter des connaissances de base, pour tous les étudiants et ce quel que soit le parcours de formation qu'ils suivent. Il propose en complément des ouvertures disciplinaires pour montrer que ces questions engagent tous les domaines de connaissance et tous les secteurs d'activité de nos sociétés.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+3
- Bac+5
Objectifs de Développement Durable
- 13. Lutte contre le changement climatique
- 15. Vie terrestre
- 7. Energie propre et d'un coût abordable
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
- Enjeux Climat/Énergie
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

La biodiversité : définition, état, scénarios

Regards croisés sur l’enjeu biodiversité

Le climat : définition, état, scénarios

Regards croisés sur l’enjeu climatique

Les ressources naturelles (biologiques, minérales et…

Regards croisés sur la transition énergétique
Bases physiques de l'énergie - Définition et principes
Description
Ce module introduit le concept d'énergie (en relation avec ses différentes formes physiques) ainsi que quelques notions fondamentales qui lui sont associées : conversion, conservation, rendement, puissance, unités. Il constitue l'introduction et sera le prérequis nécessaire aux autres modules de la collection Transitions énergétiques.
Contributeurs
BOEUF Gilles
Sorbonne Université
David Bruno
ancien Président , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Shin Yunne
IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Ronce Ophélie
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Krief Sabrina
MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Laurans Yann
IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales)
Sueur Cédric
Université de Strasbourg (UNISTRA)
Tavernier-Dumax Nathalie
Université de Haute-Alsace (UHA)
Larrere Catherine
Marniesse Sarah
AFD - Agence française de développement
Henin Jeanne
AFD - Agence française de développement
Roturier Samuel
Swynghedauw Bernard
Chartier Denis
Demeulenaere Elise
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
HAINZELIN Etienne
CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Gignoux Jacques
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Peylin Philippe
LE TREUT Hervé
Jouzel Jean
Climatologue
Bousquet François
CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Planton Serge
climatologue et membre de l'association Météo et Climat
Bopp Laurent
directeur de recherche , CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Watkinson Paul
Ribera Teresa
Lammel Annamaria
Université Paris 8
Guegan Jean-François
Leadley Paul
Roué Marie
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
BRACONNOT Pascale
Hourcade Jean-Charles
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
TULET Pierre
Fleury Cynthia
Bourg Dominique
philosophe et professeur , Université de Lausanne
Bourges Bernard
IMT Atlantique
BLANC Philippe
FILIPOT Jean-François
SCHMITTBUHL Jean
VAITILINGOM Gilles
Cemagref
CURY Philippe
OLIVES Régis
GRIJOL Karine
Véron Jacques
Ined - Institut National d'Études Démographiques
PRADILLON Jean-Yves
Lévêque François
Mines Paris-PSL
Brodhag Christian
Mines Paris-PSL