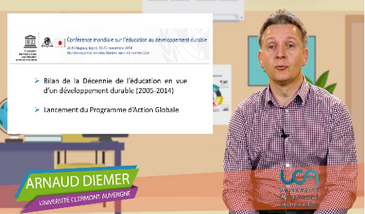En ligne depuis le 28/12/2017
0/5 (0)
Description
Arnaud Diemer, maître de conférences à l'Université Clermont Auvergne, explique dans cette vidéo (8'34) ce que sont les représentations et discute des moyens qui, dans une perspective d'éducation à l'environnement et au développement durable, permettraient de les casser et de les faire évoluer. Au-delà d'un travail sur la systémique, sur les valeurs, il souligne l'intérêt de considérer avec attention ce qui se fait dans le cadre de l'éducation non formelle.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Mentions Licence
- Sciences sociales
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+4
- Bac+5
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
DIEMER Arnaud
UCA - Université Clermont Auvergne
Arnaud Diemer, Maître de conférence, Université Clermont Auvergne
Étymologiquement, la représentation, cette notion qu’on retrouve aujourd’hui dans beaucoup de disciplines, dont beaucoup de cas de figure lorsqu’on tente de parler d’apprentissage, voire de compréhension du monde, renvoie à l’action de replacer devant les yeux. Ça suggère en fait 2 idées, la première c’est de faire apparaître quelque chose qui pourrait être absent, présent devant une ou plusieurs personnes. L’exemple le plus connu c’est bien sûr les 3 sphères qui font référence au développement durable, ces 3 sphères qui vont situer par exemple la durabilité, donc le durable, le vivable, le viable voire l’équitable. Et bien sûr on pourra avoir une discussion voire des conflits ou peut-être un retour sur ces notions, mais l’important est de comprendre en quoi l’acceptation individuelle des choses, la représentation, va permettre d’entrer dans la discussion. La deuxième idée c’est en fait de rappeler qu’on place quelque chose devant les yeux d’autrui, donc d’autres personnes. Ce qui signifie que la représentation a une portée, bien sûr, collective. Et on va le voir, cette portée collective suggère, bien sûr, un aller-retour entre différentes personnes qui peuvent être des apprenants voire des formateurs voire des chercheurs. Si on regarde un petit peu tous les débats sous-jacents la représentation, il y a 2 approches bien sûr qui sont complémentaires, mais qui en même temps ouvrent le débat sur comment aujourd’hui rentrer techniquement et théoriquement dans cette notion.
Le premier est ouvert par DURKHEIM*, et bien sûr la sociologie va jouer un rôle très important. Dès qu’on parle de représentation, on entrevoit la représentation individuelle et sociale, donc collective. Donc ce qui intéresse bien sûr, c’est la mise en collectivité des représentations. On va réfléchir sur tout ce qui fait sens, c’est-à-dire les croyances, les habitudes, voir comment aujourd’hui le collectif s’imprègne de représentation. On pourrait considérer chez DURKHEIM que la représentation a une réalité sociale. Chez les économistes la monnaie détient une forme de réalité.
La deuxième approche, elle vient de MOSCOVICI*. Là on introduit les interactions et ce qu’on veut savoir c’est en quoi la représentation donne lieu à des actes et des actions. Si on regarde bien, ça signifierait qu’il existe une compréhension, en interaction, qui va nous faire définir comment se forment nos actes et comment se transforment nos actions. On le verra, ça renvoie également une notion telle que l’imaginaire, telle que les approches cognitives voire les actions et les interactions.
Cette notion est reprise par *JODELET qui revient sur la connaissance commune. En fait, qu’est-ce qui fait une connaissance commune ? Ça peut être comment elle est décrite, analysée, et là on va revenir sur la notion de créativité. Comment je crée effectivement la représentation, comment je la partage, comment elle est acceptée. C’est également son organisation, qu’est-ce que je partage en commun, qu’est-ce qui peut être en dehors du partage, et puis finalement, ce qui rend la connaissance commune, ce qui va être vraiment acceptable. On voit tout de suite que la notion de représentation au sens littéral du terme, un noyau qui serait central dans ces représentations, joue un rôle clé.
Et c’est vrai qu’ABRIC* a joué un rôle très important dans la configuration, la conceptualisation de la représentation. ABRIC distingue 2 aspects, le noyau central qui correspond en fait à quelque chose non pas d’immuable, mais qui va centrer, concentrer la représentation. Le noyau a 2 fonctions, une fonction qui est génératrice, on va créer, on va identifier, on va comprendre ce qui est une représentation et puis une fonction organisatrice, on va essayer de comprendre comment elle est structurée cette représentation. Qu’est-ce qui prend forme, qu’est-ce qui la fait évoluer ? Et autour, bien sûr, de ce noyau existe une périphérie. Alors, la périphérie joue un rôle très important parce que dans le noyau, généralement, on considère que nos représentations sont, non pas immuables, mais ont du mal à changer, on a du mal à les modifier, c’est très compliqué. Et très souvent le noyau recentre l'individu sur ses propres représentations. La périphérie joue ce double rôle. Elle va jouer le rôle de prescription des comportements, dire comment on doit agir en fonction de nos représentations. Elle va dire aussi comment ces représentations vont, par autoformation, nous permettre d’aller plus loin, qu’est-on prêt à attendre dans nos modifications de comportement. Mais en même temps, elles vont renforcer énormément nos représentations. Je reviens sur l’idée qu’il est très difficile de changer de comportement et que la périphérie doit aider, mais en même temps, elle est cadenassée par un noyau qui est souvent très rigide.
Comment casser des représentations, c’est extrêmement complexe en mode éducatif.
Alors, si je reprends l’idée même de l’éducation et si on revient un petit peu à ses formes de représentation, il y a une histoire qu’il ne faut pas oublier dans l’éducation au développement durable c’est qu’on est parti de l’éducation à l’environnement, qui était vraiment une critique très forte du rapport homme nature voire homme environnement, et cette histoire, on l’a transmise dans l’éducation au développement durable, est vraiment un débat de représentation. Ce qui fait dire aujourd’hui que pour beaucoup, le développement durable ce n’est pas l’environnement, c’est plus que l’environnement. Mais en même temps, l’histoire nous renvoie à une forme d’éducation qui est l’éducation à l’environnement. Ce qui signifie une posture très critique par rapport à la société, par rapport au système, ça peut être le capitalisme, ça peut être le libéralisme, ça peut être aussi ce qui nous renvoie à la société, la notion de travail, de productivité et puis en même temps établir ce lien dans les représentations, ce qui est très formalisé. Je pense bien sûr à des méthodes qu’on emploie aujourd’hui pour débattre de l’éducation au développement durable.
On évoquait des enjeux de société, comment rentrer dans les enjeux, avec quelles méthodes ? L’approche systémique joue un rôle très important, nous mettre en relation les uns avec les autres également entre les variables d’un modèle par exemple, mais également la démarche. Est-ce qu’on reste dans nos disciplines, est-ce qu’on repousse les limites de la discipline ou on va plus loin ? Certains parlent d’inter voire de transdisciplinarité. Même chose sur les sphères, on a bien dit que les 3 sphères environnement, économique, sociale sont très réductrices. Comment on fait entrer le politique dedans ? Comment on fait entrer le social avec une dimension culturelle ? Voir comment on a la gouvernance au sein des sociétés? Et puis on pourrait revenir sur les grands principes, les grandes valeurs, tout ceci est aujourd’hui très formalisé, très codifié. N’importe quel curriculum parle effectivement ces notions et on n’a pas besoin d’aller très loin pour comprendre de quoi renvoie et à quoi renvoie l’éducation au développement durable.
La partie intéressante c’est sur la partie effectivement non formalisée, celle qui vient du terrain, celle qui part de la médiation, très souvent médiation interculturelle, il faut comprendre nos représentations, mais également débat sur que peut-on tirer de l’éducation populaire aujourd’hui. En quoi les bonnes pratiques sont le reflet d’une forme d’éducation ?
Et donc finalement, si on regarde bien ces notions, on commence à revenir un petit peu sur les schémas que j’évoquais au départ, ces schémas simplifiés qui nous font définir le développement et son éducation. Si on part du constat que l’environnement devient quelque chose de primordial et qu’elle délimite nos actions, il est clair que les ressources naturelles, que la biodiversité, que le climat, vont être justement l’ossature centrale et qu’en fonction de ça, la société, au sens social du terme, va devoir être responsable de ces ressources. Et donc, le principe de responsabilité est un principe clair dans l’éducation, formel ou non formel. Mais en même temps, ce principe de responsabilité n’est pas suffisant puisque la société vit sur une notion forte « être solidaire de », et que la production, la consommation voire l’échange, doit toujours intégrer cette vision altruiste de la solidarité. Mais en même temps, comme on sait que ces ressources sont très rares, être efficace. Et c’est là où on voit que l’éducation au développement durable, dans sa perspective représentation, nous amène à avoir une vision complètement différente des 3 sphères qu’on évoque très souvent, voire pourquoi pas des limites qu’on se fixe dans nos comportements. C’est peut-être ça l’idée principale de débattre sur les représentations.